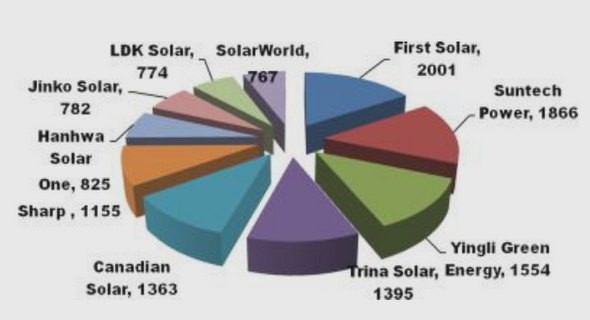Contrôle budgétaire
La définition du contrôle budgétaire varie selon les auteurs. Pour H. Court et J. Leurion (1982), le contrôle budgétaire est « un contrôle de gestion caractérisé notamment par la comparaison périodique des données prévues dans les budgets ».
Au fil du temps, le concept va évoluer et sera défini par Gervais (1994) comme « une comparaison permanente des résultats réels et des prévisions chiffrées figurant aux budgets afin de rechercher la (ou les) cause(s) d’écarts ; d’informer les différents niveaux hiérarchiques ; de prendre les mesures correctives éventuellement nécessaires ; d’apprécier l’activité des responsables budgétaires ».
En ce sens, le contrôle budgétaire est une fonction partielle du contrôle de gestion dont dépend la qualité de ses interventions. Il pourrait être pleinement perçu par les responsables opérationnels comme un service qui les aide à maîtriser et à améliorer leur gestion. Il incitera au dialogue et à la communication. « Le contrôle budgétaire classique consiste à calculer les écarts budgétaires, à repérer les écarts significatifs et à les analyser afin d’entreprendre une action correctrice, s’il y a lieu, et d’instituer par la suite un processus de planification en tenant compte de ces résultats. »
Rôle du contrôle budgétaire
Comme la définition du contrôle budgétaire, ses rôles varient selon les auteurs. Donc, nous allons définir ci-dessous le contrôle budgétaire selon ce dernier.
D’après R. Baudet [1941] : le contrôle budgétaire assure la prévision et l’établissement du programme d’activité ; l’observation continue des événements capables de modifier les prévisions ; la recherche des causes d’écarts et la fixation des responsabilités ; la coordination entre les différents services, le contrôle comptable des coûts de revient standards.
D’après G. Hofstede [1967] : le contrôle budgétaire assure l’autorisation de dépenses ; la planification ; la prévision ; le mesure des résultats.
Selon A. Hopwood [1974] : le contrôle budgétaire garantit la coordination ; la délégation d’autorité ; la planification ; la motivation. Selon E.M. Barrett et L.B. Fraser [1977] : le contrôle budgétaire planifie ; coordonne ; motive ; éduque ; évalue les activités au sein d’une entité (privé ou public). D’après D.T. Otley [1977] : le contrôle budgétaire serve d’instruments de motivation ; est un moyen de communiquer, un moyen d’augmenter la satisfaction au travail grâce à la participation.
D’après L. Samuelson [1986] : le contrôle budgétaire assure la planification ; la coordination ; le contrôle des résultats ; la détermination des objectifs financiers ; la comparaison des performances; la motivation financière ; l’aide à la décision. Selon S.R. Lyne [1988] : les budgets servent à faire des prévisions plus qu’à motiver, ils servent à contrôler et à expliquer les écarts, ils n’exercent pas de pression sur les salariés, le degré de participation n’est pas grand, en dernier ressort, ils sont un instrument de motivation.
D’après P. Bunce et al. [1995] : il assure la prévision financière et permet le contrôle des coûts d’exploitation et d’investissement, gestion des flux de trésorerie, fixation des objectifs pour l’entreprise mais aussi à titre personnel, la planification des moyens et affectation des ressources, l’évaluation des performances, outil de communication qui accroît la visibilité, l’établissement des prix de cession, utile pour la détermination des coûts standards.
Selon H. Bouquin [1997] : c’est un instrument de coordination et de communication, outil essentiel de gestion prévisionnelle, outil de délégation et de motivation.
Missions du contrôle budgétaire
Le contrôle budgétaire est défini comme une comparaison permanente des résultats réels aux prévisions chiffrées figurant aux budgets afin de dégager les écarts et rechercher leurs causes ; d’informer les différents niveaux hiérarchiques et d’apprécier l’activité des responsables budgétaires.
Au sens comptables, le contrôle budgétaire signifie une comparaison entre les prévisions budgétaires et les réalisations. Il s’agit d’examiner les écarts importants par rapport au budget et de tenter d’expliquer la raison de leur existence et ce que l’on peut faire pour remédier à la situation. Les écarts sont souvent qualifiés de « favorables » (ce qui est généralement une bonne nouvelle) ou de « défavorables » (ce qui est généralement une mauvaise nouvelle). Les missions principales de contrôleur budgétaire sont étudiées les écarts sur la prévision et de la réalisation des activités. Un écart favorable est constaté, lorsque les produits réels sont supérieurs aux produits budgétisés ou lorsque les dépenses réelles sont inférieures à dépenses budgétisées Un écart défavorable est constaté, lorsque les produits réels sont inférieurs aux produits budgétisés ; lorsque les dépenses réelles dépassent les dépenses budgétisées. Il est cependant utile d’analyser la cause des écarts et de déterminer s’il s’agit d’une situation temporaire ou permanente. Les écarts peuvent être la conséquence de l’un ou de plusieurs des facteurs, notamment : une évolution des prix, une évolution des volumes, etc.
Structure et Utilité du budget public
La structure : Elle est constituée par deux grands éléments ,d’une part, les recettes publiques, c’est-à-dire l’ensemble des ressources financières de l’Etat ou des collectivités locales généralement obtenues par l’impôt, la taxe administrative, le prix et l’emprunt et d’autre part, les dépenses publiques, c’est –à-dire tous les paiements non remboursables ; effectués par les administrations publiques ; qu’il s’agisse d’opérations avec ou sans contre parties ou des dépenses courantes ou en capital (dépenses de fonctionnement et d’investissement).
L’utilité du budget public : Le budget est une source d’information pour les membres de gouvernement, les bailleurs de fonds, les créanciers, les investisseurs, les opérateurs du secteur privé, les citoyens. Par ailleurs, il est la référence des ministères et des institutions publiques dans l’accomplissement de leur mission, de leur programme, de leurs activités et l’atteinte de leurs objectifs. D’où la notion de « budget programme ».
En termes quantitatifs et financiers de la politique à suivre, le budget est l’outil d’attribution d’objectifs et de moyens ; de motivation ; de coordination et de communication et d’optimisation de choix.
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE PRESENTATION GENERALE DE LA RECHERCHE
CHAPITRE I : CADRE GENERAL DE L’ETUDE
Section 1 : Contexte démographique et géographique d’Analalava
1.1-Contexte géographique
Section 2-Missions, Rôle, Attribution et structure organisationnelle
2.1-Missions, rôle, attribution du SDSP
2.2-Structure organisationnelle
Section 3-Cadre méthodologique
3.1-Techniques à utiliser
3.2-Analyse des résultats obtenus et synthèse de l’entretien
3.3- Cadre logique
3.3.1- Arbre de problème
3.3.2 – Arbre des objectifs
CHAPITRE II : BUDGET ANNUEL DU SDSP
Section 1-Budget de Fonctionnement
1.1-Fournitures de bureau et consommables informatiques
1.2-Mobilier de bureau et matériels informatiques
Section 2-Budget d’Investissement
2.1-Constructions des bureaux au niveau régional
2.2-Réhabilitation des infrastructures déjà existantes
Section 3-Exécution de ces budgets
3.1-Ordonnateurs, gestionnaires d’activités et dépositaires comptables
3.2-Personne Responsable des Marchés Publics
a)-Compétences générales
b)-Compétences spécifiques
CHAPITRE III : THEORIE GENERALE SUR LE CONTROLE BUDGETAIRE
Section 1-Définition, rôle, missions du contrôle budgétaire
1.1-Définition
1.2-Rôle
1.3-Missions du contrôle budgétaire
1.4-Différentes étapes du contrôle budgétaire
1.4.1- Le contrôle avant l’action ou contrôle à priori
Section2-Caractéristiques du Budget Public
2.1- Structure et Utilité du budget public
2.2- Nature du budget public
2.2.1-Acte de prévision
2.2.2-Acte d’autorisation
2.3- Comptabilité publique
2.3.1- Les grandes règles de la comptabilité publique
2.3.2- Contrôle du comptable public et sa responsabilité
2.4- Les grands principes budgétaire
DEUXIEME PARTIE ANALYSE ET IDENTIFICATION DES PROBLEMES
CHAPITRE I : DESCRIPTION DU CYCLE BUDGETAIRE DU SDSP
Section 1 : Notification du Budget
Section 2 : Nomination des Responsables
Section 3 : Formations des acteurs de gestion de crédit
Section 4 : Comptabilité
4.1- La procédure de la comptabilité publique
4.1.1- Engagement
4.1.2- Liquidation
4.1.3- Ordonnancement
4.1.3- Paiement
CHAPITRE II : PROBLEMES RENCONTRES AU NIVEAU DE L’ORGANISATION
INTERNE DE SDSP
Section 1 : Cumul de fonction de responsables du personnel
1.1-Confusion des fonctions
1.2- Retard d’informations
Section 2 : Lourdeur dans la procédure d’exécution de budget
2.1- Degré de la chaîne des dépenses très longue
2.2- Retard sur l’engagement de fonctionnement
2.3- Retard dans l’exécution du travail
CHAPITRE III : PROBLEMES RENCONTRES AU NIVEAU DE TRAITEMENT DES DOSSIERS
Section 1 : Problèmes liés sur le traitement des dossiers de nomination des acteurs de gestion de crédit
1.1-Nécessité de l’arrêté de nomination des acteurs de gestion de crédit
1.2-Circuit de traitement des documents de l’arrêté de nomination très longue
1.3-Retard des engagements et de réception
Section 2 : Insuffisance de formation au niveau des acteurs de gestion de crédit
2.1-Non maîtrise du SIGFP
2.2-Non maîtrise des procédures sur la passation des marchés publics.
2.3-Non maîtrise des opérations des dépenses publiques
TROISIEME PARTIE PROPOSITION D’AMELIORATIONS ET SUGGESTIONS
CHAPITRE I : SOLUTIONS CONCERNANT DE L’EXECUTION DU BUDGET
Section 1 : Normalisation du taux de rotation de personnel au sein du SDSP
1.1-Réflexion sur le basculement au sein du SDSP
1.2-Stabilité de responsable des exécutions budgétaires
1.3-Stabilité des budgets annuels (fonctionnement et investissement)
Section 2 : Amélioration de procédure d’exécution de budget
2.1-Formation des acteurs principaux du budget
2.2- Accélération sur l’engagement de fonctionnement
2.3-Rapidité dans l’exécution du travail
CHAPITRE II : SOLUTIONS CONCERNANT DE TRAITEMENT DES DOSSIERS
Section 1 : Accélérer le traitement des dossiers de nomination des acteurs de gestion de crédit
1.1-Amélioration de la durée de préparation de l’arrêté de nomination des acteurs de gestion de crédit
1.3-Amélioration de la durée de traitement des engagements et de réception des fournitures et consommables
Section 2 : Recruter ou former les acteurs de gestion de crédit
2.1-Recrutement du personnel qualifiant
2.2-Maîtrise des procédures sur la passation des marchés publics
2.3-Maîtrise des opérations des dépenses publiques
CHAPITRE III : SOLUTIONS RETENUES ET RESULTATS ATTENDUS
Section 1 : Solutions retenues
1.1-Mise en place d’un service de contrôle d’exécution budgétaire au sein du SDSP
1.2-Structure du service à créer, rôle, missions et activités de ce service
1.3-Formation des acteurs de gestion de crédit
Section 2 : Résultats attendus
2.1-Résultats économique
2.2-Résultats financier
2.3-Résultats social
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIES