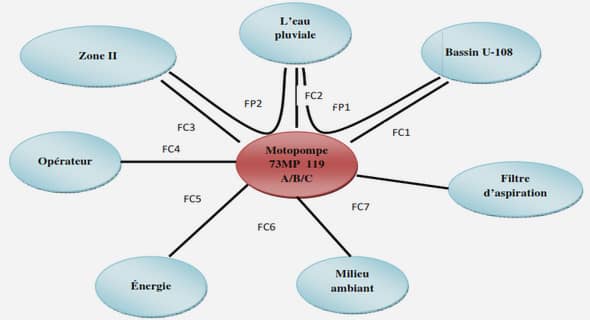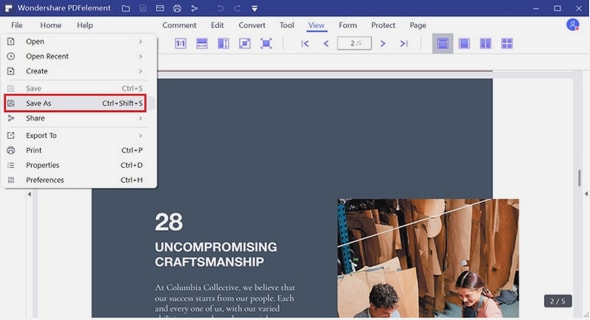Le régime général et les régimes complémentaires du secteur privé
Le système de retraite français est composé de plusieurs centaines de régimes, et nous avons choisi de nous intéresser à deux d’entre eux. Il s’agit d’abord du régime général, qui est aussi appelé Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, ou CNAV. Ce régime correspond au régime de base des salariés du secteur privé, et environ 2/3 des assurés et des retraités y sont inscrits. Nous avons choisi ce régime car il est le plus important en termes d’effectifs et de flux financiers qui y transitent, mais aussi car il est le premier à connaître une réforme défavorable. Notre objet est ensuite complété par les régimes complémentaires du secteur privé qui correspondent à l’AGIRC et l’ARRCO. Tous les salariés du secteur privé cotisent à l’ARRCO et peuvent en recevoir une pension, tandis que l’AGIRC est destinée aux cadres.
Régime de base et régimes complémentaires versent des pensions aux retraités, dans des proportions moyennes respectives moyennes de 2/3 et 1/3. Un retraité du secteur privé qui perçoit par exemple 1 000 euros de retraite totale, reçoit ainsi environ 666 euros de la CNAV et 333 euros de l’ARRCO.
Les graphiques n°1 et n°2 représentent les effectifs de cotisants et de retraités des régimes de retraite. Ils illustrent la place prépondérante occupée par les régimes pris en compte dans notre objet.
Les retraites sont versées selon deux de formules de calcul, selon qu’il s’agit du régime général ou des régimes complémentaires. La formule de calcul de la retraite pour le régime général consiste à attribuer une pension égale à une fraction du salaire moyen, modulée selon des conditions de durée de cotisation et d’âge (cf. encadré ci-dessous).
Le salaire annuel moyen correspond à la moyenne des salaires sur une période donnée. Actuellement, il s’agit des 25 meilleures années de salaires. Avant d’entrer dans le calcul de la moyenne, chaque salaire est actualisé selon un coefficient, qui est actuellement celui de l’inflation. Ce sont les « salaires portés au compte ».
Le taux de remplacement est de 50%.
La durée de cotisation de l’ouverture du taux plein est actuellement de 43 ans. Il s’agit du taux plein, car si la durée de cotisation est réelle est inférieure, alors la pension sera inférieure à 50% du salaire annuel moyen.
L’âge joue aussi un rôle dans la détermination du montant de la retraite. Actuellement, l’âge légal de départ en retraite se situe à 62 ans. Cela signifie que les départs en retraite sont possibles à partir de cet âge, mais que le taux plein n’est atteint que pour durée de cotisation de 43 années. Pour chaque trimestre « manquant », la pension est baissée de 1,25%, soit une baisse de 5% par année manquante ». En revanche, l’âge du taux plein permet l’ouverture de sans que ces pénalités soient appliquées en raison des trimestres manquants. Actuellement, est atteint au plus tard à 67 ans.
La formule de calcul des régimes complémentaires de l’AGIRC-ARRCO repose sur le nombre de points accumulés. Ces points sont calculés sur toute la carrière et résultent de l’application d’un taux de conversion, appelé prix d’achat du point », aux cotisations versées. Les points accumulés sont ensuite convertis en montant de retraite, au moment de la liquidation, selon un autre coefficient de conversion, appelé « valeur du point » (cf. encadré ci-dessous).
Deux différences majeures existent ainsi entre les deux formules de calcul. Celle du régime général raisonne par rapport à un salaire moyen et ne choisit qu’une partie des salaires de la carrière pour le calculer. La formule des régimes complémentaires raisonne par rapport aux cotisations versées sur toute la carrière, en les convertissant en points.
Les acteurs : gouvernements, administrations, syndicats et patronat
Le retournement12 que nous cherchons à expliquer dans cette thèse est celui du régime général et des régimes complémentaires du secteur privé. Cela nous amène à nous intéresser aux acteurs qui jouent un rôle dans la modification des régimes de retraite.
Il s’agit pour le régime général tout d’abord du gouvernement, qui choisit les taux de cotisation, la durée de cotisation et la formule de calcul des pensions. Le gouvernement, cela signifie pour nous le Président, le Premier ministre, les ministères des Affaires sociales et de l’Économie et du Budget. L’administration recouvre la direction de la Sécurité sociale (DSS), la direction du Budget (DB), le Commissariat Général au Plan (CGP), la Direction de la Prévision et dans une moindre mesure la direction du Trésor. Etant donné les circulations d’acteurs, de notes et de positions entre les administrations et ministères sociaux et budgétaires, nous adopterons les termes d’administration sociale pour désigner la DSS et le ministère des Affaires sociales, et d’administration budgétaire pour désigner la DB et le ministère du Budget.
Les acteurs syndicaux et patronaux tentent régulièrement d’influencer le régime général par leurs revendications et les consultations organisées avec le gouvernement. Nous avons choisi parmi ces acteurs de nous intéresser à la CGT et à la CFDT, qui sont les acteurs syndicaux les plus importants.
Ce choix résulte aussi des sources : FO n’offre pas la possibilité de consulter ses archives. Mais il résulte aussi des possibilités matérielles et temporelles de ce qu’il est possible de faire dans un travail de thèse en termes de consultations de sources d’archives. Aussi avons-nous choisi de ne pas intégrer dans le cœur de notre analyse la CGC et la CFTC dont le pouvoir est moins important que celui de la CGT ou de la CFDT. Nous avons choisi de suivre pour le patronat le CNPF et l’UIMM, également pour des raisons d’influence13 dans le paysage patronal, de sources et de limites matérielles et temporelles du travail de thèse.
Concernant les régimes complémentaires, les acteurs qui comptent sont les syndicats « représentatifs », parmi lesquels nous avons retenu la CGT et la CFDT, et le patronat, au sein duquel nous avons choisi l’acteur très largement majoritaire qu’est le CNPF14. La CGT, la CFDT, la CGC, la CFTC et FO sont les syndicats désignés comme représentatifs par la loi (Adelheid 2000, Freyssinet et de Terssac 2003). Dans le cadre de négociations d’accords paritaires comme à l’AGIRC ou l’ARRCO, le camp syndical représente la moitié des voix du conseil d’administration, et le patronat l’autre moitié. Il suffit ainsi qu’un seul syndicat signe avec le patronat pour qu’un accord soit validé. Ces acteurs prennent de manière paritaire les décisions relatives aux taux de cotisation, à la durée de cotisation et au calcul des pensions complémentaires (dont les taux de conversion entre l’argent et le point). Le gouvernement compte parfois dans ce processus de décision également en ce qu’il encourage les syndicats et le patronat à aboutir à un accord. En outre, si les partenaires sociaux ne trouvent pas d’accord, le gouvernement peut décider à leur place15.
La période : entre les années 1970 et les années 1990, la centralité des années 1980
Ce sont ainsi ces régimes et ces acteurs que nous allons suivre entre les années 1970 et 1990, avec au cœur de notre analyse l’« énigme » de l’écart entre les réformes de 1983 et 1993. En effet, en 1983, l’âge de départ minimal à la retraite est abaissé à 60 ans pour le régime général et les régimes complémentaires, tandis qu’en 1993, la durée de cotisation nécessaire pour partir à la retraite sans pénalité passe de 37,5 ans à 40 ans. Par ailleurs, l’indexation des retraites et des salaires portés aux comptes devient moins avantageuse en passant des salaires aux prix, ces derniers augmentant alors moins vite. Cette année 1993 marque ainsi le début d’un processus de réforme où la durée de cotisation et l’âge de départ minimal vont progressivement augmenter dans tous les régimes, tandis que les indexations deviennent de moins en moins favorables aux retraités.
Nous avons choisi l’année 1993 comme fin de période, car la réforme de cette année est ensuite répliquée aux différents régimes de base jusqu’à aujourd’hui, dans les années 2010. Il ne s’agit pas de défendre l’idée selon laquelle tout se joue en 1993 et que les réformes suivantes sont des copies aisément appliquées, mais de donner à voir la genèse de la réforme matricielle » des réformes de la période dans laquelle nous sommes situés. En effet, la forme de la réforme de 1993 rencontre des résistances de mouvements sociaux, entre 1993 et 2014, mais c’est bien elle qui est étendue au sein du système de retraite français.
La thèse et ses contributions à la littérature
Nous cherchons dans ce travail à montrer les liens entre le retournement des retraites et tout à la fois le basculement des politiques de l’emploi et le virage assuranciel qui se dessine peu à peu au sein de la Sécurité sociale des retraites. Après avoir explicité cette thèse, nous détaillons ses apports à la littérature.
Le retournement des politiques de retraites du fait du basculement des politiques de l’emploi et du virage assuranciel
Le retournement des retraites est tout d’abord fortement lié au basculement des politiques de l’emploi qui se produit au cours des années 1980.
Au cours des années 1970, alors que le chômage commence à s’installer en France, les politiques de retraite commencent à être mises au service de celles de l’emploi. Cela passe dans un premier temps par la multiplication des dispositifs de préretraite et l’abaissement de l’âge de la retraite. La politique de l’emploi consiste alors à ajuster la population active au volume d’emplois. Puis, à partir de 1983, un basculement intervient avec l’adoption d’une politique de désinflation compétitive. Cette nouvelle politique de l’emploi va conditionner à son tour le contenu des politiques des retraites, mais en leur donnant un tout autre contenu. Cela se traduira d’une part par la réduction des préretraites et d’autre part par la compression du circuit financier des retraites qui s’organise au travers de quatre évolutions paramétriques : la fin de la hausse du taux de cotisation, la hausse de la durée de cotisation et la baisse relative du niveau des pensions par la hausse de la durée du salaire de référence et l’indexation sur les prix au lieu des salaires.