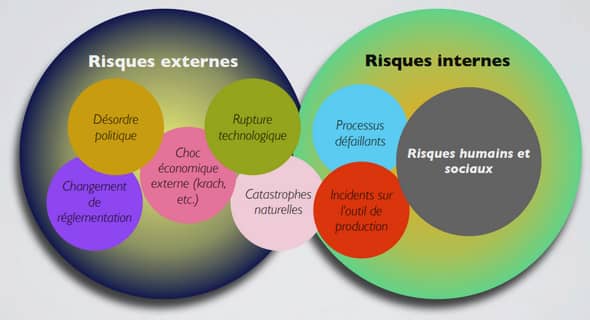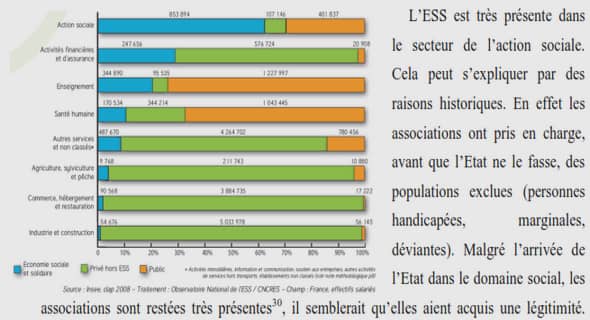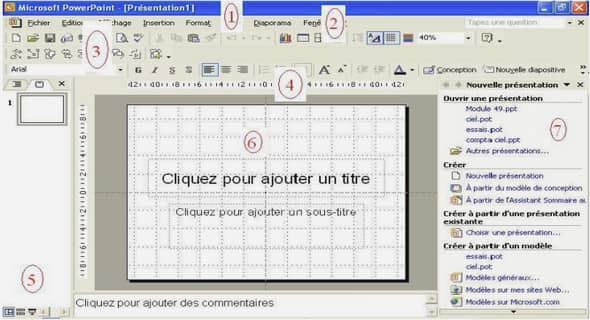Naissance et origines de Côme
La date de naissance de Côme n’est pas donnée précisément mais il indique pour l’année 1125 « mihi iam octogenario »11. Tout semble donc indiquer que Côme est né en 1044 ou 1045. Pourtant, cette date elle-même n’a pas toujours fait l’unanimité. Deux phrases ont semé la confusion : en II, 34, notre auteur indique d’abord « Nec tacere cupio, quod eodem anno nobis adhuc positis in scolis contigit audire et videre »12. L’idée que Côme pourrait encore être à l’école en 1074, c’est-à-dire à l’âge de 29ou 30 ans pose problème. La contradiction est renforcée par le fait qu’il se fait appelé «bone puer » (II ,34)13 quelques lignes plus bas. Le mot puer désignant normalement un petit enfant, son emploi prête ici à confusion. Des historiens ont alors remis en cause l’idée communément admise selon laquelle Côme serait né vers 104514. Néanmoins, Bertold Bretholz a proposé une hypothèse résolvant ces contradictions et qui s’avère tout à fait crédible.Le passage en question s’insère dans une curieuse lacune du récit entre 1074 et 108215. Au lieu de raconter les évènements survenus au cours de ces années, Côme fait le récit de trois anecdotes. La première anecdote concerne le mariage de Mathilde de Toscane (1045/1045 – 1115) e t du duc Welf II de Bavière (v. 1072 – 1120) en 1089. On voit mal comment Côme aurait pu f aire une erreur si grossière sur la date de l’évènement. La seconde anecdote concerne la barbe de l’évêque de Prague Gebhard (1068-1089) en II,33 et la dernière est le récit d’un miracle auquel Côme aurait assisté dans la crypte de la cathédrale de Prague et dans lequel s’insèrent les deux expressions qui posent problème. Le récit chronologique des événements reprend ensuite son cours avec l’année 1082. Bertold Bretholz suppose finalement que des ces trois anecdotes, seule celle sur la barbe de Gebhard peut avoir lieu entre 1074 et 1082 et que leur récit a pour fonction de masquer les lacunes de la trame principale. Par l’expression « nobis adhuc positis in scolis », Côme aurait donc voulu dire : « à l’époque où nous étions encore à l’école». L’hypothèse formulée par Bertold Bretholz est la plus vraisemblable et c’est celle que nous retiendrons, en considérant par conséquent que Côme est né vers 1045.
La question des origines de Côme a également étédébattue, notamment à propos d’un potentiel ascendant polonais. Lorsqu’il rapporte que Břetislav Ier ramène de sa campagne de Pologne en 1039 un nombre incalculable de prisonniers nobles, il dit « inter quos heu, male captus adductus est meus attavus, consors in clero, prebiter officio »16. Les deux mots « meus attavus » ont interrogés un certain nombre d’historiens . Dans la seconde moitié du XIXème
L’hypothèse est cependant peu vraisemblable. Dans sa Würdigung der alten böhmischen Geschichtsschreiber, publiée à Prague en 1830, František Palacký imagine lui que Côme était alors professeur, et non étudiant, à l’école. Sa proposition ne résout cependant pas le problème de l’emploi de siècle, l’idée que Côme serait le descendant d’un risonnierp de la noblesse polonaise ramené par Břetislav en 1039 s’est imposé dans l’historiographie. Là encore, Bertold Bretholz a contrecarré de manière efficace cette idée dans lapréface à son édition de 1923 . D’une part, il remarque que lorsqu’il est question de Polonais dans la Chronique, Côme porte toujours un jugement négatif sur eux, voire méprisant. Bertold Bretholz fait d’autre part remarquer que les deux mots qui fondent cette hypothèse ne sont présents que dans les manuscrits qu’ils désignés dans son stemma par les cotes A3a et b alors qu’ils sont absents dans les autres. De plus, Côme étant vraisemblablement né entre 1035 et 1045, il est improbable qu’un de ces prisonniers soit son « attavus ». A la rigueur, il pourrait être son grand-père avus(). Bertold Bretholz imagine alors qu’un lecteur ou un copiste de la Chronica Boemorum, croyant savoir qu’il avait lui-même pour ancêtre l’un de ces prisonniers, a inséré dans le manuscrit une remarque tout à fait personnelle que les historiens auraient pris pour un commentaire de Côme lui-même. Il nous semble qu’écarter l’hypothèse del’origine polonaise de Côme sur la seule base de son jugement négatif sur les Polonais revient à trancher un peu vite sur cette question. Néanmoins, le problème du sens d’«attavus », soulevé par Bertold Bretholz, fait paraître très peu vraisemblable cette hypothèse. La grande majorité des historiens pensent aujourd’hui que Côme est un Bohème de souche. Sans écarter complètement l’origine polonaise de Côme, nous dirons qu’il est probablement d’origine bohème. Nous faisons enfin remarquer, avec Lisa Wolverton20, que, quelle que soit l’origine réelle de Côme, il ne montre pas d’attache hors de Prague et de la Bohême (et surtout pas pour la Pologne). Dans la perspective qui est la nôtre, cette question apparaît donc secondaire.
Reste la question de l’origine sociale de Côme de Prague. František Palacký affirmait dans sa Würdigung der alten böhmischen Geschichtsschreiber (Prague, 1830), que Côme était un Henri, a un cliens21. Cependant, Bertold Bretholz fait judicieusement remarquer que les clercs avaient également des clients et qu’il est probableque le fils de Côme ait également embrassé une carrière ecclésiastique . Reste le cas, que l’on a qualifié de peu probable, où Côme serait effectivement un descendant de noble polonais fait prisonnier par Břetislav Ier en 1039. On n’a donc aucune preuve solide que Côme soit issu d’une quelconque noblesse. Néanmoins, son statut de chanoine de Prague invite à lui prêter une origine noble. De plus, cela pourrait expliquer qu’il ait effectué un séjour d’études ‘écoleà épiscopale de Liège. En effet, on ne sait pas sous quel patronage, il a reçu ce privilège. Il est possible que son séjour ait été financé par le chapitre de Prague, voire par le duc, mais ce financement peut tout aussi bien être d’origine familial23.
La formation de Côme
L’expression « nobis adhuc positis in scolis »24, employée à l’occasion du récit de miracle fait en II, 34, montre que Côme a suivi une formati on initiale à l’école épiscopale de Prague. On sait très peu de choses de l’enseignement donnéà Prague à cette époque mais il était certainement de médiocre qualité par rapport à celui dispensé dans les grandes écoles de la Chrétienté d’Occident. Les réformes de l’évêque hardGeb (1067-1090) et du prieur Marc ont amélioré la qualité de cet enseignement mais, si Côme est bien né autour de 1045, il n’a vraisemblablement pas pu bénéficier de ces progrès .A Prague, notre chanoine a vraisemblablement appris les rudiments du Latin, de la lecture, des Psaumes (comme il le signale en II,34), de la musique, du chant et du calcul, c’est-à-dire les fondamentaux pour entamer l’apprentissage des sept arts libéraux. Peut-être a-t-il commencé ce second cursus à Prague.
Côme signale en III, 59 avoir étudié à Liège autemps de sa jeunesse, alors que Francon était magister25. Francon est l’auteur du traitéSur la quadrature du cercle ainsi que de Questiones in musica mais il est également renommé pour sa science des Lettres. On sait qu’il est écolâtre de l’école épiscopale de Liège entre 1066 et 108326, Côme a donc vraisemblablement séjourné à Liège au début de l’office de Francon. Il est même tout à fait probable qu’il soit arrivé à Liège avant mais qu’il ne signale que Francon parce qu’il a dirigé l’enseignement liégeois pendant l’essentiel de son séjour. Egbert de Liège(né vers 972) signale qu’il a fait trois ans d’études fondamentales et neuf pour suivre le cursu du trivium et du quadrivium27. Rien n’indique que tous les élèves fassent tous le mêmenombre d’années d’étude mais cet exemple nous donne une idée du temps que Côme a pu passer à Liège. Ayant déjà au moins reçu une formation initiale à Prague, il a sûrement directem ent entamé l’étude des arts libéraux. Il a donc vraisemblablement passé cinq à dix ans à Liège.
Liège a connu au IXe siècle un premier rayonnement interrompu par les invasions normandes. A partir de 940, l’évêché connaît un renouveau dont le centre est l’abbaye de Lobbes28. Dès le Xe siècle, l’évêché de Liège constitueceuntre intellectuel et de formation important. L’évêque Notger de Liège (972-1008) notamment réorganise l’enseignement dans l’école épiscopale de Saint-Lambert et dans le diocèse. Il accueille non seulement des hommes du diocèse mais également des étrangers, envoyés rpade grandes familles ou des évêques. Les écoles liégeoises forment un grand nombre de futurs évêques et membres de l’élite ecclésiastique au Xe et XIe siècles . L’enseignement était gratuit du temps de Notgeret Wazon de Liège (1042-1048) allait jusqu’à pourvoir aux besoins des bons étudiants aux frais de l’évêché. Au XIe siècle, Liège est assurément un lieu de circulation entre les grands centres de la Chrétienté, comme Chartres, Rome, Cologne…. 32.
Côme dit seulement avoir étudié la Grammaire et la Dialectique alors que Francon est magister scolatus. Mais il y a plusieurs écoles canoniales à Liège.Pour Jean-Louis Kupper, le chapitre épiscopal de Saint-Lambert est « la clef de voûte » de l’enseignement liégeois . La liste de ses écolâtres est en effet très prestigieuse34. On sait qu’à l’époque de Notger, Liège comptait en plus six écoles collégiales : Saint-Martin, Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Croix, Saint-Denis et Saint-Jean. Emile Lesne signale qu’une septième est fondée en 1016 : Saint-Barthélémy. Selon Godefroid Kurth, les écoles collégiales servaient « d’établissement d’enseignement moyen » tandis que l’école cathédrale était plutôt comme un séminaire ou une université . Mais le pays mosan abrite également de nombreuses écoles monastiques qui constituent autant de centres intellectuels. Pour Christine Renardy, le milieu intellectuel liégeois est d’ailleurs dominé par le fait monastique, même si l’école de Saint-Lambert joue un rôle primordial dans le rayonnement culturel des ce ntres mosans. Les travaux littéraires, scientifiques et théologiques sont d’ailleurs tousle produit du milieu monastique, hormis la chronique d’Anselme (dont nous reparlerons ci-dessous)37. Parmi les abbayes importantes du diocèse, celle de Lobbes (qui appartient au diocèse de Liège mais est situé dans celui de Cambrai) se distingue particulièrement mais celles de Stavelot-Malmédy, de Saint-Trond, de Saint-Hubert ou de Gembloux sont importantes également. Or, le pays mosan est un espace de grande circulation intellectuelle. Charles Dereine dit que toutes ces abbayes bénédictines exerçaient « une forte attraction sur les chanoines liégeois »38. A titre d’exemple, Wazon est formé à l’abbaye de Lobbes avant de devenir écolâtre puis évêque de Liège. Edouard de Moreau dit également :« La supériorité littéraireu dXIe siècle sur les époques précédentes est surtout due aux écoles. Celles-ci continuent à suivre les anciens programmes. Mais le goût des études est beaucoup plus répandu. L’intérêt scientifique s’est développé. On recherche les meilleurs maîtres. Élèves et professeurs passent d’une école à l’autre. Des relations durables se créent entre intellectuels de divers pays. »39. Côme a donc pu se rendre dans les écoles monastiques, y suivre les cours de certains maîtres et y lire des livres. En particulier, le milieu monastique mosan (et plus largement occidental) est le cœur d’une tradition historiographique impériale importante au Xe et au XIe siècle, sur laquelle nous reviendrons dans le développement.
On ignore si Côme a poursuivi sa formation initi ale à Liège. Celle-ci fournissait aux élèves les fondamentaux nécessaires à l’étude des arts libéraux. On y apprenait notamment la maîtrise parfaite du Latin en s’exerçant à l’écriture d’actes publiques, en ne parlant que Latin dès que possible et en lisant des recueils de sentences, comme les Distiques de Caton, les Fables de Phèdre ou le Fecunda Ratis, composé par Egbert de Liège (né vers 972). En tout cas, Côme a mobilisé ces acquis lors de la composition de la chronique. Une fois ces fondamentaux acquis, l’études des sept arts libéraux commence.
Les maîtres de Grammaire étaient libres d’enseigner les auteurs qu’ils voulaient mais certains auteurs étaient privilégiés : Prudence, idoreIs de Séville, Virgile, Lucain (tous réemployés par Côme), Priscien, Martianus Capella..41 On connaît un certain nombre d’auteurs disponibles dans les bibliothèques liégeoises. Tous n’étaient pas enseignés mais ils étaient à la disposition des plus curieux, parmi lesquels était sans doute Côme42. La versification, considérée comme une excellente gymnastique intellectuelle et comme une preuve de culture, est pratiquée avec grand intérêtàLiège. Aucune ville ne maîtrisait aussi bien cet art. Pour les chroniqueurs et les hagiographes, c’est une manière de montrer leur savoir-faire. Côme n’échappe pas à la règle puisqu’il introduit de très nombreux passages versifiés dans sa chronique. En Rhétorique, les écoliers s’entraînaient à rédiger des lettres et des diplômes (Côme a donc l’habitude d’imiter les a ctes). Cela nécessitait des notions de droit, discipline également enseignée à Liège. Par ailleurs, on apprend à imiter le style des Évangiles. On en sait peu sur l’enseignement de la Dialectique. Mais Liège a une grande réputation dans ce domaine tout au long du Xe siècle au moins. Nous ne étendrons pas sur l’enseignement du quadrivium, ce qui serait ici hors de propos. Néanmoins, signalons que Liège était également réputé pour la Musique, l’Arithmétique, l’Astronomie et la Géométrie (discipline qui comprenait la Géographie, enseignement que Côme a pu mettre en pratique dans sa chronique). L’enseignement de l’Arithmétique était important car il était nécessaire pour la chronologie et le comput. Côme s’est sans doute souvenu de ses leçons dans cette discipline en rédigeant la chronique. L’enseignement des sept arts libéraux préparait à un enseignement considéré comme supérieur : la Théologie. Mais rien n’indique que Côme ait poussé ses études jusque-là. On sait que sous Wazon pour le moins, l’éducation par le respect des mœurs était aussi important que celle par les s ciences. D’où peut-être les nombreux portraits à valeur d’exemplum dans la chronique43.
La carrière ecclésiastique de Côme
On n’ignore si Côme était déjà chanoine de Prague avant de partir étudier à Liège. Il prétend avoir assisté à la signature du privilège de l’évêché de Prague, confirmé en 1086 à Mayence par l’empereur Henri IV (II, 37)44. Côme accompagne également son homonyme, nouvellement élu évêque de Prague, et l’homologuee dce dernier André d’Olomouc à Mantoue où ils reçoivent l’anneau et la crosse des mains de l’empereur (II,50)45. Il accompagne les deux mêmes évêques se faire ordonnerpar l’archevêque de Mayence en 1086 (III, 2 et 3)46. En 1099, il accompagne également l’évêque Hermann(1099-1122) lors d’une rencontre entre Břetislav II et le roi Coloman de Hongrie à Lúčky à l’occasion de laquelle Hermann et lui-même sont ordonnés prêtres par l’archevêque d’Esztergom (III, 9). Côme participe à une cinquième mission diplomatique en 1110 en Moravie, afin de récupérer les droits sur le marché de Sekyrkostel usurpés par leprince Otton II d’Olomouc48. Côme avait donc une place importante au sein du chapitre puisqu’il accompagne l’évêque lors de séjours importants hors du duché et il semble même chargé ersonnellementp d’une mission diplomatique en Moravie. On ne sait pas s’il étaitdéjà doyen à cette occasion. Le fait est qu’il se présente comme «ecclesie solo nomine decanus » dans le « Prologue à Sévère » et comme « haud dignus dici decanus » dans le « Proemium à Clément, abbé de l’église eD Brevno »(préface du livre 2) . Mais le « Prologue à Sévère » est généralement considéré comme un prologue à l’ensemble de la Chronique, ajouté alors que l’œuvre est déjà entièrement composée (voir I,1). Dès lors, on ignore si Côme devient doyen entre le livre I et chanoines vivaient dans des maisons hors des enceintes, disséminées dans la ville. Côme indique qu’il avait une femme lorsqu’il signale sondécès en 1117 . Il était aussi le père d’au moins un fils, dit Henri, dont il indique l’existence lorsqu’il parle d’un pèlerinage auquel participe Bertold, un cliens de celui-ci53. Le fils de Côme a un temps été confondu avec Henri Zdík, évêque d’Olomouc entre 1126 et 1150, mais cette hypothèse a aujourd’hui été abandonnée faute de preuve solide.
L’écriture de laChronica Boemorum
Côme écrit la Chronica Boemorum à la fin de sa vie. Dans la préface adressée à un certain Gervais, il fournit des informations chronologiques permettant d’estimer la date de composition du livre I entre 1120 et 112254. Nous ne disposons pas d’indication sur les dates de composition de la suite de l’œuvre mais nous pou vons penser logiquement qu’elle a lieu entre la fin de la rédaction du livre I et la mort de l’auteur, donc entre 1120 et 112555. Cette chronologie a parfois été contestée mais elle faitglobalement l’unanimité parmi les historiens aujourd’hui56. Le fait que Côme de Prague prétende envisager de ne pas poursuivre son œuvre 57, même si la formule appartient très certainement ua topos médiéval de l’humilité de l’auteur, invite à penser qu’il rédige sa chroniquede sa propre initiative. Cette donnée est essentielle parce qu’elle autorise à penser que, dans une certaine mesure, les choix que Côme opère dans la composition sont consentis librement et donc qu’il est possible d’analyser l’œuvre comme le réel fruit de la pensée d’un clerc du début du XIIe siècle. La qualité littéraire du récit invite à penser que Côme n’en était pas à son coup d’essai. Il avait probablement déjà écrit d’autres textes, aujourd’hui perdus.