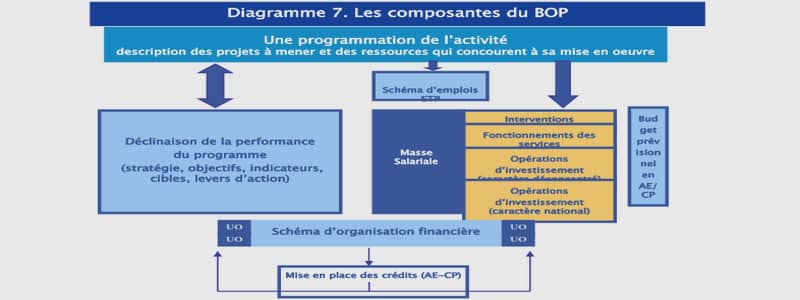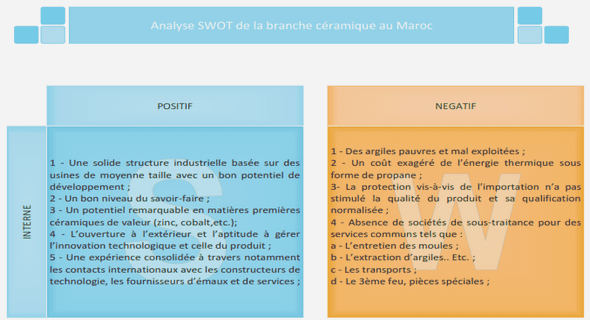Le « sous-développement » au-delà de la croissance et de l’économie de marché
Entre les années 1950 et 1970, de nouvelles idées et paradigmes provenant de différentes régions du monde ont ainsi émergé en ouvrant la conception de la notion de développement au-delà de l’économie de marché et de la recherche de la croissance, et en nourrissant la théorie de la dépendance. Les apports de François Perroux, dans la différentiation de la croissance et du développement sont essentiels dans ce sens. En allant au-delà des propositions qui plaidaient pour une industrialisation des pays du tiers monde avec pour objectif d´atteindre le stade de développement des pays industrialisés, Perroux a proposé une « réflexion plus globale, tous pays confondus, sur les finalités ultimes de la vie et de la pensée économiques » (Maréchal 2003 : 60). Alors que la croissance est conçue comme l’augmentation continue d’une dimension quantitative d’une population, le développement se réfère à la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global » (Perroux 1961 : 191). En plus d’introduire l’idée du durable, la notion de développement proposée par Perroux sort du domaine de l’économique pour impliquer aussi le social, nécessaire pour améliorer les conditions de vie d’une population.
Dans cette période, les travaux de l’économiste Samir Amin se sont aussi distingués en introduisant une nouvelle proposition plus critique pour comprendre le développement et le « sous-développement ». En reprenant,entre autres, les postulats de la théorie de la dépendance, Amin adopte les notions de « centre » pour se référer aux pays développés, de « périphérie » pour parler des pays « sous-développés », et de dépendance » pour envisager les échanges inégaux qui ont lieu entre des pays développés et des pays « sous- développés » (Amin 1973). La dépendance tant financière que commerciale et technologique des périphéries du centre capitaliste, soutenue par les coopérations et les investissements centre-périphérie, condamne les périphéries à ne jamais rejoindre le modèle capitaliste, c’est-à-dire le développement. Le sous-développement est ainsi au service du développement, en l’aidant à la concentration et l’accumulation du capital. Samir Amin préconise actuellement son postulat depuis la direction du Forum du Tiers Monde12, au sein duquel il anime des discussions sur le développement et ses multiples expressions possibles. Également inspirées par la théorie de la dépendance, les contributions d’ImmanuelWallerstein érigées dans les années 1970 (The Modern World System et The Capitalist World-Economy) ont été importantes et particulièrement inspiratrices pour les mouvements altermondialistes jusqu’à nos jours. Il propose le concept de système-monde pour analyser l’économie mondiale, le phénomène de la globalisation et la situation des pays sous-développés à l’égard des pays développés depuis une approche historique globale. Pour lui, la globalisation est « a process that is coterminous with the development of the capitalist world-economy over the past 500 years » (Wallerstein 2012 : 525). Et dans ce système-monde, plus que des développés et des sous-développés, Wallerstein soutient qu’il existe un seul monde où les échanges économiques permanents connectent de différentes manières les états13. Les différences et les inégalités économiques, sociales et culturelles des nations-états trouvent selon lui leur origine dans l’accumulation dissemblable du capital et du pouvoir. De ce fait, dans une économie mondiale, deux positions structurelles coexistant peuvent se distinguer : le « centre » et la « périphérie », auxquelles s’ajoute la« semi-périphérie » en tant que caractéristique de certains états ayant des activités mixtes, tant du centre comme de la périphérie.
Bien que reconnue, cette approche du système-monde a reçu des critiques, par exemple par rapport à la relation de ce paradigme avec son concept de globalisation et de commerce. Alors que pour le système-monde, la globalisation – comprise comme l’ascension d’une économie mondiale capitaliste dans les 500 dernières années – est adjacente à cette théorie, la situation mondiale actuelle correspondant à une crise structurelle du système monde, d’autres auteurs proposent une conception différente (cf. Denemark et Thomas 1988, Garst 1985, Robinson 2010), comme il est présenté postérieurement.
Toujours dans les années 1970, l’économiste Joan Robinson développa un autre regard sur les notions de développement et de « sous-développement ». Dans son livre Aspects of development and underdevelopment(1979), Robinson critiqua la rupture que pose l’enseignement occidental de l’économie entre différents aspects de la vie humaine, pour devenir plus objective et scientifique. Elle questionna le développement comme seule mesure de la croissance –spécialement le PNB, qu’avait proposé Clark–, d’abord par manque de données fiables tant dans les pays développés que dans les pays en développement, mais aussi pour leur incapacité à montrer, entre autres, les conditions de production ou les inégalités de revenu d’une population. Cette économiste proposa un cadre d’analyse différent de ceux prédominants à l’époque, pour traiter des difficultés de la pauvreté et des problèmes économiques du tiers monde14.
Développement et population
Notons encore qu´au cours des années 1970, un nouvel élément s’est ajouté aux défis du développement : la problématique de population. La planification socioéconomique des pays « sous-développés » ne pourrait avancer sans considérer leur évolution démographique et leur fécondité. Les écrits de Julian Huxley en 1950, ancien directeur de l’UNESCO, avançaient déjà le besoin urgent d’une politique de population pour chaque nation afin d’affronter les besoins croissants des populations15.Il s’agissait d’une inquiétude grandissante qui alarmait différents pays et organismes internationaux, et qui fut exprimée lors des Conférences Mondiales de la Population de Rome en 1954, de Belgrade en 1965 et de Bucarest en 1974. Mais avant cette dernière Conférence, le Fonds des Nations-Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) avait vu le jour :créée en 1969,cette institution avait pour mission la coopération en matière de population, en incluant le financement de programmes de planification familiale (Tabah 1994).
La création du FNUAP fut de ce fait le scénario de préparation de la Conférence de Bucarest, à laquelle furent invités des représentants des gouvernements pour fêter ce qui fut désigné comme l’ « Année mondiale de la population ». À cette dernière occasion, les tendances et visions des pays développés et « sous-développés » se sont confrontées sur la nécessité d’intervenir sur la fécondité des pays pauvres pour favoriser leur développement. Pour les pays développés, les taux de fécondité élevés des pays « sous-développés », notamment en Afrique et dans certains pays d’Asie, ne leur permettraient pas de sortir du « sous-développement ». La solution proposée était la planification familiale et le contrôle de la fécondité grâce à des dispositifs de contraception. À l’opposé, les pays « sous-développés » argumentaient que « le développement socio-économique est le meilleur contraceptif », en considérant leurs populations par rapport aux superficies de terres disponibles (cf. George 1975, Sala-Diakanda 1988, Tabah 1994).
Dans le « climat » mondial des années 1970, lors de la Conférence de Bucarest, deux grandes tendances se sont affrontées : les récemment nommés « pays sous-développés » ou « pays du Tiers Monde », et les pays dits développés. Pour les seconds, le contrôle familial était une des clés pour sortir du « sous-développement », alors que pour les premiers, la clé était le développement socio-économique (Sala-Diakanda 1988). C’est là une discussion qui reflète bien l’ambiance politique et économique mondiale de l’époque. Mais malgré ces oppositions, les participants à la Conférence ont réussi à s’accorder sur le projet de « Plan d’Action Mondial de la Population », proposé par les NationsUnies.
Bref, les enquêtes menées par l’ONU auprès des gouvernements africains afin de connaître les taux de croissance de la natalité de ces pays vers la fin des années 1970 et au début des années 1980, ont montré des changements d´orientations dans les politiques de traitement de la fécondité. Alors que plusieurs gouvernements africains stimulaient une politique d´augmentation des taux de fécondité, à partir centres de recherche comme le CEPED20 (Centre Population et Développement), le CEFMR21(Central European Forum for Migration and Population Research), ou le CIS22(Center for Inmigration Studies).
Les analyses des migrations internationales se sont focalisées sur les migrants eux-mêmes, sur leurs pays d’origine et les pays de destination, ainsi que sur les transformations sociopolitiques, culturelles et économiques qu’elles ont impliquées. Différents genres d’actions et d’études ont été menés, dont il faut souligner trois :en premier lieu, les études qui ont montré comment, dans plusieurs cas, les migrations ont signifié un « développement » économique des lieux d’origine, principalement grâce aux transferts d’argent des migrants ;en deuxième lieu, les études qui au contraire, ont souligné les difficultésdes migrants à s’insérer dans les nouvelles sociétés, tel le paradoxe de l’« American Dream » ;enfin, les études qui se sont centrées sur les conditions de vie des migrants dans les endroits de destination, spécialement sur les possibilités de travail, l’accès à la santé, à l’éducation et à la protection sociale en général (cf. Charbit et Feld 2008).
En résumé, surtout à partir des années 1970, la question de la population est aussi devenue centrale pour le développement. La croissance démographique, la fécondité et les migrations sont des problèmes qui se sont ajoutés à ceux de la croissance économique et de la « dépendance » des « sous-développés ». Problèmes qui seront désormais présents dans les programmes, les études et les actions de développement.