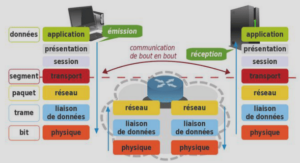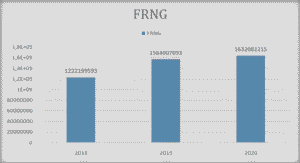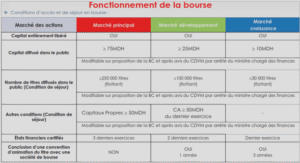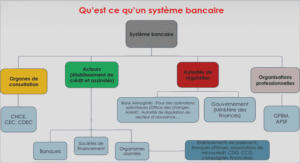La performativité du genre et la subversion de l’identité
Certains théoriciens comme Judith Butler ont observé que la détermination du sexe social n’est pas forcément calquée sur le sexe biologique et que certaines personnes transcendent les catégories de mâle et de femelle. Butler envisage le genre à la fois comme une norme et comme une performance, c’est-à-dire comme un ensemble de codes idéaux qui, reproduits de façon répétée, contraignent le comportement des individus, qu’ils soient hommes ou femmes. L’idée développée par Butler (2005) est que l’on n’est pas homme ou femme mais qu’on performe son genre, qu’on joue à être du sexe masculin ou du sexe féminin. Le genre, l’identité sexuelle, seraient donc le résultat d’une construction sociale. Butler (2006:8) nous apprend que, si les normes de genre sont des structures idéales qui, par un effet de répétition, conditionnent nos comportements, elles sont également fragiles et soumises à une possible « déconstruction ». S’interrogeant quant aux normes de genre, de sexe et même de race, la philosophe américaine s’attache à comprendre ce qui fait de nous des sujets et dans quelle mesure on peut « défaire » les normes de genre. Ainsi, Butler constate qu’il existe des individus qui jouent à être d’un sexe qui n’est pas le leur : c’est le cas des individus « queer »7 dont font partie par exemple les homosexuels et les travestis. Butler nous apprend que, si les normes de genre sont des structures idéales qui, par un effet de répétition, conditionnent nos comportements, elles sont également fragiles et soumises à une possible remise en question. Butler invite chacun à interroger et à utiliser les normes qui se donnent à nous pour mieux en révéler et en subvertir les limites.
La mimésis
Luce Irigaray est une philosophe féministe qui prone une émancipation de la femme par le biais d’une valorisation et d’une réappropriation de la subjectivité féminine. Il est question de s’affirmer en tant que femme, de prendre la parole comme femme, du lieu même de la condition féminine, afin de donner forme à la « nature » qui a été occultée ou maîtrisée dans le discours masculin dominant. Pour Irigaray, la reconnaissance de la différence sexuelle est fondamentale pour « démonter » le discours masculin sur la féminité et pour que le féminin puisse s’affirmer comme sujet. La femme doit passer de la position d’objet du discours (telle que l’ordre patriarcal la représente et à quoi elle la réduit) à une position de sujet du discours.
A la différence de Butler (2005) qui appelle à une « déconstruction » du genre – qu’il soit féminin ou masculin – Irigaray propose une forme de réappropriation du féminin par les femmes à l’intérieur même de leur genre, sans forcément chercher à subvertir ce dernier (comme le souhaite Butler). Irigaray considère en effet que la subjectivité féminine n’ayant jamais été réellement prise en compte par le système symbolique patriarcal, il ne serait pas approprié de la déconstruire. Pour que la femme puisse s’affirmer en tant que sujet dans le discours phallocrate, Irigaray (1977) propose la stratégie de la « mimésis » ou mimétisme délibéré. Irigaray (1977:74) conseille aux femmes de se mettre volontairement en phase avec les rôles et les attributs qui leur ont été historiquement assignés par l’ordre patriarcal, ceci dans une intention de confirmation de leur subordination, et pour être en position de la remettre en question : Jouer de la mimésis, c’est donc, pour une femme, tenter de retrouver le lieu de son exploitation par le discours, sans s’y laisser simplement réduire. C’est se resoumettre […] à des idées, notamment d’elle, élaborées dans/par une logique masculine, mais pour faire « apparaître », par un effet de répétition ludique, ce qui devrait rester occulté.
Nous tenterons d’appliquer les théories de Butler et d’Irigaray à nos personnages afin d’examiner jusqu’à quel point les normes hétérosexuelles peuvent être contournées et même dans certains cas subverties pour rendre au sujet sa liberté intrinsèque.
Le cas de l’androgyne
Le mythe de l’androgyne est présent dans de nombreuses cultures, comme nous le présente Badinter (1992:240-246). La philosophe (1992:240) définit l’androgyne comme un être à « la dualité intégrée et alternée ». Pour Badinter (1992:243), « l’androgyne est l’achèvement d’un processus, […] c’est la réconciliation avec sa féminité qui définit le véritable androgyne. » De façon complémentaire, Boff (2002:185) souligne que l’androgyne réunit en lui le masculin et le féminin et, qu’à ce tire, il pourrait représenter le cas de l’être humain parfait parce que complet.8
Faerber (2005:52-53), qui a analysé le thème des différences sexuelles dans L’Amant de laChine du Nord, estime qu’il existe dans les écrits de Duras la présence d’un « sexe comme hors-genre, comme dégénéré, sorti de lui, non répertorié […] ». Ce « troisième sexe durassien », comme le nomme Faerber (2005:57), « dessine et désigne un genre à part entière, un genre sexuel qui tente de s’incarner […] ». Ces théories nous aideront à mettre en lumière le cas du personnage du Chinois dont nous tenterons de définir la masculinité.
L’individu et la sexualité
La sexualité au féminin et au masculin
D’après ce que nous explique Boff (2002:135), la réalité de la femme se définirait et s’exprimerait par son corps et l’image qu’elle s’en fait9. Ainsi, la femme se définirait par sa capacité à accéder à la jouissance et à l’inverse, la sexualité vécue par l’homme serait limitée10. La sexualité « localisée », c’est la référence à la toute puissance du phallus dans la société patriarcale (Badinter, 1992 :200), tandis que le corps saturé de sexualité expliquerait la jouissance multiple dont serait capable la femme. L’homme, pour être en accord avec ce que la société attend de lui, serait coupé de son corps, coupé en deux et donc privé de l’accès total à sa libido :
Le système patriarcal a accouché d’un homme mutilé incapable de réconcilier X et Y, son héritage paternel et maternel. […] Depuis une quinzaine d’années, les Men’s Studies ont noté l’étroite relation entre la masculinité et le refoulement massif d’une partie de soi. […] Le résultat est un homme décomposé, fragmenté […] (Badinter 1992 :181-182)
Pour Badinter (1992 :205), la sexualité masculine déterminée par le phallocentrisme est réductrice :
L’homme ne sait pas jouir : coincé entre sa peur de se laisser aller et son utilisation du phallus comme moyen d’appropriation, il a une sexualité bloquée, triste, qui ignore bien des plaisirs, parce que soumise au diktat du génital.
C’est également la théorie défendue par Boff (2002:157), qui illustre la différence essentielle entre homme et femme par une réflexion concernant leur rapport au corps : l’homme est le corps qui sublime, qui surcompense pourrait-on aussi dire, en raison de son moi divisé et de sa peur profonde de la mort ; la femme, elle, est au contraire le corps qui jouit, qui contre-sublime (en d’autres termes qui érotise tout), y compris les situations non corporelles11.
Nous tenterons d’analyser le comportement érotique des deux personnages à la lumière de ces théories sur la sexualité humaine.
L’érotique solaire
Le philosophe Michel Onfray (2006:156) est à l’origine d’un concept appelé « érotique solaire », applicable dans le cadre d’un « contrat hédoniste » entre deux personnes : L’érotique solaire s’appuie sur une formidable volonté de jouissance dont le principe axiomatique suppose un grand oui à l’existence, un double et mutuel consentement immédiat aux forces qui nous travaillent et menacent débordement.
Onfray s’appuie sur la notion de l’hédonisme (corporel) – qu’il emprunte aux cyrénaïques, pour qui la notion de plaisir est plus une vertu qu’une honte – attirant notre attention sur son côté éthique et moral : « […] l’éthique libertine aspire à un sévère évitement des déplaisirs tout autant qu’à une impérieuse réalisation des plaisirs. » (Onfray 2000 :171). Cette démarche hédoniste rejette totalement la conception judéo-chrétienne qui basait autrefois la sexualité sur une idée de péché et de non-jouissance, dans un but unique de procréation. Pour Onfray (2006 :150), « la logique catholique » a crée « l’inverse d’une érotique » par le biais d’une invention, celui du « mythe du désir comme manque ». Ce postulat12 se fonde sur la volonté imposée de complétude entre deux êtres, chacun étant supposé chercher son autre moitié en basant son désir d’autrui sur une idée de vide et de manque :
• Le désir comme manque et le plaisir en comble de ce manque, voilà l’origine du malaise et de la
misère sexuelle. » (2006:151). Onfray (2006:157) dénonce les dogmes de l’Eglise qui a consenti à
• une sexualité uniquement dans le cadre familaliste, monogame, consacrée par le mariage chrétien. » Il réfute « l’encagement du désir », une hérésie selon lui, puisque le désir est « libertaire et nomade par essence » (2006:158). A cela, il oppose la proposition d’une « libido libertaire » (2006 : 161) dans le cadre de laquelle « le désir n’est pas manque, mais excès qui menace débordement. » (2006:151-152).
11”El hombre sublima y la mujer, podríamos decir, contra-sublima, es decir erotiza. El cuerpo que sublima es el cuerpo fragmentado, el yo dividido. Para él, el amor que salva es el único que queda, el amor de sí. El cuerpo que sublima se esculpe en solitario, mientras el que goza, en la unión con el otro. El cuerpo que sublima construye el mundo porque tiene miedo a la muerte. El cuerpo que goza no huye de la muerte, la acepta, […] es capaz de morir para vivir plenamente.”
Du point de vue d’Onfray (2006:168), l’érotisme « solaire » est une sublimation de l’acte charnel et donc le contraire d’une sexualité brute et animale : « La culture érotique travaille le sexe naturel pour produire des artifices éthiques. » Il doit se pratiquer dans le cadre bien défini d’un « pacte érotique » dont le contenu serait le suivant : « […] une perspective érotique ludique, une combinatoire amoureuse, un assemblage destiné à durer, un engagement d’un soir ou d’une vie, chaque fois une relation sur mesure.» (2006:170). La pensée d’Onfray nous permettra d’analyser plus spécifiquement la nature de l’érotisme dans l’écriture durassienne.