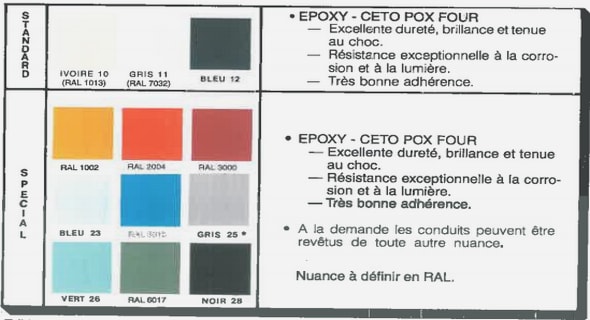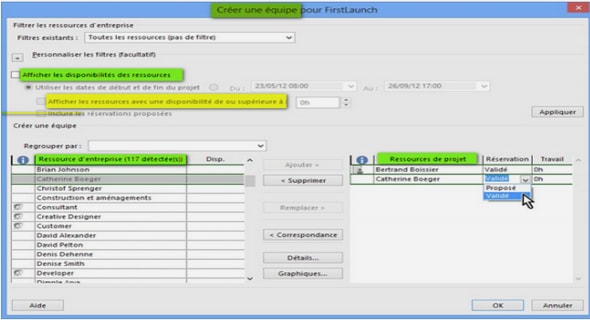Les systèmes d’information de marché (SIM)
Dans les pays en développement, les SIM ont été introduits dans le cadre des politiques de libéralisation, au cours des années 1980. Ce sont des dispositifs d’information qui visent à améliorer les capacités de négociation de petits producteurs ainsi que les orientations stratégiques des institutions publiques et privées .
Il existe deux générations de SIM. Les SIM de Première Génération ou SIM1G présentaient de nombreuses caractéristiques communes : la couverture d’une seule catégorie de produits, une focalisation quasi-exclusive sur les prix, une diffusion à l’échelle nationale, via la radio, un rattachement à des structures publiques telles les ministères de l’agriculture et un financement dans le cadre de projets de développement. Les SIM de Deuxième Génération ou SIM2G sont apparus à la fin des années 1990. Ces SIM2G sont caractérisés par un usage intensif des Technologies de l’Information et de la Communication ou TIC à la fois pour leur fonctionnement interne, la transmission de l’information entre les agents chargés de la collecte et pour la diffusion de l’information aux acteurs publics et privés, via la téléphonie mobile et Internet.
Les fondements théoriques des SIM
Le principe des SIM se fonde sur la base de la théorie néoclassique : la « transparence des marchés » qui figure parmi les cinq conditions de la « concurrence pure et parfaite ». Selon SHEPPERD (1997) cité par DAVID-BENZ (2013), les prix devraient constituer les principaux indicateurs qui guident les décisions individuelles et incitent les producteurs à ajuster leur production à la demande. Diffuser de l’information sur les prix permet donc d’intensifier la concurrence et d’améliorer la transparence du marché.
Mais selon WILLIAMSON (1985), le prix n’est pas le seul déterminant des décisions. En effet, les marchés agricoles sont caractérisés par un fort niveau d’incertitude qui conduit à adopter différentes formes d’arrangements institutionnels, qui vont à leur tour influer sur les conditions de transactions. Ceci a été mis en évidence dans le cadre d’analyse de l’économie institutionnelle et de celle des organisations.
Quelques exemples de SIM à Madagascar
Quelques SIM existent à Madagascar. On cite l’Observatoire du Riz ou OdR qui existe depuis 2005. Il assure un suivi hebdomadaire des prix du riz ainsi que des principaux produits vivriers et des Produits de Première Nécessité ou PPN, depuis 2009. Ensuite, le Bazar Mada qui a été développé par le PPRR1/FIDA2. C’est le premier SIM à Madagascar à avoir intégré le téléphone mobile comme outil de diffusion. Il y a également le Service d’Information Economique des Légumes (SIEL) qui est centré spécifiquement sur les légumes et associant l’information à de l’appui-conseil plus général apporté par FERT3 aux producteurs. Il existe aussi le Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et la Vulnérabilité ou SISAV par FAO et CITE .
Approche par les Moyens d’Existence Durable (AMED)
Conçue à l’origine dans les années 1980, dans le contexte des systèmes d’exploitation agricoles, de recherche et d’éducation, l’Approche par les Moyens d’Existence Durable ou AMED a été développée dans les années 1990 par le Departement For International Developement ou DFID (NEELY et al., 2004). Elle s’appuie sur les principaux facteurs influençant ces moyens d’existence et sur les liens qui unissent habituellement ces facteurs.
Selon LAWANI (2007), les moyens d’existence regroupent les capacités, les biens et les activités nécessaires aux individus pour assurer leurs besoins de base et pour atteindre leur bien-être. Il mentionne que les moyens d’existence sont durables, lorsqu’ils permettent de s’adapter aux difficultés, de faire face à l’adversité, et de conserver ou améliorer les capacités et biens, tant dans l’immédiat qu’à l’avenir, sans pour autant compromettre la base de ressources naturelles. L’AMED peut servir à la fois à la planification de nouvelles activités de développement et à l’évaluation de la contribution des activités existantes à la durabilité des moyens d’existence. Les stratégies de survie sont représentées par la manière dont les individus combinent et utilisent leurs capitaux pour atteindre leurs objectifs ou arriver au résultat escompté.
Table des matières
INTRODUCTION
1 CONCEPT ET ETAT DE L’ART
1.1 Les systèmes d’information de marché (SIM)
1.1.1 Définition
1.1.2 Les fondements théoriques des SIM
1.1.3 Quelques exemples de SIM à Madagascar
1.2 Approche par les Moyens d’Existence Durable (AMED)
2 MATERIELS ET METHODES
2.1 Délimitation de l’étude
2.1.1 Localisation de la zone d’étude
2.1.2 Choix du thème
2.1.3 Choix du site
2.2 Démarches méthodologiques
2.2.1 Démarches communes aux hypothèses
2.2.1.1 Revue bibliographique
2.2.1.2 Elaboration du questionnaire
2.2.1.3 Phase de recueil des données
a. Enquête préalable semi-directe
b. Observations
c. Enquête directe et focus group
2.2.1.4 Choix de l’échantillonnage
2.2.1.5 Phase de traitement des données
2.2.2 Démarches spécifiques de vérification de chaque hypothèse
2.2.2.1 Démarches spécifiques de vérification de l’Hypothèse 1 : « Les pratiques et stratégies de commercialisation du riz diffèrent d’une zone à une autre selon les caractéristiques des exploitations agricoles et les contraintes liées à l’environnement »
a. Variables
a. Outils d’analyse
2.2.2.2 Démarches spécifiques de vérification de l’Hypothèse 2 : « Les caractéristiques de l’exploitation agricole, les stratégies de vente adoptées et les contraintes liées au manque d’infrastructures influencent la performance commerciale du producteur »
a. Variables
b. Traitements correspondants
Régression de la variable PERF
Modélisation
2.2.2.3 Démarches spécifiques de vérification de l’Hypothèse 3 : « L’information brute sur le prix ne constitue pas le seul type d’information dont les producteurs ont besoin et les canaux de diffusion adaptés dépendent des dotations en différents types de capitaux »
a. Variables
b. Traitements correspondants
2.3 Limites de l’étude
2.4 Chronogramme des activités
3 RESULTATS
3.1 Contraintes, pratiques et stratégies de commercialisation des producteurs
3.1.1 Caractéristiques des exploitations agricoles
3.1.2 Contraintes liées à la commercialisation
3.1.3 Pratiques et stratégies de commercialisation
3.1.3.1 Comparaison entre deux zones selon le degré d’enclavement
3.1.3.2 Comparaison des exploitations agricoles selon les dotations en capitaux
3.2 Facteurs influençant la performance commerciale du producteur
3.2.1 Variables significatives
3.2.2 Modèle de la performance commerciale du producteur
3.3 Typologie des producteurs par rapport à leur intérêt pour le SIM
3.3.1 Résultats de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et du K-means ou nuée dynamique
3.3.2 Résultats de l’Analyse Factorielle Discriminante (AFD)
3.3.2.1 Points communs des trois groupes
3.3.2.2 Caractéristiques de chaque groupe
a. Producteurs d’âge moyen
b. Jeunes producteurs
c. Producteurs d’âge mûr
4 DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
4.1 Discussions
4.1.1 Pratiques et stratégies de commercialisation des producteurs
4.1.1.1 Caractéristiques des exploitations agricoles
4.1.1.2 Contraintes de commercialisation
4.1.1.3 Pratiques et stratégies de commercialisation
a. Vente individuelle
b. Accès à l’information du marché
c. Lieu et période de vente
d. Types d’acheteurs
e. Relations amont/aval
4.1.2 Facteurs influençant la performance commerciale du producteur
4.1.2.1 Pratiques et stratégies de commercialisation
4.1.2.2 Contraintes à la commercialisation
4.1.2.3 Accès aux informations
4.1.2.4 Variables non significatives
4.1.3 L’intérêt des producteurs pour les SIM
4.1.3.1 Dotations en capitaux
4.1.3.2 Informations prioritaires
a. Contacts des acheteurs et prix dans les zones de production
b. Prix dans les marchés de consommation
c. Quantités dans les zones de production
d. Mode de diffusion préférée
4.2 Recommandations
4.2.1 Pratiques et stratégies de commercialisation
4.2.1.1 Inciter les producteurs à se regrouper au sein des OP
4.2.1.2 Renforcer la capacité des OP
4.2.1.3 Promouvoir le warrantage ou GCV et faciliter son accès au niveau des IMF
4.2.1.4 Améliorer les infrastructures
4.2.2 Facteurs influençant la performance commerciale des producteurs
4.2.2.1 Améliorer l’accès aux informations des producteurs
4.2.2.2 Réglementer la commercialisation du riz
4.2.3 Intérêt des producteurs pour les SIM
4.2.3.1 Diversifier les informations
4.2.3.2 Combiner les TIC avec les canaux traditionnels
4.2.3.3 Diffuser de l’information fiable à temps
4.2.3.4 Intégrer les OP dans la diffusion des informations
4.2.3.5 Fournir des services d’accompagnement
4.2.3.6 Combiner l’approche « push » et l’approche « pull »
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
Annexe I : Les Système d’Information du Marché à Madagascar
Annexe II : Questionnaire d’enquête sur les producteurs
Annexe III : Comparaison des stratégies des producteurs entre la zone Ouest et Est de Bealanana
Annexe IV : Comparaison des stratégies des producteurs selon leurs dotations en capitaux
Annexe V : Résultats de vérification de l’hypothèse 2
Annexe VI : Résultats de la vérification de l’hypothèse 3