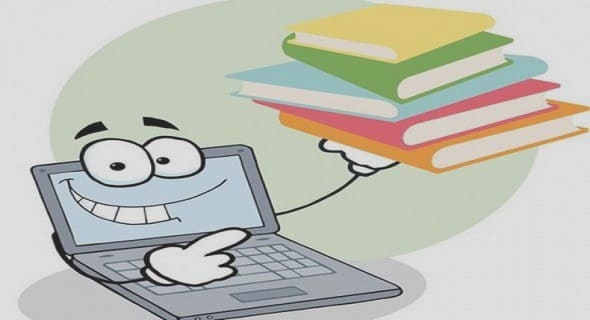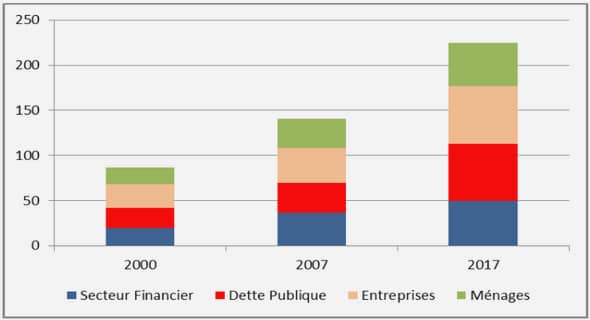Définition du semi intensif amélioré
Une exploitation semi intensive est d’abord, le dérivé des techniques développées en Amérique latine. L’élevage se pratique en bassins en terre de grandes dimensions (plusieurs hectares dans notre cas, ici, 4 Ha), alimentés quotidiennement par un canal d’alimentation d’eau de mer, lui-même connecté à une station de pompage. Les renouvellement d’eau journaliers atteignent 15 à 20% du volume total d’un bassin. Les densités d’élevage varient entre 5 à 15 crevettes par m2, en fonction des conditions environnementales. Les crevettes reçoivent une alimentation complémentaire, sous forme de granulé spécifiquement adapté à leurs besoins nutritionnels. Les rendements se situent entre 2 et 4 tonnes par hectare et par an et le poids des crevettes va de 15 à 35g. Les limites du système sont en grande partie liées aux possibilités de changement d’eau et par conséquent au maintien d’un milieu le plus adapté aux animaux (oxygène, pH …) .
Les procédures d’exportation des crevettes
Pour l’exportation, on doit adresser un dossier au ministère du commerce, en vue d’obtenir une carte d’exportation. Ce dossier doit contenir une demande manuscrite mentionnant le lieu de naissance et la nationalité de l’exportateur, la date de création de la société, sa raison sociale, son siège et son numéro au registre du commerce, la date d’arrivée au lieu de résidence pour les étrangers, et l’engagement de respecter les prix, la norme, les caractéristiques et mode de conditionnement prévu par la réglementation du commerce . Toute exportation nécessite un avis ou une autorisation visée par la direction du commerce extérieur : cet avis doit être domicilié auprès d’une banque. Les trois procédures suivantes incombent à l’exportateur en matière d’exportation des crevettes à savoir : la domiciliation bancaire, le respect de la procédure d’embarquement, l’embarquement.
Définition de la gestion budgétaire d’investissement
La décision d’investir se traduit dans la plupart des situations par une sortie de fond dont l’entreprise attend une rentabilité ; cela suppose des risques.
En effet, lors de la prise de décision, les rentrées ne sont que prévisionnels, et dépendent entièrement de l’évolution de l’environnement. L’opportunité de l’investissement doit donc faire l’objet d’étude précise et attentive par les fonctions concernées dans l’entreprise.
L’objectif est de faire apparaître les flux net de trésoreries en comparant recettes, dépenses et éventuellement les modes de financement.
Le coût des investissements On distingue, 5 composantes de l’investissement à savoir : le coût de terrain ; le coût de construction ; le coût de matériel ; le coût d’installation et le frais d’établissement.
Le compte de résultat
L’étude du compte de résultat consiste à analyser l’origine du résultat. Le compte de résultat ou le compte d’exploitation prévisionnelle est un document comptable de synthèse.
Ce document est une récapitulation : de tous les produits engendrés par l’activité de l’entreprise au cours d’une période comptable ; de toutes les charges également suscitées par cette activité au cours de la même période.
En bref, le compte de résultat peut se définir comme un état financier où sont virés les soldes des comptes de produit et de charge, à la fin d’un exercice comptable, pour déterminer la perte ou le bénéfice net de la période en question.
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET
SECTION I : Généralités sur le projet
1.1-Historique
SECTION II : Caractéristiques du projet
2.1-Le choix du projet
SECTION III : L’Environnement et la description de la région
CHAPITRE II : LA TECHNIQUE DE PRODUCTION ET ETUDE DE MARCHE
SECTION I : Technique de production, et système d’exploitation
1.1-Evolution
SECTION II : Le mode de commercialisation
2.1- les procédures d’exportation des crevettes
SECTION III : Etude de marché
3.1- Appréciation sur le marche internationale de crevette
3.2- Marche international
3.4- Analyse de l’offre et de la demande
CHAPITRE III : ETUDE ORGANISATIONNELLE ET IMPACT DU PROJET SUR L’ECONOMIE NATIONALE
SECTION I : Etude organisationnelle
1.1- Organigramme de l’entreprise
1.2- Définition de l’organigramme
1.3- Comment construire un organigramme ?
SECTION II : Description des principales fonctions du personnel
2.1- Les tâches et les fonctions
2.2-Composition de l’effectif
2.3-Explication des catégories professionnelles
SECTION III : Impact du projet sur l’économie de Madagascar
3.1- Analyse économique
3.2- Impact de la crevetticulture sur le PNB
CHAPITRE I : LES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
SECTION I : Les investissements
1.1-Définition de la gestion budgétaire d’investissement
Le coût d’achat de matériel de communication et informatique
SECTION II: Les amortissements
2.1-Définition de l’amortissement
SECTION III : Financement du projet et le fond de roulement
3.1-Financement du projet
3.2- Le fonds de roulement
3.3-Les bilans
CHAPITRE II : L’EVALUATION DE LA RENTABILITE
SECTION I : Le compte de résultat
1.1- Définition
1.2-Intérêt du compte de résultat
SECTION II : Le compte de résultat par nature
2.1-Définition du compte de résultat par nature
2.2-Tableau du compte de résultat par nature
SECTION III : Etude d’impact environnemental
3.1-Définition de l’impact environnemental
3.2-Déstruction de la nature
CHAPITRE III:LES RATIOS DE GESTION
1.1-Définition du cash-flow
1.2-Formule du cash-flow
SECTION I : LA VALEUR ACTUELLE NETTE
2.1-Définition de la valeur actuelle nette
2.2-Formule de la valeur actuelle nette
SECTION II : Le délai de récupération
2.1-Définition du délai de récupération
2.2-Formule du délai de récupération
SECTION III : Indice de profitabilité
3.1-Définition de l’indice de profitabilité
3.2-Formule de l’indice de profitabilité
CONCLUSION