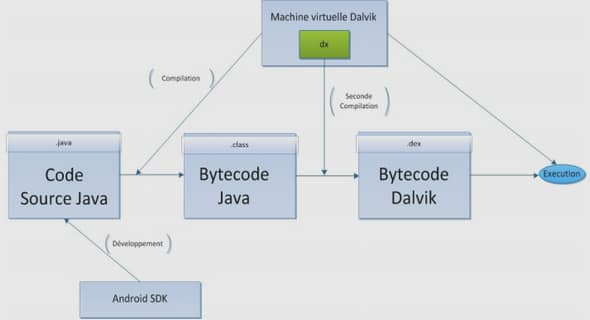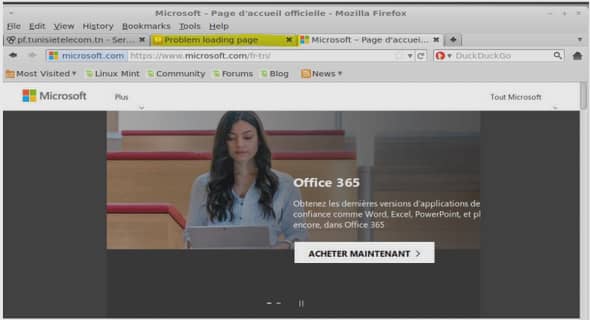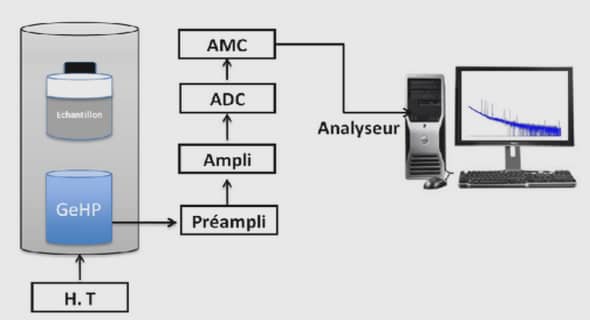Contexte de l’expérience naturelle de Dunkerque : le tarif éco-solidaire
Les chapitres 1 et 2 de cette thèse s’appuient sur la même expérience tarifaire naturelle menée à Dunkerque. En 2012, l’opérateur « Eau du Dunkerquois », délégataire de service public (privé), a mis en place, à l’initiative des élus, une tarification dite éco-solidaire » sur son territoire. Il est à noter que, dans l’agglomération, les élus sont très innovants en matière de tarification des services publics, puisqu’ils expérimentent, par exemple, la gratuité des transports publics. Avant cette date, l’opérateur facturait l’eau potable domestique avec un tarif binôme sans modulation de la part variable.
Le tarif éco-solidaire est donc un tarif progressif discriminant de degrés 2 et 3, qui discrimine en fonction de la quantité achetée et du type d’usager en prévoyant une tarification sociale. Ce mécanisme est singulier puisqu’il intègre deux dimensions, sociale et environnementale, explicites qu’il réalise par l’instrument tarifaire. En ce sens, le tarif de Dunkerque est plus sophistiqué que celui d’autres collectivités qui ont opté pour une discrimination tarifaire de degré 2 uniquement. L’introduction du tarif éco-solidaire a nécessité, au préalable, d’installer des compteurs individuels dans tous les foyers et d’individualiser la facture.
Les propriétés incitatives du tarif sont assurées par la progressivité croissante par blocs à trois tranches. Les consommateurs risquant un saut de tranche devraient être incités à limiter leur consommation pour éviter de changer de prix marginal. Les propriétés redistributives sont assurées par deux mécanismes. Le système de tranche, d’abord, permet d’organiser une redistribution entre les déférentes catégories de consommateurs (les « petits », les « moyens » et les « gros ») soumis au même tarif.
Ensuite, la tarification sociale (discrimination de degré 3) organise la redistribution entre les consommateurs standards et les consommateurs éligibles sur critère social. Il est important de préciser que ce tarif social est attribué automatiquement aux bénéficiaires de la CMU-C11 (couverture maladie universelle), sans démarche de leur part. En effet, la loi a permis aux opérateurs d’accéder aux données de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour constituer son tarif social. Le prix de l’abonnement n’a pas été modifié par le nouveau tarif.
Stratégie empirique
Dans ce chapitre, nous utilisons un panel constitué par le Syndicat de l’Eau du Dun-kerquois pour piloter l’expérimentation tarifaire. Il s’agit d’un panel représentatif de la population des 22 communes membres du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois qui permet de suivre environ 1387 foyers de 2010 à 2013. Nous disposons de plusieurs variables comme : la consommation annuelle (en m3), la taille du foyer, la localisation ou encore le type d’habitation.
La stratégie empirique consiste à déterminer l’impact du changement de tarif sur la consommation des ménages. Pour ce faire, nous utilisons un modèle en double-différence et de régression linéaire avec effets individuels aléatoires pour évaluer économétriquement cet effet.
Quatre propositions sont testées dans ce chapitre. Une première proposition considère un effet négatif d’un tarif progressif sur la consommation globale, suivant les résultats obtenus par d’autres auteurs (cf Grafton et al. [2011] et Montginoul and Alexandre [2014] par exemple). La deuxième proposition assume que les consommateurs réagiraient différemment selon leur type. Les petits consommateurs devraient plutôt augmenter leur consommation, tandis que les gros consommateurs devraient la réduire.
Troisièmement, une proposition considère à partir des éléments de la lit-térature (Renwick and Archibald [1998]) que les consommateurs sociaux devraient consommer plus avec le nouveau tarif. Enfin, une quatrième proposition considère que la taille du foyer aurait un impact sur la capacité des consommateurs à réagir au changement de prix.
Résultats principaux et implications
Au global, l’introduction du nouveau tarif a réduit d’environ 10 % la consomma-tion entre 2012 et 2013, corroborant le fait que les tarifs progressifs ont un impact négatif sur la consommation. Toutefois, les petits consommateurs -ceux qui sont dans la 1ère tranche- ont augmenté leur consommation d’environ 11 %, alors que les plus gros consommateurs l’ont diminuée de 12,8 %. Les consommateurs moyens, quant à eux, ont réduit leur consommation, mais moins fortement que les plus gros consommateurs.
Concernant les consommateurs bénéficiaires des tarifs sociaux, leur consommation a augmenté suite à l’introduction du nouveau tarif. Or, ces consommateurs à Dunker-que avaient des moyennes de consommation inférieures aux autres consommateurs avant le tarif éco-solidaire. L’introduction du nouveau tarif a donc permis un effet de rattrapage pour ces consommateurs, ce qui valide le caractère redistributif du tarif éco-solidaire de Dunkerque.
Enfin, nous observons que la taille du foyer semble jouer fortement sur la capacité des ménages à réagir au signal-prix. En effet, plus le foyer est grand, et moins il réagit aux changements tarifaires. Pourtant, ces ménages sont les principaux perdants du nouveau tarif puisque le design tarifaire repose sur des tranches pré-définies pour un ménage « moyen ». Dès lors, les seuils ne sont plus adaptés à des familles nombreuses qui vont se retrouver dans la catégorie des gros consommateurs sans pouvoir réduire leur consommation. Cette situation a conduit l’opérateur a introduire un « chèque eau » à la demande pour les familles nombreuses. Cependant, seules douze familles l’ont effectivement réclamé. Ce faible recours au chèque-eau permet de dire que le tarif reste distorsif pour la quasi totalité des grandes familles.
Ces résultats indiquent que, d’une part, les consommateurs ont réagi au changement tarifaire et qu’il y a eu une baisse de la consommation globale. Les propriétés incitatives, au niveau global, semblent bonnes pour le tarif éco-solidaire. En revanche, dans le détail, nous constatons d’importantes distorsions entre les foyers. Le caractère uniforme du design des tranches induit fatalement une inadaptation à tous les types de ménages. Ceci devrait conduire, soit à des mécanismes complexes de redistribution ex post, comme le chèque eau, soit à une meilleure individualisation des tranches (avec toute la complexité que cela peut induire…).
A partir de cette première étude qui analysait l’impact « avant/après » de la mesure sur la consommation, nous avons voulu approfondir la question du comportement des consommateurs et de sa rationalité face à de nouvelles structures tarifaires. Cette question fait l’objet du chapitre 2.
Tarifs discriminants et monopoles de l’eau potable : une analyse économique du comportement de consommation
Motivation et contexte
Le chapitre 2 de cette thèse s’inscrit dans le prolongement du chapitre 1 en analysant sous un angle différent l’efficacité du tarif éco-solidaire. Il s’agit de se concentrer sur la dimension comportementale de la demande d’eau potable face à ce nouveau tarif plus complexe. Comme nous l’avons montré précédemment, plusieurs études empiriques ont mis en évidence la rationalité limitée des consommateurs face au signal-prix.
Dans l’électricité, particulièrement, Ito [2014] trouve que les consommateurs réagissent davantage au prix moyen qu’au prix marginal, contrairement à la prédiction de la théorique économique supposant une parfaite rationalité. C’est la raison pour laquelle des auteurs, comme Crampes and Lozachmeur [2014], ont mis en évidence une double problématique avec les tarifs progressifs. D’une part, leur mise en œuvre implique d’accepter certaines distorsions entre consommateurs en raison de l’incapacité des monopoles à discriminer parfaitement. D’autre part, la réaction des consommateurs étant incertaine, l’efficacité du mécanisme s’en trouve amoindrie, puisqu’elle repose sur la capacité de la demande à s’ajuster aux change-ments de tranches.
Notre question de recherche est la suivante : quelles sont les conditions d’efficacité d’un tarif progressif dans le cas de l’eau potable ? Pour répondre à cette question, nous réutilisons l’expérience naturelle menée à Dunkerque pour montrer, d’abord, les déterminants théoriques de l’efficacité d’un tarif progressif, et déterminer, ensuite, le comportement des consommateurs et son incidence sur l’efficacité du dispositif.
Stratégies théorique et empirique
Dans un premier temps, ce chapitre propose une extension du modèle de Crampes and Lozachmeur [2014] pour le rendre applicable au tarif éco-solidaire de Dunkerque qui est un tarif progressif à trois tranches. Cette modélisation théorique permet de faire ressortir les principaux points d’attention pour déterminer l’efficacité du mé-canisme : les élasticités des différentes catégories de consommateurs, d’une part, et le poids relatif des différentes catégories de consommateurs, d’autre part. En effet, un tarif progressif va supposer des transferts plus ou moins importants entre ceux qui vont bénéficier d’une réduction de prix et ceux qui vont devoir payer plus pour compenser cette perte pour le monopole.
A partir de ce modèle, nous formulons plusieurs propositions testables autour du comportement des consommateurs face au signal-prix. En principe, la rationalité parfaite impliquerait une réaction au prix-marginal, tandis qu’un comportement sous-optimal conduirait à réagir au prix moyen. En fonction de ce résultat, nous pouvons faire plusieurs propositions sur le caractère distorsif du tarif progressif de Dunkerque.
Dans un deuxième temps, la stratégie empirique de ce chapitre réutilise principalement le panel de Dunkerque pour calculer économétriquement les élasticités des différents types de foyers, compte tenu du changement de prix. De ces résultats, nous pouvons ensuite calculer l’efficacité du dispositif en utilisant les données du fichier client sur les consommations réelles pour simuler l’évolution des recettes du monopoles et en déduire des éléments sur les transferts de recettes.
Résultats principaux et implications
Le tarif de Dunkerque visait deux objectifs : inciter à réduire la consommation en ciblant celle des plus gros consommateurs et organiser une redistribution entre usagers. Au terme de ce chapitre, nous retrouvons empiriquement les effets dis-torsifs présentés dans la modélisation théorique, puisque pour un gain marginal de 0.17E/m3 sur la tranche 1, il faut « générer une perte » de 0.55E/m3 sur la tranche 2 et de 1.06E/m3 sur la tranche 3. Cet écart de prix important semble justifié par les élasticités différentes que nous retrouvons pour les groupes de consommateurs : les gros consommateurs ont une élasticité plus forte que les petits consommateurs (différentiel de 0.20).
Autrement dit, le tarif de Dunkerque crée une distorsion im-portante au détriment des gros consommateurs pour récupérer les pertes réalisées sur la tranche 1. De plus, ces distorsions tarifaires conduisent à une augmenta-tion des recettes globale avec le nouveau tarif, au détriment principalement des gros consommateurs qui supportent une grande partie du coût de la mesure. Plus largement, l’équité de ce dispositif est discutable en s’inscrivant dans la continuité des critiques de Crampes and Lozachmeur [2014] et Mayol [2017] sur cette question.
Il ressort également comme résultat principal que les consommateurs situés dans les tranches extrêmes (petits et gros consommateurs) ont bien réagi au prix marginal. En revanche, les consommateurs intermédiaires, pour qui la facture globale n’a pas évolué (prix moyen quasi identique), n’ont pas réagi à la variation du prix marginal. Ce résultat suggère que les consommateurs réagissent de manière d’autant plus optimale que leur gain (ou perte) est importante. Il est à noter qu’une explication possible de ce comportement optimal serait l’effort important de pédagogie de l’opérateur (notamment par un simulateur de facture et des suggestions de changements de comportements) pour aider les consommateurs à faire des choix.