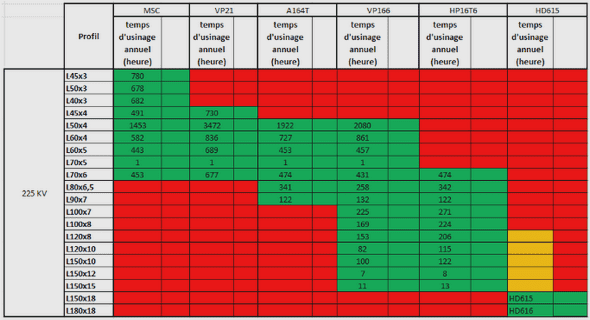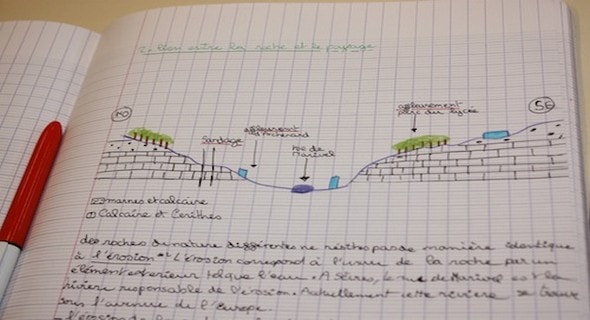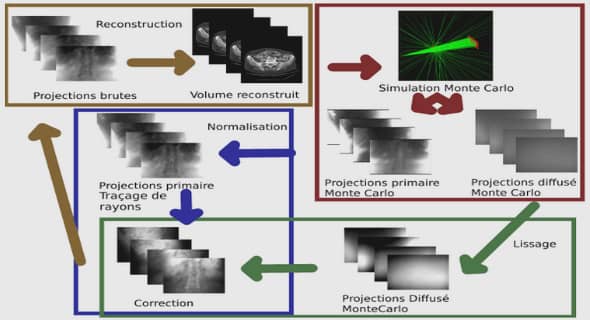Pourquoi proposer un catalogue ?
Étudier les Sao ne saurait se limiter à un travail historiographique ; cela implique aussi l’ouverture à d’autres disciplines et aussi la mise contribution de tout élément pouvant apporter des informations ou de preuves importantes. L’histoire implique aussi la considération des éléments mémoriels ou l’héritage qu’il soit matériel ou immatériel. Le caractère rudimentaire des sources encourage à la prise en compte des vestiges attribués aux Sao. Conseiller par les professeurs Bertrand Hirsch et Filipe Themudo Barata d’aller consulter et d’étudier les collections sao localisées au Musée d’Histoire Naturelle de la Rochelle, nous nous y sommes rendus par deux fois entre 2013 et 2014. Surplace, il nous a été donné l’occasion de visiter presque toutes les pièces attribuées aux Sao y compris celles qui n’étaient pas exposées.
C’est avec enthousiasme que nous avons pu visiter le musée et prendre connaissance des informations partielles rattachées à chaque pièce. N’ayant pas eu les possibilités d’étudier la collection sao, nous avons résolu qu’il serait important de la présenter sous forme d’un petit catalogue en incluant les collections d’autres musées et quelques-unes des pièces mises en vente sur internet. Notre double formation en histoire et en patrimoine nous emmène à leur accorder une attention particulière. Ainsi, pour nous, ces pièces ne sont pas qu’un patrimoine culturel mais chacune a son histoire et par amplification cache derrière elle le passé d’un peuple. Nous n’allons pas ici les décrire comme savent le faire les historiens de l’art avec des information caractéristiques. Nos informations sont sommaires car pour nous, il n’y pas que les pièces qui nous intéressent mais ceux qui les ont façonnés. Etant donné que ces objets sont eux-mêmes des sources, nous proposons ici quelques photos de cette partie de leur histoire à travers leur culture matérielle. Nous fournissons des informations, bien que très sommaires, sur leur nature, leur provenance, leur taille, leur localisation ainsi que des indications prouvant que ces objets sont mis en vente illégalement sur Internet par des particuliers. Nous n’aborderons malheureusement pas la question relative à la protection et à la sauvegarde de l’héritage culturel des Sao.
L’histoire des objets sao
La première exposition des collections du Tchad a été réalisée en octobre 1941 au Musée de l’Homme. Celle-ci était intitulée « Exposition des Collections du Tchad ».8 C’était une occasion, pour les chercheurs français qui travaillaient dans les arènes tchadiennes et camerounaises, de présenter leurs butins ; c’était aussi une manière de continuer à garder une certaine crédibilité et à conserver le soutien des mécènes. Cette exposition a réuni l’essentiel du matériel ethnographique et archéologique recueilli entre 1936 et 1937 (4e Mission Griaule) ainsi que des photographies, aériennes et terrestres, prises en 1938 et 1939 (Mission Lebaudy-Griaule (5e Mission Griaule).9 Cette exposition, première en son genre, est le résultat de ces quatre années consécutives de recherche faites sur le terrain et des travaux accomplis au Musée de l’Homme et au Laboratoire d’Ethnologie de l’École Pratique des Hautes Études »10.
Sous la direction de Lebeuf, membre des deux dernières missions Griaule, cette exposition a été réalisée matériellement par le personnel des différents services du Musée de l’Homme, avec l’aide des travailleurs du Chantier Intellectuel nouvellement ouvert au Palais de Chaillot et par le Commissariat la Lutte contre le Chômage. C’était la première grande manifestation du Musée de l’Homme depuis l’armistice. Elle revêtait donc une importance capitale de par son objectif premier, la présentation du patrimoine matériel de la civilisation sao. Il importe d’affirmer qu’à l’époque, la civilisation sao était encore une problématique que seules les preuves matérielles pouvaient aider à accepter.11 Imaginée suivant la méthode de travail appliquée sur le terrain, cette exposition des Collections du Tchad était divisée en deux sections : archéologie et ethnographie. « Et comme cela se produisit de façon permanente pendant les recherches, de nombreuses liaisons ont été établies dans la salle même entre le matériel archéologique et les collections ethnographiques. »12
Le matériel archéologique réuni par les Lebeuf est abondant et varié. Ce sont avant tout des objets de parure en bronze, constitués de bracelets que l’on porte à l’avant-bras et au poignet, d’anneaux de cheville, de bagues à l’effigie de canard (Woulki, Makari, Mahaya), de pendentifs, de colliers en forme de tête de gazelle (Midigué), de crocodile (Mahaya).13
Bien que l’accent ait été mis sur le matériel archéologique et sa description, cette exposition a aussi laissé une tribune aux photographies de Dominique Darbois. C’est un ensemble de 94 photos en noir et blanc et en couleurs dans lesquelles Darbois a mis en exergue son savoir-faire en réalisant des images très expressives. Il a ainsi su faire ressortir la puissance d’expression de la statue sao et l’élégance des bijoux de bronze ; il a également mis en valeur tel volume, tel profil, tel plan de construction, tel élément volontairement démesuré ou encore tel graphisme de scarification. Les objets photographiés proviennent de sites importants comme Tago, Midigue, Mdaga, Gaoui, Bouta-Kebira, Goulfei, Azeguene. Ils sont conservés, pour la plus grande partie, au Musée de l’Homme (Paris) et au Musée national du Tchad. À l’exception de quelques outils en terre cuite, de vases et de 14 objets en alliages cuivreux (pendentifs, bracelets, brassards, pectoraux, statuettes, bâtons cérémoniels, coupes, clochettes), ce sont, pour les 3/4 d’entre eux, des figurines : représentations humaines portant des scarifications ou plusieurs traits sur le visage, figurines à une, deux ou trois « cornes », statuettes d’ancêtres ou de danseurs masqués ; représentations de poissons, de mammifères aquatiques, d’hippopotames, de porcs épics, de chevaux.
Une sélection a été opérée dans l’abondant matériel archéologique recueilli (près de 9.000 pièces) ; les objets ainsi choisis ont été classés, suivant leur nature ou leur utilisation, en onze catégories principales : urnes funéraires, vases, fragments, parures, jouets, pipes, poids de filets et de fuseaux, représentations animales, représentations humaines, monnaies, métal (cuivre et bronze). Un certain nombre de spécimens, dont il n’a pas été possible de déterminer l’usage avec suffisamment de précision, ont été exposés à part. Le plan d’une cité sao (Makari) a été reproduit avec l’indication des principaux points de la ville et des lieux de fouille.
Une partie des pièces exposées provient de la collection recueillie par le Médecin-Capitaine Boulnois, qui était parti en mission au Tchad, dans les environs de Hadjer-el-Hamis. Celui-ci les avait confiées à Jean-Paul Lebeuf qui, à son tour, les a remises au Musée de l’Homme.
Cette exposition a été réalisée avec le matériel ethnographique presqu’entièrement issu des groupes fali où les études ont été poussées de manière soutenue. La collecte a été effectuée de façon organisée, ce qui a permis de donner une idée générale du mode de vie de cette population : l’homme et ses occupations principales (guerre, chasse), la femme et les tâches ménagères (cuisine, entretien de l’habitation), religion, magie, musique, funérailles, jouets, techniques (agriculture, élevage, filage et tissage, vannerie, pièges), parures. Une place spéciale a été attribuée à la poterie dont le développement est tout à fait remarquable dans certains villages fali.14