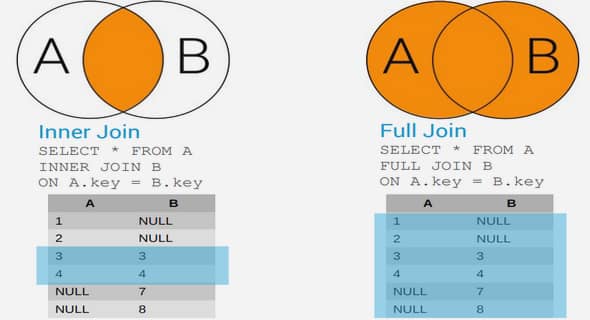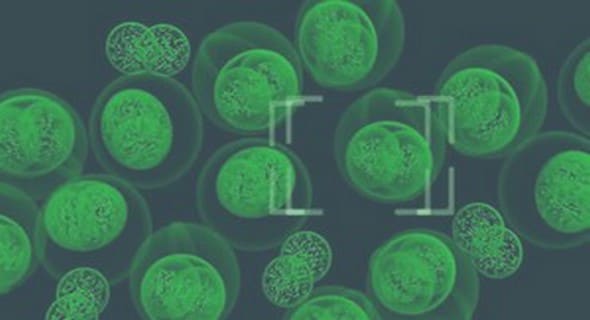Biologie de trichuris trichuris
Les trichocéphales adultes vivent au niveau du coecum en fixant leur extrémité antérieure dans la muqueuse intestinale. Ils se nourrissent de sang. Les femelles pondent des œufs ne sont pas embyonnées à la ponte, donc l’auto–infestation est impossible.
L’homme s’infeste en avalant les œufs embryonnés. Deux heures après l’ingestion, la larve sera libérée dans l’intestin. Au bout d’un mois, elle atteint le stade et vit dans le caecum.
Biologie de l’antérobius vermicularis
Les oxyures adultes vivent dans la région iléoècoecale. Ils se nourrissent à partir du bol alimentaire. Les femelles fécondées migrent vers le sphincter anal et s’y fixent par la lèvre et pondent des œufs.
Ces œufs sont embryonnées et directement infestant. L’homme s’infecte en ingérant œufs embryonnés. Ici l’auto- infestation est très fréquente.
Les larves sont libérées dans l’estomac. Après 2 à 3 semaines, elles atteignent le stade adulte.
Biologie de l’Ankystome
Les ankystomes adultes vivent dans la partie initiale de l’intestin grêle : l’ankystome duodénal vit dans le duodénum, le Nécator américanus dans le jéjumum. Ils se fixent sur la muqueuse intestinale par leur capsule buccale.
La longévité est de 4 à 5 ans pour l’ankylostome duodénal et de 10 à 15 ans pour le Néctor américanus. Ils sont tous hématophages : un néctor suce 0,02 ml de sang par jour ; un ankylostome duodénal soustrait 0,2 ml de sang par jour de son hôte soit 10 fois plus que celui de Nécator.
L’œuf n’est pas embryonné mais son cytoplasme est déjà segmenté à la ponte, si les conditions extérieures sont favorables : température 23 à 30°C, humidité suffisante, l’éclosion se fait 24 à 48 heures après leur émission.
La contamination est transcutanée : la larve pénètre par la peau et passe dans la circulation du retour puis arrive dans la veine porte et dans la foie ; elle passe ensuite dans le cœur droit dans l’alvéole et remonte les bronches jusqu’au pharynx.
Par le mouvement de la déglutition elle retombe dans l’estomac et subi sa dernière mue dans le duodénum. La première ponte sera 4 à 5 semaines après la pénétration cutanée.
Rappels théorique de la répartition géographique des helminthes intestinaux
La répartition mondiale : Le mode de vie de l’ankylostome et de l’anguillule exige le milieu humide. C’est pourquoi on les trouve dans les zones intertropicales.
Le ténia, la trichocéphale, l’ascaris et l’oxyure sont dispersés dans le monde entier. La répartition des maladies parasitaires est inégale ; les parasites deviennent dans les pays développés car le contrôle vétérinaire et l’hygiène de la population sont bien respectés ; tandis que dans les pays développées, l’hygiène reste encore insuffisante.
La trichinose est fréquence en Allemagne, Amérique du Nord, en Inde, en Chine et Indochine, ici, la répartition est en fonction des habitudes culinaires .
Table des matières
Introduction
PREMIERE PARTIE
I- RAPPEL
I.1- Brefs rappels théoriques sur les helminthes intestinaux
I.1.1- Les Némathelminthes
I.1.1.1- Trichuris trichira
I.1.1.2- Antérobiud vermicularis
I.1.1.3- Ascaris lumbricoide
I.1.1.4- Ankylostome
I.1.1.5- Strongyloïdes spiralis
I.1.1.6- Trichinella spiralis
I.1.2- Les Plathelminthes
I.1.2.1- Les cestodes
I.1.2.1.1- Les cyslophyllidés
I.1.2.1.2- Les pseudophyllidés
I.1.2.2- Les trematodes
I.1.2.2.1- Schistosoma mansoni
I.2- Rappels théoriques de la réparation géographique des helminthes intestinaux
I.2.1- Répartition mondiale
I.2.2- Répartition des helminthes à Madagascar
I.3- Rappels sur les techniques employées
I.3.1- Introduction
I.3.2- L’examen direct
I.3.3- La technique de KATO
I.3.4- La méthode basée sur l’interrogatoire
DEUXIEME PARTIE
II- L’ETUDE
II.1- Méthodologie
II.1.1- Cadre de l’étude
II.1.1.1- L’étude prospective
II.1.1.2- Le cadre géographique
II.1.1.3- L’aspect climatique
II.1.1.4- Les données démographiques
II.1.1.5- L’habitat
II.1.1.6- Le secteur économique
II.1.1.7- L’organisation sanitaire
II.1.2- La population
II.1.3- L’échantillonnage
II.1.4- Les variables d’étude
II.1.5- Déroulement de l’enquête
II.1.6- Méthode statistique utilisée
II.2- présentation des résultats
II.2.1- Les résultats des examens de selles
II.2.1.1- Les résultats obtenus par la technique de KATO
II.2.1.2- Les résultats obtenus par les examens directs
II.2.1.3- Les résultats obtenus par les examens macroscopiques des selles
II.2.2- Les résultats de l’étude de l’association parasitaire
II.2.3- Les résultats des enquêtes sur les manifestations cliniques
II.2.4- Les résultats de l’enquête sur l’hygiène des enfants
TROSIEME PARTIE
III- COMMENTAIRE DES RESULTATS
III.1- Les espèces d’Helminthes détectables par nos moyens
III.2- Les prévalences des parasitoses
III.3- L’intestin de l’infection parasitaire
III.4- L’association parasitaire
III.5- Etude de relation entre les signes cliniques et l’infestation parasitaire
III.6- Les résultats de l’examen clinique
III.7- Le contact homme- parasite
III.8- Réflexion sur les conséquences du parasitisme
QUATRIEME PARTIE
IV – SUGGESTION
IV.1- Quelques grands problèmes
IV.2- Les mesures de lutte
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE