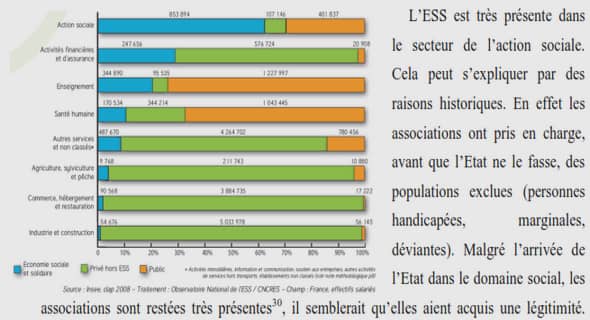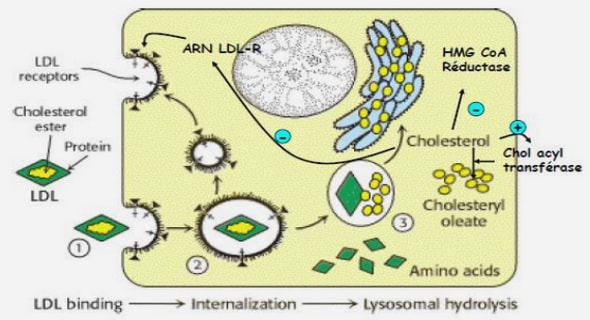Congruence entre différentiation morphologique et
moléculaire (Barcode moléculaire)
Les caractéristiques morphologiques des trois sous-familles
Les espèces auxquelles nous nous sommes intéressés dans ce travail appartiennent à deux sous–familles : Amblyseiinae et Typhlodrominae. Ces deux sous-familles présentent un nombre plus élevé d’espèces que la troisième sousfamille (Phytoseiinae) et consécutivement, un nombre également plus important d’espèces d’intérêt agronomique. La distinction entre ces sous-familles est basée sur la chaetotaxie du bouclier dorsal.
La sous-famille des Amblyseiinae Muma
Les espèces de la sous-famille des Amblyseiinae sont caractérisées par la présence de quatre paires de soies latérales (j3, z2, z4 et s4) sur la partie antérieure du bouclier dorsal (absence des soies z3 et s6) (Figure 1). Cette sous-famille comprend 1478 espèces, 61 genres et 9 tribus (Chant et McMurtry, 2007). On note une grande différence entre le nombre de genres et d’espèces incluses dans chaque tribu. Par exemple, la tribu des Neoseiulini comprend 10 genres dont le genre Neoseiulus qui comprend près de 354 espèces décrites, alors que la tribu des Phytoseiulini ne comporte qu’un seul genre (Phytoseiulus) avec 4 espèces décrites (Chant et McMurtry, 1994, 2007).
La sous-famille des Phytoseiinae Berlese
Les espèces de cette sous-famille se caractérisent par la présence des soies z3 et/ ou s6 sur le prodorsum en plus des quatre soies latérales présentes également chez les Amblyseiinae (j3, z2, z4 et s4) et par l’absence d’au moins l’une des soies suivantes : Z1, S2, S4 et S5 sur la partie postérieure du bouclier dorsal (Figure 1). Cette sous-famille comporte 192 espèces et 3 genres (Chant et McMurtry, 1994, 2007).
La sous-famille des Typhlodrominae Scheuten
Les espèces de cette sous-famille se différencient de celles des deux sous-familles précédentes par la présence des soies z3et /ou s6 sur le prodorsum et d’au moins une des soies suivantes : Z1, S2, S4 ou S5 sur l’opisthosoma (Figure 1) Cette sousfamille comprend 619 espèces, 21 genres et 6 tribus (Chant et McMurtry, 1994, 2007). Figure 1. Chaetotaxie du bouclier dorsal des trois sous- familles : Amlyseiinae Muma (a) Phytoseiinae Berlese (b) et Typhlodrominae Scheuten (c) (Kreiter, 1991) I.3. La morphologie externe et interne des espèces de la famille des Phytoseiidae Les espèces de la famille Phytoseiidae possèdent un corps sclérotinisé et piriforme, de couleur blanchâtre à marron foncé (Krantz, 1978). La longueur moyenne du corps des femelles est de 300 µm, les mâles étant légèrement plus petits (Helle et Sabelis, 1985a ; Chant et McMurtry, 2007). Comme tous les acariens, leur corps est divisé en deux principales régions (Figure 1) :le gnathosoma (partie antérieure du corps qui porte les pièces buccales et les organes sensoriels associés à la bouche) et l’idiosoma (partie postérieure du corps qui porte les pattes). abc 27 I.3.1. Le gnathosoma Cette partie du corps présente une double fonction de capture et d’ingestion des proies à laquelle sont associés les organes sensoriels du toucher, du goût et de l’odorat, située sur les pédipalpes et les pattes I (Helle et Sabelis, 1985a). Elle porte des palpes sensoriels, des chélicères et un stylophore présentant chacun une fonction bien précise : ¾ Les palpes sont sensoriels et permettent de détecter la nourriture. ¾ Les chélicères permettent de capturer et de maintenir les proies. ¾ Les stylets permettent de percer les téguments des proies. ¾ Les chélicères sont constituées d’un mors mobile et d’un mors fixe. Le premierporte quasiment toujours des dents (en nombre variable) et le second peut en être dépourvu (Figure 2). Le nombre de dents sur les chélicères de la femelle est souvent utilisé pour le diagnostic spécifique au sein de cette famille. Les chélicères du mâle portent un spermatodactyle (sur le mors mobile) qui permet le transfert du spermatophore du tractus génital mâle vers les voies génitales femelles (Amano et Chant, 1978 ; Chant, 1985b). La forme du spermatodactyle est parfois utilisée comme un caractère diagnostique. Figure 2. Morphologie des chélicères d’Euseius gallicus Kreiter et Tixier de la femelle (x 50) (photo réalisée au microscope optique à contraste de phase, Okassa 2010) mors mobile mors fixe dents mors mobile mors fixe dents mors mobile mors fixe dents mors mobile mors fixe dents
L’idiosoma
Cet organe porte les pattes, qui sont au nombre de quatre pour tous les stades mobiles, excepté pour la larve qui n’en présente que trois. Chaque patte est constituée de six segments et porte des soies et des macro-soies dont le nombre, la forme, la longueur et la position est variable. La chaetotaxie de certains segments des pattes II et III et les macrosoies, notamment celles de la patte IV a une valeur taxonomique (Evans, 1953). Le tégument de l’idiosoma est protégé par le bouclier dorsal et plusieurs petits boucliers ventraux. Le bouclier dorsal (Figure 1) porte 14 à 23 paires de soies. La chaetotaxie (nombre et position des soies) de ce bouclier est l’un des éléments utilisés pour la sub-division en sous-familles et en genres (Chant et Yoshida–Shaul, 1989 ; Chant et McMurtry, 1994). Le système de nomenclature des soies le plus utilisé est celui attribué aux Gamasides par Lindquist et Evans (1965) et adapté à la famille des Phytoseiidae par Rowell et al. (1978). Ces soies dorsales sont rangées en quatre séries longitudinales, numérotées chacune en fonction de la métamérie des arthropodes et chacune d’entre elles est divisée en deux sous-séries. Celle du prodorsum est notée en lettre minuscule et celle de l’opisthosoma en lettre majuscule. L’idiosoma peut également présenter des solénostomes (ouvertures de glandes cuticulaires), des poroïdes (organes sensoriels) et des sigilles (traces d’insertions musculaires sur le tégument. Le nombre et la forme de l’ensemble de ces organes sont variables entre les différents genres et parfois même entre les espèces (Athias-Henriot, 1975). La face ventrale des femelles possède 3 boucliers: le bouclier sternal, le bouclier génital et le bouclier ventrianal (Figure 3a,b). Le bouclier sternal présente deux ou trois paires de soies (ST1, ST2 et ST3). La quatrième paire de soies (ST4) est généralement insérée sur des petites plaques métasternales dans la partie postérieure du bouclier sternal ou est libre sur la membrane interscutale (Chant, 1985b). Le bouclier génital se trouve entre le bouclier sternal et ventrianal et porte une paire de soies (ST5). Le bouclier ventrianal est une fusion du bouclier ventral et anal, Il peut cependant être séparé pour quelques espèces.
INTRODUCTION GENERALE |