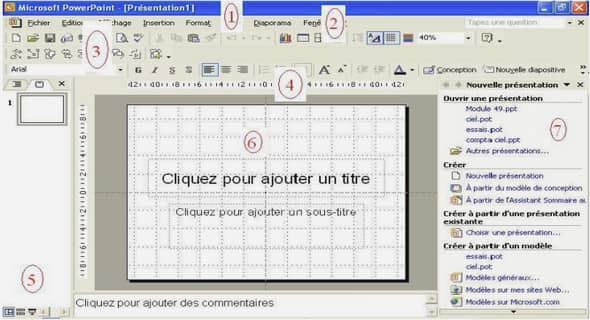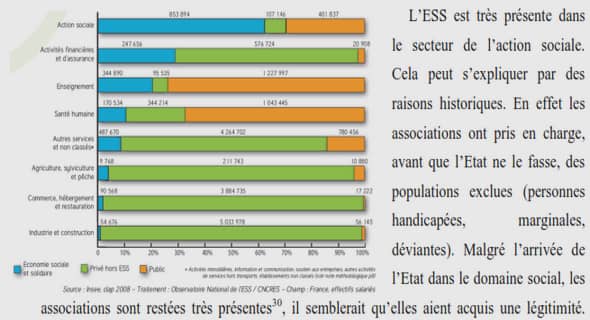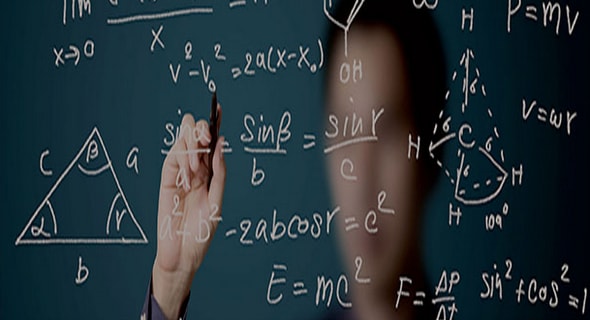LA THÉORISATION INTERNATIONALE DE LA CRIMINALITÉ SOCIALE
La théorisation doctrinale de l’infraction sociale s’inscrit dans un contexte très particulier. Si la doctrine pénale a globalement défendu l’existence d’un régime juridique propre aux infractions politiques, le développement des attentats anarchistes à la fin du XIXe siècle marque un tournant dans les modalités criminelles. L’attentat, s’il visait préférentiellement une autorité politique au milieu du XIXe siècle, frappe désormais plus aléatoirement. Ce n’est plus l’autorité politique qui est visée, mais la société politique. Ces attentats sont mus par une idéologie anarchiste singulière : la propagande par le fait. Suite à la répression de la Commune de Paris, la littérature anarchiste appelle la « matérialisation de l’idée »572. Le Bulletin de la fédération jurassienne devient le relai de ces thèses. Après la publication de l’appel à l’insurrection des Italiens Errico MALATESTA et Carlo CAFIERO le 3 décembre 1876, le journal publie dans son édition du 5 août 1877 les fondements théoriques du terrorisme anarchiste développés par l’anarchiste Paul BROUSSE : René GARRAUD, L’anarchie et la répression, Paris, Larose, 1895, p. 15.
Le premier mode de propagation de l’idée est la propagande personnelle. […] Ce moyen de propagande, quoique excellent, ne suffit pas. Combien ne faut-il pas de propagandistes pour le mettre en œuvre sur une échelle suffisamment grande ? […] On est amené remplacer la propagande personnelle par la propagande générale, la causerie par réunion publique, la conférence ou le meeting. […] Mais si la voix humaine peut parler à mille personnes, il est une voix qui parle à dix mille, à cent mille auditeurs : c’est la voie de la presse. Ainsi s’établit un troisième mode de propagande. […] D’une part donc la situation économique du propagandiste lui rend bien difficile l’emploi des moyens de propagande théorique. […] La situation économique de celui à qui on fait la propagande rend, on le voit aussi, la propagande peu fructueuse. […] Quand ce raisonnement a été fait, n’importe qui l’a fait ! on a été sur le chemin de faire, à côté de la propagande théorique, la propagande par le fait.573
Cet appel est entendu en France. L’anarchiste Émile FLORION perpètre le 20 octobre 1881 un attentat manqué contre le président de la Chambre des députés, le futur président du Conseil Léon GAMBETTA. Cet attentat, le premier d’une longue série, marque un virage dans les modalités de l’action politique d’une partie du mouvement anarchiste français.
Parmi les plus importants : l’attentat à la bombe perpétré le 27 mars 1892 par RAVACHOL au domicile de Léon BULOT, avocat général pour l’affaire de Clichy, faisant sept blessés ; celui par Émile HENRY, le 8 novembre 1892, dans les bureaux de la Compagnie des Mines de Carmaux, faisant cinq morts ; celui par Auguste VAILLANT dans l’hémicycle de la Chambre des députés, le 9 décembre 1893, afin de venger RAVACHOL, faisant une cinquantaine de blessés ; et celui à l’arme blanche, le 24 juin 1894, par l’anarchiste italien Sante Geronimo CASERIO, tuant le président Sadi CARNOT.
Cette « terreur noire »574 n’est cependant pas que le fait du mouvement anarchiste français. Elle frappe tout l’Occident. Peuvent être évoqués, l’attentat en Espagne contre le général Arsenio MARTINEZ CAMPOS le 24 septembre 1893, l’attentat en Angleterre à l’observatoire royal de Greenwich le 15 février 1894, l’attentat en Italie contre le président du Conseil italien Francesco CRISPI le 16 juin 1894, l’attentat aux États-Unis contre le président William MCKINLEY le 6 septembre 1901, ou encore l’attentat en Belgique contre le roi LEOPOLD II le 15 novembre 1902. Cette première vague du terrorisme moderne575 crée un climat de peur, « suscitant une paranoïa généralisée dans l’opinion publique et alimentant dans les journaux la quotidienne ‘rubrique de la dynamite’. »576 La perception médiatique de cette violence renforce la désapprobation populaire de ces actes. L’historienne Haia SHPRAYER-MAKOV, dans un article publié en 1988, montre combien la thématique anarchiste traverse la presse européenne de la décennie 1890. L’anarchiste y est présenté négativement, ce qui contribue indéniablement à psychologiquement préparer l’opinion publique à une rupture dans le logiciel de l’infraction politique. L’historienne Constance BANTMAN parle d’un « arrière-plan fantasmatique »577 pour qualifier cette presse bien souvent excessive et sensationnaliste. L’historienne Martine KALUSZYNSKI relève que, d’écarter les anarchistes de la protection traditionnellement accordée par l’extradition.
Le Belge Albéric ROLIN, rapporteur de la cinquième commission chargée d’étudier l’extradition, définit ainsi l’infraction sociale : D’une manière générale, les infractions sociales sont celles qui battent en brèche la propriété, la liberté individuelle, qui menacent la vie humaine ; aucune exception indulgente ne doit être réservée à des actes de cette nature sous prétexte qu’ils auraient pour source quelque théorie subversive de tout ordre social.579
Cette définition propose ainsi une différence entre la violence politique, qui ne porterait que sur l’organisation politique, et la violence sociale, dont l’objet serait les fondements de la société politique. Sous l’apparente objectivité de cette distinction, la philosophe Sophie DREYFUS relève que « les critères choisis […] prennent en réalité appui sur un jugement de valeur implicite quant à ce qu’il convient de nommer l’ordre social. »580
De cette définition naît pourtant une proposition en matière d’extradition, adoptée et inscrite dans les Résolutions d’Oxford à l’article XIV :
Ne sont point réputés délits politiques, au point de vue de l’application des règles qui précèdent, les faits délictueux qui sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale, et non pas seulement contre tel État déterminé ou contre telle ou telle forme de gouvernement.581
L’objectif poursuivi par l’Institut n’est donc pas seulement de neutraliser le caractère politique des crimes anarchistes, mais également de défendre une conception de la société politique notamment fondée sur la propriété privée. La scission de l’infraction idéologique en deux composantes permet, en définitive, de relégitimer la conception conséquentialiste de l’infraction politique582.
La théorie des infractions purement politiques est le terreau conceptuel de l’infraction sociale. Pour catégoriser les faits qui doivent entrer dans cette nouvelle catégorie, la doctrine internationaliste fonde son criterium sur une appréciation des valeurs fondamentales de la société politique. S’ils ne visent pas expressément les anarchistes, ces auteurs définissent toutefois le contour doctrinal de l’infraction sociale dans le dessein de les exclure du bénéfice de la protection internationale accordée aux condamnés politiques. La résolution adoptée par l’Institut de droit international sur le cas de l’extradition n’a cependant qu’une valeur doctrinale. Cette proposition pose cependant un cadre théorique, notamment relayé en France par René GARRAUD, à partir duquel vont pouvoir se justifier des législations exceptionnelles. C’est le cas, en France, des lois dites « scélérates » des années 1893-1894 qui viennent implicitement consacrer cette catégorie doctrinale.
LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE DES CRIMES SOCIAUX : LES LOIS « SCÉLÉRATES » DE 1893-1894
Appelées « lois scélérates » par la gauche républicaine583, la législation chargée de réprimer les attentats anarchistes en France est composée de trois corpus : la loi du 12 décembre 1893, modifiant les articles 24, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; celle du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs ; et celle du 28 juillet 1894 tendant à réprimer les menées anarchistes. Le professeur lyonnais René GARRAUD estime, dans son ouvrage sur L’anarchie et la répression publié en 1895, que, Le véritable caractère de cette législation, c’est de transporter dans le domaine des crimes sociaux, des prévisions réservées, jusqu’ici, par tradition, aux crimes politiques. Il y a là une évolution fatale de la répression, parallèle à l’évolution de la criminalité.584
Par exemple : Francis DE PRESSENSÉ, un juriste [Léon BLUM] et Émile POUGET, Les lois scélérates de 1893-1894, op. cit. René GARRAUD, L’anarchie et la répression, op. cit., 1895, p. 54.
Ces lois marquent une rupture dans le logiciel hérité de la Monarchie de Juillet. Cette législation introduit, d’une part, une nouvelle pénalité (1) et, d’autre part, une adaptation des procédures judiciaires (2). À côté l’infraction de droit commun et l’infraction politique, l’infraction sociale propose ainsi une répression aggravée de certaines infractions idéologiques.
LA CONSÉCRATION DE PEINES DÉROGATOIRES
Cette législation de 1893-1894 modifie substantiellement la pénalité en faisant de la relégation une peine complémentaire. Cette peine, créée par la loi du 27 mai 1885, vise originellement à l’éloignement du territoire métropolitain des individus se trouvant dans une situation répétée de récidive, une fois sa peine principale expirée585.
Les conditions de la relégation sont déterminées par l’article 4 de la loi du 27 mai 1885 : « Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les condamnations énumérées à l’un des paragraphes suivants : / 1° Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion, sans qu’il soit dérogé aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la loi du 30 mai 1854 ; / 2° Une des condamnations énoncées au paragraphe précédent et deux condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour : vol ; escroquerie ; abus de confiance ; outrage public à la pudeur ; excitation habituelle des mineurs à la débauche ; vagabondage ou mendicité par application des articles 277 et 279 du Code pénal ; / 3° Quatre condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus ; / 4° Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l’interdiction de résidence signifiée par application de l’article 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d’emprisonnement. / Sont considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage, tous individus qui, soit qu’ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou faciliter sur la voie publique l’exercice de jeux illicites, ou la prostitution d’autrui sur la voie publique. » Sur cette question, renvoi aux développements de la seconde partie sur le système de la récidive en matière politique (« 2 – La distinction au titre de l’application de la récidive », p. 278).
Cette peine n’est d’abord associée, par la loi du 18 décembre 1893, qu’à l’infraction nouvellement créée à l’article 266 du Code pénal587. Cette disposition réprime de la peine principale des travaux forcés à temps l’affiliation à une association constituée ou à une entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés. Cette nouvelle infraction est contestée par la gauche parlementaire, qui estime trop imprécise la notion d’entente588. Au-delà d’autoriser le juge à prononcer la relégation, l’imprécision de cette incrimination offre une grande latitude dans la répression des anarchistes, mais également des socialistes. S’il revient au juge d’apprécier l’opportunité de la relégation, le gouvernement exerce une certaine pression. C’est ce que prouve la circulaire du 23 décembre 1893 du garde des Sceaux Antonin DUBOST, enjoignant au ministère public de requérir la relégation : Il ne vous échappera pas, monsieur le Procureur général, que, dans bien des cas, cette peine [de la relégation] constituera un efficace moyen de défense sociale. Il importe, en effet, d’écarter de notre société des hommes dont la présence, en France, à l’expiration de leur peine, pourrait constituer un danger pour la sécurité publique.589
La peine de la relégation n’est donc plus la sanction d’un état particulier de récidive, mais une peine préventive ciblant une idéologie particulière revendiquée ou supposée d’un individu. Guillaume LOUBAT , alors avocat général près la cour d’appel de Lyon, défend également le nouvel usage de cette peine. Dans son Code de la législation contre les anarchistes, il estime que cette peine est « [l]’unique moyen de préservation sociale »590.