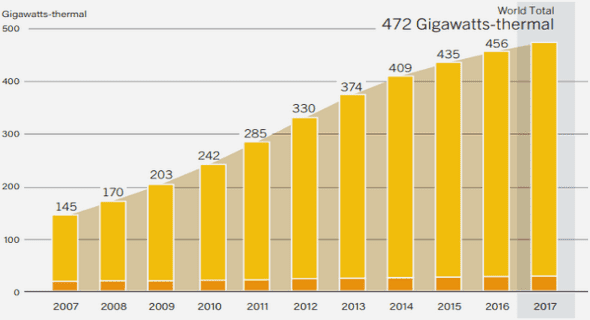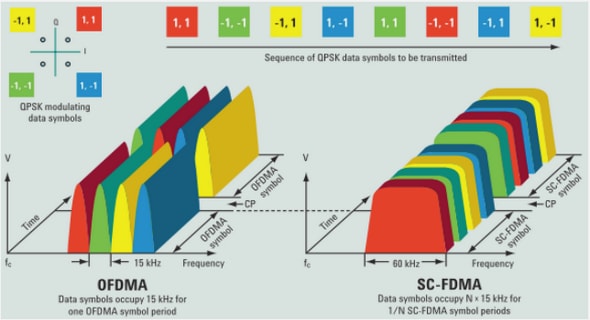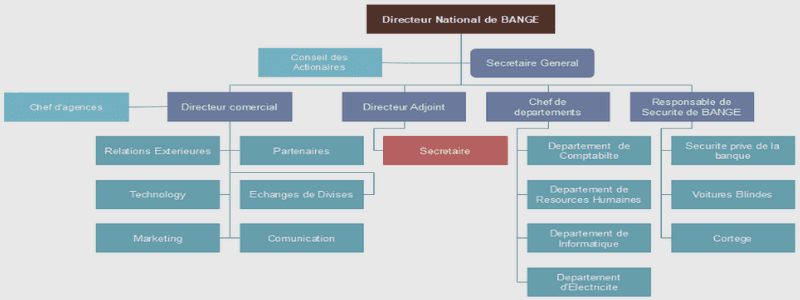Le cadre spatial de l’étude : la villede N’Djaména
Notre recherche a pour cadre un milieu physique bien délimité, en l’occurrence la ville de N’Djaména. L’objectif de ce chapitre est de présenter au lecteur ce cadre qui sert de support aux pratiques culturelles que nous étudions. Il s’agit de montrer que le choix de la ville de N’Djaména comme terrain d’étude est lié à plusieursfacteurs spécifiques qui définissent son urbanité 9 (Poggi et Barilero, 1990 : 5), comparativement à d ’autres villes du Tchad. Nous souhaitons donc mettre en évidence les différents léments caractéristiques de ce terrain, qui orientent les pratiques musicales aussi bien en termes de facilitation que de contraintes.
Dans cette perspective, nous analyserons tour à tou r, les différentes dimensions de ce contexte : historique, politique, économique et socioculturelle. Pour ce faire, nous avons choisi de placer d’emblée notre regard sur la dimension africaine du phénomène urbain. Même si nous empruntons à l’occasion aux travaux de l’Ecole de C hicago, notamment ceux de Simmel (1903) qui montrent comment le mode de vie urbain se décline à travers une multiplicité de groupes d’appartenance, ou encore ceux de Wirth (1938) qui décrivent le citadin comme un individu « pris dans un système complexe de rôles et d’allégeances multiples »10, il nous a semblé que la ville africaine, dans les rapports qu’elle établit entre un ordre spatial et une réalité sociale avait une spécificité qui nous invitait à concentrer notre attention sur les recherches directement liées à ce type de territoire.
De plus, de nombreux travaux fondateurs de sociologie urbaine qui ont débouché sur la théorisation de la ville concernent les villes occidentales de pays développés, ce qui nous aurait amené à relativiser leur pertinence et à nous écarter de notre préoccupation principale. Très concrètement, nous nous posons la question de savoir ce que l’on entend par « habiter la ville » dans le contexte africain, notamment par rapport à l’idée de « vivre au village » et en quoi les différentes manières de « faire avec » la ville, pour reprendre l’expression de Michel de Certeau, trouvent une manifestation dans les pratiques culturelles des habitants.
L’urbanité, selon ces chercheurs, se définit à la fois par la forme du lieu et par la manière dont les interactions qui s’y engagent s’inscrivent dans l’e space et y acquièrent de la civilité. Lacivilité, quant à elle, renvoie aux relations de co-présence des sujets sociaux qui, s’ils partagent à un moment donné un mêmeespace, restent cependant dans une situation de « méconnaissance » réciproque.
Quelques éléments de compréhension de la villeafricaine
On peut d’abord rappeler, avec Annie-Claude Labrecque (2010), que l’étude du phénomène urbain africain est beaucoup plus le fait des chercheurs étrangers venant d’Europe, ou du moins de l’extérieur du continent africain. Le peu de recherches « indigènes » en études urbaines s’explique, selon elle, par la réalité urbaine paradoxale du continent africain, à la fois le plus rural avec un taux d’urbanisation environnant les 35%, mais qui s’urbanise rapidement. En quatre décennies, la population des villes africaines a été multipliée par 12.
Parmi les principaux travaux de recherche portant sur les villes africaines, nous pouvons retenir que ces entités sont étudiées essentiellement suivant deux axes : le premier porte un regard rétrospectif et correspond aux travaux sur la ville dite coloniale ; le second concerne les recherches relativement récentes sur la ville africaine contemporaine. Nous tenterons de rappeler dans les développements suivants, quelques travaux réalisés sur la ville africaine au regard de ces deux logiques, dans la mesure où ils autorisent des lectures possibles de notre terrain de recherche.
La ville africaine : une création de la colonisation et du développement des échanges commerciaux
Il est rare de parler des villes africaines sans faire référence à la période coloniale, à partir de laquelle bon nombre de villes ont d’ailleurs ont été fondées. Ainsi, contrairement au contexte européen, la ville était le lieu par excellence ducommandement administratif et militaire.
Comme telle, la création de la ville était une volonté exogène et c’est sans doute dans ce contexte que se justifie la formule de Dresch (1948) pour qui la ville africaine est « une création des Blancs peuplée par les Noirs .»
C’est cette ambiguïté des relations sociales que Balandier tente, de son côté, de mettre en avant dans l’un des ouvrages 11 pionniers dans ce domaine. Il affirme que malgré les relations de travail et l’organisation administrative, les rapports entre les villes noires et la ville blanche sont quasi inexistants et que les problèmes psycho-sociaux des unes ne sont pas ceux de l’autre. Quant à Sinou 12 qui inscrit sa recherche dans une perspective historique, il s’attache à rappeler les moments fondateurs de quelques villes coloniales, notamment en s’intéressant aux passages des comptoirs aux villes. Ainsi, pour lui, l’urbanisation d’une partie non négligeable des villes africaines (l’Afrique septentrionale, méditerranéene ou sahélienne) s’explique par le développement des échanges commerciaux, notamment ansd les cités arabo-musulmanes comme Le Caire, Marrakech, Djenné, Tombouctou ou Kano.
La ville africaine contemporaine
Si certains chercheurs ont développé un regard strictement historique sur la ville africaine en focalisant leur attention sur le passé colonial, d’autres, au contraire, s’emploient à montrer des réalités différentes qui fondent, selon eux, le cactère urbain de la ville africaine d’aujourd’hui. C’est notamment la thèse développée par Djouda Feudjio13 qui oppose une vision catastrophiste, alarmiste de la ville africaine coloniale à une vision positive et valorisante qui considère les villes africaines comme de véritables« laboratoires » des dynamiques urbaines. A partir des observations directes réalisées dans sept villes de l’Afrique subsaharienne (Douala, Yaoundé, Libreville, Brazzaville, Dakar, Abidjan et Nairobi), il en vient à montrer qu’une urbanité africaine se construit et s’invente au quotidien sous la grande impulsion individuelle et/ou collective de ses acteurs. Il tente de montrer que l’Afrique urbaine n’est pas seulement un espace de violence, d’insécurité, de pauvreté et decrises. Elle est aussi le lieu de multiples métissages, de construction de réseaux sociaux et conomiques,é de « nouvelles cultures urbaines », de « solidarités innovantes » et de « yncrétismes créateurs ». Il montre l’évolution de ces villes notamment à travers les transformatio ns quotidiennes de l’aménagement paysager, la vitalité accrue des espaces publics comme espace de sociabilité et l’émergence des « mototaxis » qui rendent dynamique le secteur de transport urbain. Ce regard est également partagé par Piermay (2002)qui s’est attaché lui aussi à montrer la manière dont l’invention se construit dans la ville subsaharienne. Il note que cette invention prend la forme de réponses sociales et crée de « possibles catalyseurs du changement urbain14 ». Elle est la résultante des situations d’impasses et de blocages au sein de la société. En s’appuyant sur des exemples d’initiatives émanant d’acteurs privés dans quelques villes d’Afrique centrale et de l’Ouest, il montre la « do mestication de la ville » opérée par ces acteurs.