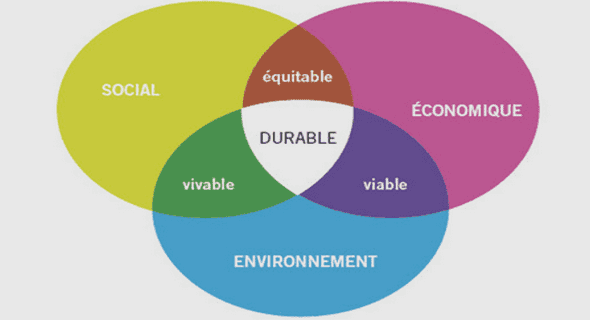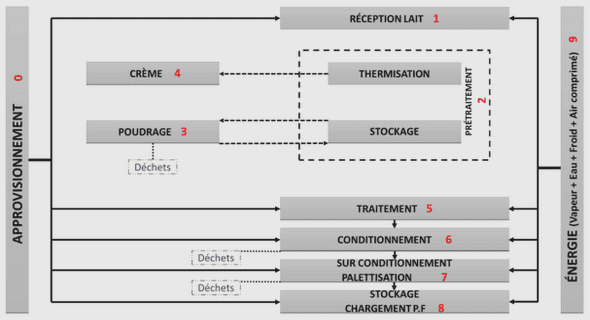Une anthropologie « chez soi » ?
Les enquêtes anthropologiques menées en Europe ont déjà une certaine ancienneté. Elles ont acquis leur légitimé grâce au processus général qui a conduit la discipline-même à s’émanciper de son statut lié, depuis sa naissance, au colonialisme et à une certaine notion d’« exotisme ». Un processus qui a concerné aussi l’anthropologie de la santé : « l’étude de la maladie renvoie en effet à des interrogations qui sont universellement valides (le rapport au corps, le sentiment religieux, l’interaction entre individuel et social, etc.), même si elles trouvent des réponses parfois différentes selon les sociétés. Ainsi, en Occident comme en Afrique, l’interprétation que les sujets ont de la maladie et les motifs qui sous tendent les recours thérapeutiques nous semblent largement déborder le domaine strictement médical » (Fainzang, 1989 : 16).
De plus, il faut estimer que la réflexion de l’ethnologue par rapport à « son objet », c’est-à-dire à la place qu’on négocie dans le milieu social d’enquête et le recul nécessaire pour s’en distancier, est d’autant plus essentielle pour ceux qui choisissent de poursuivre une enquête chez soi » : quand les acteurs sociaux pris en compte sont considérés comme très proches du milieu originaire » du chercheur. L’attention, la « vigilance empirique» (Olivier de Sardan, 2004 : 39) peut être, devrait être majeure quand le « trop proche » risquerait d’être perçu comme trop « évident» ou de n’être pas saisi dans sa complexité.
Mais que désigne cette étiquette : « anthropologie chez soi »? Elle est « à la fois pluridimensionnelle et relative. Sa pluri-dimensionnalité tient à ce que ‘chez soi’ peut designer un pays, par exemple la France, un continent, par exemple l’Europe, les sociétés occidentales Si l’on considère qu’est ce que signifie mener des enquêtes en terrain familier, par opposition à un terrain étranger, on s’aperçoit que cela peut aussi concerner une institution, ou encore une maladie […] dont on se sent membre. Si l’on tente de systématiser les divers contenus attribués à l’idée de ‘chez soi’, on s’aperçoit qu’elle recouvre au minimum deux situations […] il peut s’agir d’une culture partagée, ou d’une expérience partagée » (Fainzang, 2001 : 6).
Effectivement, l’expérience concrète du terrain, le rapport direct avec ce service a bouleversé mes « croyances ». Si d’abord j’étais persuadée d’avoir choisi un terrain « proche » parce que situé en France (un pays européen où d’ailleurs j’avais déjà vécu), si le milieu hospitalier m’était en quelque sorte « familier », toutes ces convictions ont été soumises à l’épreuve de l’expérience directe. Bien que le sud-est français ait beaucoup de traits historiques et sociaux en commun avec l’Italie, mon pays d’origine, « la relativité de la notion ‘chez soi’ se constate au fait que si un occidental est ‘chez lui’ en occident, il n’est pas moins qu’un danois n’est pas ‘chez lui’ en Italie. Le problème reste donc celui des frontières culturelles impliquées par cette notion » (idem, 2001 : 7).
Tout au long de ma période de stage au sein de ce service (qui a eu lieu du mois d’octobre 2014 jusqu’à la fin du mois de décembre, pour une durée de 3 mois), j’ai remarqué que ce qui pouvait le plus attirer l’attention du personnel et des patients (et qui donc pouvait me permettre d’entamer une conversation ou créer un contact) ce n’était pas mon rôle ou le sujet de ma recherche (d’ailleurs, la plupart ne semblait pas intéressés), mais mon statut même d’étrangère. Il faut préciser que la curiosité et la sympathie que je suscitais parfois étaient explicables non à cause d’une « étrangeté quelconque » : mes origines italiennes sont perçues positivement dans le contexte du Sud Est français, où la présence italienne est encore un composant important de la culture régionale. Sans le savoir, j’avais déjà une ressource pour nouer des liens, pour lutter contre la méfiance que suscitait mon rôle, incompréhensible pour la plupart. Donc ce que je croyais évident (d’être en quelque sorte « chez moi ») non seulement ne l’était pas, mais mon statut d’étrangère jouait doublement en ma faveur : d’une part il me permettait de me « distinguer » aux yeux des différents acteurs, et donc il me consentait d’entrer en contact avec eux, d’autre part il me donnait un regard extérieur légitimé par mes origines.
Le facteur de la langue a été aussi important : d’un côté je métrisais suffisamment le français pour me permettre de comprendre la plupart des échanges, mais, de l’autre, mon accent, mes questions sur la signification de certaines expressions, créaient de réelles difficultés face au langage médical et souvent argotique pratiqué par le personnel, me faisant douter de ma capacité à en saisir le sens.
L’autre aspect qui m’avait d’abord fait penser que j’étais « chez moi », c’est-à-dire l’expérience directe et prolongée des milieux hospitaliers, a été réfuté de la même façon. À l’intérieur de l’hétérogène univers hospitalier, chaque service a ses propres règles (formelles et non) de fonctionnement et d’interaction. Le fait aussi de me concentrer uniquement sur le personnel soignant m’a démontré à quel point l’espace, le temps, les perspectives et les attitudes d’un seul service pouvaient être vécus de façon totalement différente de la part des soignées et des soignants. Les deux groupes d’acteurs se côtoient tous les jours, mais restent néanmoins deux univers fort divergents ; d’un côté ils sont complémentaires (il n’y aurait pas de « soignant » sans « soigné » et vice-versa : les deux identités se construisent de manière forcement interdépendante), mais d’un autre côté ils appréhendent de façon très différente le fait de vivre le temps, l’espace et la relation.
Pour avoir connu l’hospitalisation de longue durée, j’avais cru pouvoir affirmer connaître la vie d’un service hospitalier, mais la confrontation avec ce terrain m’a révélé en réalité un contexte inédit, que je n’aurais jamais pu rencontrer, sans quitter le rôle de patiente.
Découvrir que je n’étais pas tout à fait « chez moi » m’as permis, peut être, d’éviter l’écueil de « l’implication du chercheur sur son terrain […] qui peut également influer sur la perception de la réalité qu’il tente de restituer » (Ouattara, 2004 : 2).
Enfin, on pourrait dire que d’une certaine manière, ma position que l’on pourrait qualifier d’un peu floue d’ « étrangère locale » (en tant qu’italienne dans le Sud Est français) a eu des avantages, car, « en situation de totale altérité, le chercheur met souvent des semaines sinon des mois avant d’établir les liens qui lui permettront d’entrer dans son enquête » (Copans, 19986) ; et, en même temps, cette position « sur la frontière » m’a permis d’instaurer la « bonne distance » (Ouattara, 2004 : 3) à respecter en tant que chercheur. Car « le point du départ de la démarche ethnologique » caractérise une pratique d’enquête qui « se déploie à l’intérieur de l’échange entre l’ethnologue et ses interlocuteurs. Elle épouse les formes du dialogue ordinaire et c’est dans ce dialogue que le chercheur introduit une distance qu’il est condamné à reproduire lors de chaque rencontre » (Althabe, 1990 : 126).
On pourrait dire, à posteriori, que « tantôt j’étais considérée comme une des leurs, tantôt j’étais vue comme une étrangère » (Ouattara, 2004 :7). Tout ce processus démontrerait, en effet, que la notion d’anthropologie « chez soi », trop superficiellement rattachée au simple fait de conduire une enquête en Europe (pour des chercheurs d’origine européenne), est liée encore à une vieille conception de l’objet de recherche anthropologique issue du « Grand Partage » entre Occident et « exotique », donc culturaliste. C’est donc un concept qu’on pourrait juger arbitraire. « Quel que soit le terrain abordé, il est toujours question d’ethnologie de soi et de celles des autres », car « la relation d’enquête est aussi un rapport dialectique entre altérité et familiarité » (idem, 2004 : 10-11).
On pourrait aussi profiter de cet espace de réflexion sur « l’anthropologie chez soi » pour faire un parallèle entre deux traditions académiques différentes. S’il est vrai qu’une discipline se développe en synergie avec ce qui se passe dans les autres pays et que la recherche scientifique ne connait pas vraiment de frontières, il est aussi évident qu’elle est toutefois marquée par un contexte social, national et historique. En France l’anthropologie s’est définie longtemps comme une anthropologie de l’ « Autre » exotique, notamment « l’Autre » de la rencontre colonialiste. Seulement dans un deuxième temps les recherches se sont déplacées vers la société occidentale « dès lors qu’était acquise la conviction que non seulement les mêmes types de questions pouvaient se poser chez nous, mais aussi que la confrontation des travaux menés ici et ailleurs pouvaient utilement éclairer la réalité sociale. L’anthropologie chez soi a poursuivi son effort pour transporter dans la société française les interrogations que se posent classiquement les anthropologues en terrain exotique» (Fainzang 2006 : 159).
Cependant, ma formation anthropologique de base a eu lieu en Italie, où les approches méthodologiques et les questions épistémologiques sont un peu différentes, parce que la discipline a pris forme dans un autre contexte historique et social, et où faire de l’anthropologie « chez soi » assume une autre valeur. L’anthropologie italienne, dès sa naissance, s’est confrontée à une vaste diversification interrégionale qui lui a donné une connotation régionaliste mais en même temps, les cadres théoriques qui ont nourri la discipline ont toujours eu des références philosophiques (Croce, Gramsci) et « une forte coloration politique » (Bibeau, Pandolfi, 2006 : 199). Le fait de vouloir se défaire des liens avec le passé fasciste, le fait aussi de n’avoir pas eu une histoire coloniale semblable aux autres puissances européennes, la nécessité de construire une unité nationale et sociale très récente, de faire face à la question méridionale, etc. : toutes ces raisons ont amené l’anthropologie italienne a se « démarquer radicalement du point de vue de terrains ethnographiques, des autres anthropologies européennes : les italiens travaillent en Italie même » (idem, 2006 : 202). L’anthropologie critique d’Ernesto De Martino, et, en anthropologie médicale, la forte influence de Basaglia (et son importante reforme psychiatrique) sont les plus célèbres exemples qui pourraient expliquer le singulier parcours de cette discipline en Italie : à la fois comme engagement politique et social et comme mise en cause épistémologique des positions de sujet et d’objet (issue de la primauté accordée à la phénoménologie). En somme, l’anthropologie « chez soi » de la tradition disciplinaire italienne a pour objectif de remettre en question l’Occident et ses catégories culturelles.
Faire de l’enquête ethnographique chez soi peut donc avoir des connotations politiques et de cadres théoriques différents. Cette brève comparaison de traditions disciplinaires montre comment le choix du terrain mais surtout le background théorique qui construit « l’objet » d’une recherche peuvent avoir une forte influence sur la mise en place de toute enquête.
La construction d’une enquête en milieu hospitalier : contraintes matérielles et nature du terrain
Si le choix du sujet de recherche, la prise en charge de la douleur dans un contexte de soin public, étaient déjà formulé en amont, le choix du terrain fut plutôt le résultat d’un ensemble de contraintes externes. Mon arrivée au service d’hémato-oncologie n’a pas été préparée par une recherche sur les particularités du fonctionnement interne des hôpitaux français, ni par une sélection de caractéristiques qui distinguent ce service en particulier. Celui-ci s’occupe notamment des soins de patients atteints de pathologies très dures (comme le cancer, la leucémie, le sida) et il accompagne les patients en fin de vie.
Le choix du terrain a été dicté à la fois par une contrainte de temps et par une contrainte d’espace : la nécessité de trouver en moins de deux mois un milieu de soin dans lequel je puisse mettre en place ma recherche, avant la rentrée universitaire, et le choix de rester en France pour des commodités de proximité : proximité physique, dans la région où j’habitais, dans le sud de la France, ainsi qu’une certaine proximité « culturelle », qui m’aurait permis d’ « entrer » plus rapidement dans le contexte social. Le choix de rester dans un contexte social européen en effet devait me permettre de préparer un terrain plus rapidement (par rapport à la langue à apprendre, aux charges du voyage, etc.) mais je me suis aperçue que même dans la situation d’une telle proximité culturelle, je n’étais pas prête à me plonger dans cette réalité particulière et délicate que représente une enquête en milieu hospitalier.
De longues recherches à travers les hôpitaux de la région, des rendez-vous téléphoniques sans suite, d’épuisants ricochets d’un secrétariat à un autre : déjà j’avais saisi la difficulté à présenter mon projet de recherche à des institutions qui, de toute évidence, n’étaient pas familiarisées avec ce genre de démarche. En effet, le responsable de ce service a été le seul à répondre positivement à ma demande. Voici les principaux facteurs qui m’ont amenée dans ce service d’hémato-oncologie.
L’hôpital où se situe le service de mon terrain de recherche se trouve dans le cœur d’une ville de 150000 habitants, dans la région du sud-est français. Il s’agit donc d’un hôpital de moyenne dimension, avec une histoire ancienne, qui a grandi au fil des années depuis son premier centre qui date du moyen-âge. C’est donc une institution que l’on pourrait qualifier d’historique, une référence pour la ville qui l’entoure. C’est à partir des années soixante du XXème siècle, qu’une extension progressive s’est ajoutée au premier bâtiment qui représentait l’hôpital, avec l’ouverture de différents pôles et services, en suivant la croissante spécialisation et la complexité des hôpitaux de l’époque contemporaine. Il est devenu donc ce qu’en France on appelle un « centre hospitalier », c’est-à-dire un ensemble de différents bâtiments et pavillons liés entre eux, qui logent les différentes composantes d’un hôpital contemporain : les Urgences, les différents services de médecine et de chirurgie, les bureaux de l’administration, les pôles de formations, etc. Les chiffres donnés par l’hôpital même indiquent une capacité de 762 lits, 43 services médicaux, chirurgicaux et médico-techniques, pour un budget de fonctionnement d’environ 177,3 millions d’euros. De ce fait, pour celui qui arrive dans cet établissement, l’orientation entre les différentes structures n’est pas facile. À l’arrivée, la première impression est celle d’un grand labyrinthe caché au centre de la ville ; une sorte de deuxième ville au centre de la ville même. En suivant cette métaphore on peut aisément comprendre qu’il y a « les beaux et les bas quartiers. L’hôpital est constitué d’un ensemble de territoires, les services, entre lesquels peu d’échanges s’effectuent. Chaque catégorie de personnel a son propre réseau et il est extrêmement rare qu’un travailleur ait circule dans chacune des parties […] Il faut saisir cela pour comprendre la hiérarchie et la stratification de ce monde fermé sur lui-même qu’est l’hôpital » (Peneff, 1992 : 24). « Entrer dans un hôpital, que ça soit un petit établissement de province ou la grande policlinique de pointe, signifie toujours se plonger dans une unité de temps et de lieu : l’hôpital est le lieu du même, un hors-monde presque rassurant, assignant à chacun sa place » (Vega, 2000 :198).
La direction semble soucieuse de donner une apparence d’innovation et de « modernité » car le hall de l’accueil et la cafeteria, tout comme le rez-de-chaussée, ont été rénovés récemment, mais, dès qu’on entre dans les pavillons des services, on se rend compte d’une sorte de « décalage » entre les anciens espaces, qui datent des années soixante, et les nouvelles nécessités d’un centre hospitalier moderne, avec des nouveaux équipements et des nouvelles technologies, et un nombre d’hospitalisations croissant.
Je m’en suis aperçue en tentant de rejoindre la toute première fois le service d’hémato-oncologie : le parcours pour s’y rendre représente un apprentissage en lui-même.
Il s’agit d’un petit couloir au cinquième étage d’un vieux bâtiment de 6 niveaux, qui n’est pas directement attaché au pavillon principal de l’accueil. Quand on rentre dans ce service d’hémato-oncologie on s’aperçoit que les parois étroites sont un peu délabrées ; il n’y a pas d’espace commun mais chaque structure : les chambres, les salles d’infirmiers, le secrétariat, la cuisine, les bureaux de médecins, les locaux techniques, etc. est organisée autour du couloir. Il n’y a donc pas de « communication » entre les espaces et l’impression que l’on peut avoir de l’extérieur est que l’activité du service, les patients semblent « cachés ». L’encombrement suscité par les différents chariots de soin et d’entretien, de vieux fauteuils roulants, les brancards de passage est symptomatique et tellement habituel qu’au fil des mois on apprend à « donner la priorité » aux différents chariots et personnes de passage comme à un carrefour dans la rue.
Pour le patient, l’occupation de l’espace n’est pas plus facile. Les chambres logent deux lits et une petite salle de bain avec toilettes à partager. Mais l’espace est étroit et la proximité entre les patients hospitalisés est souvent la cause de plaintes. Peu de place pour les visites, pour l’intimité, pour ranger les vêtements, pour les pieds qui tiennent les poches des perfusions : seuls les écrans de télévision payants sont nouveaux et leur présence saute aux yeux tout de suite.
À mesure que mon stage se déroulait, les espaces de convivialité et de réunion du personnel soignant, l’office (la cuisine) et la salle des infirmiers, ont été les lieux les plus importants pour suivre les dynamiques et les échanges de ces acteurs. J’eus par la suite l’impression d’être « en coulisse », tellement ces deux lieux (qui représentent le « territoire » par excellence du personnel paramédical) sont abrités du reste du service, en particulier par rapport aux chambres de patients. J’ai ainsi fait l’expérience de la cohabitation de plusieurs « niveaux d’existence » d’un service hospitalier : notamment celui des soignants et des soignés, que la proximité physique consécutive aux espaces étroits n’aide pas à se rejoindre.
Je n’imaginais pas encore la difficulté d’entrer, en tant que « profane » et étrangère, dans les coulisses d’un service hospitalier : une sorte d’initiation à un monde complexe et pluriel, celui du personnel soignant, qui n’accepte guère des intrusions dans son « territoire ». J’ai du apprendre des règles internes de conduite et d’interaction souvent non explicites pour comprendre que travailler dans une institution telle que l’hôpital, ce n’est pas « un boulot comme un autre », car « c’est une institution de destruction des règles sociales qui prévalent habituellement hors de ses murs, puis de reconstruction des individus[…] L’hôpital laisse des marques invisibles et insidieuses qui pénètrent l’âme de tout un chacun, simplement parce qu’il met à nu » (Vega, 2000 : 200-201).