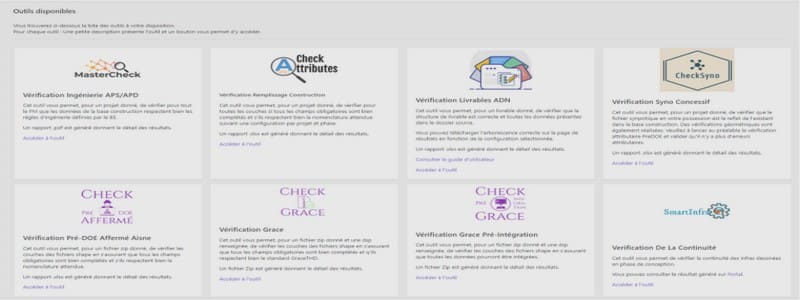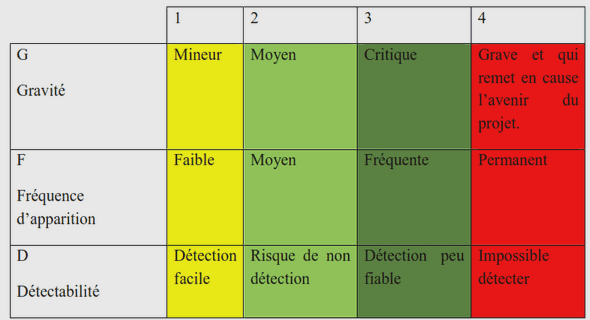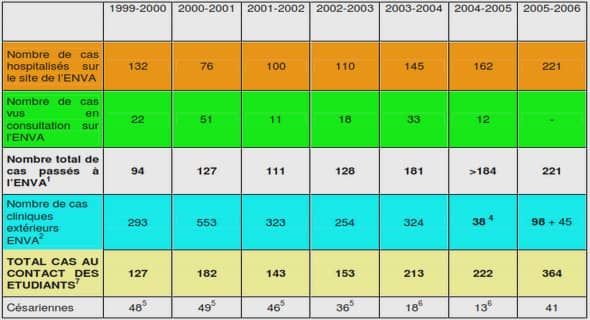Croissance et développement durable
Nous venons de montrer en quoi les questions démographiques sont actuellement hors du champ de l’étude que nous allons proposer dans la suite. Concernant le second terme de l’Equation 1, la crois-sance économique est aussi une variable clé des émissions de gaz à effet de serre. Mais la question du développement durable.
La Figure 2.12 montre que la richesse globale a augmenté considérablement, plus rapidement que la population. Le pouvoir d’achat d’un habitant de la planète moyen a augmenté. La Figure 2.13 montre la croissance de ce pouvoir d’achat moyen par région sur les trente dernières années. La croissance actuelle pourrait sembler ne pas tendre au développement durable : la pollution existe, des réserves minérales s’épuisent. Et l’augmentation du nombre de maisons, de routes ou de centrales électriques par exemple contribue directement à l’augmentation des émissions polluantes.
On comprend donc qu’une variation de 1 point de la croissance à long terme ait des conséquences très importantes sur la quantité de gaz à effet de serre émis. Cela implique que poser le problème du changement global comme dans DICE36 de W. Nordhaus, c’est à dire en intégrant à la fois la crois-sance et l’environnement, c’est poser la question d’un arbitrage entre ces deux termes.
Pour mesurer la durabilité de la croissance, certains économistes définissent et mesurent un PIB « vert », qui prend en compte la variation du stock de patrimoine naturel. Malheureusement, cette façon de répondre à la question n’a pas encore eu toute l’ampleur ni le succès qu’elle méritait. En somme, les outils empiriques appropriés manquent.
Toutefois en théorie, la durabilité n’est pas impossible à atteindre . Le concept de ressources épuisables n’est pas si précis qu’il peut sembler au premier abord, les réserves dépendant des condi-tions techniques et économiques à une date donnée. L’accumulation du capital artificiel, matériel mais aussi humain, permet aussi d’utiliser plus efficacement les ressources futures.
La production de gaz à effet de serre n’est pas une fin en elle même, mais un effet secondaire indésir-able de la production de certains services comme le transport, le chauffage ou la fabrication de ciment. Mais il existe encore à l’heure actuelle de nombreuses définitions différentes de la durabilité.
On le voit, les économistes ignorent encore beaucoup de choses à la fois sur la notion même de du-rabilité et sur l’environnement, et se posent encore beaucoup de questions sur les mécanismes de la croissance à long terme. De plus, les résultats des modèles du type évoqué montrent qu’il est possible de réduire largement les émissions sans oblitérer significativement la croissance. C’est pourquoi il nous a semblé plus fructueux dans la suite et en particulier dans le modèle développé, de nous concen-trer sur d’autres aspects du problème du changement climatique que l’arbitrage entre l’environnement et la croissance.
On peut toutefois retenir qu’en principe, rien ne s’oppose à ce que les hommes accèdent au confort et la richesse en polluant moins. C’est ce que nous allons confirmer dans la suite en examinant en pratique le découplage énergie/croissance et la dématérialisation.
Le découplage énergie-croissance
Les deux sections précédentes nous ont permis de montrer que freiner la croissance démographique ou économique contribuerait à modérer le changement global, mais que nous n’allons pas étudier de telles politiques ici. Les mesures concrètes auxquelles notre travail se rapporte concernent plutôt l’intensité énergétique du PIB et le contenu en carbone de l’énergie. Dans cette section, nous allons voir maintenant que l’état actuel des connaissances permet d’envisager une baisse volontairement accélérée de l’intensité énergétique, permettant de réduire significativement les émissions malgré les deux croissances évoquées plus haut.
Le mot anglais est sustainable development, d’où l’anglicisme développement soutenable. Il est définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à de répondre aux leurs».
La Figure 2.14 montre l’évolution de l’intensité énergétique du PIB sur la longue période pour cinq pays développés. On voit que la tendance actuelle est à la décroissance, après être passé par un maxi-mum. Cela est usuellement expliqué en distinguant un effet de changement structurel et un effet de progrès technique.
On comprend bien la décroissance actuelle en considérant que dans nos pays post industrialisés, une plus grande part de l’accroissement du bien-être provient de la production de services immaté-riels : c’est le changement structurel. D’autres observations confirment l’idée selon laquelle l’in-tensité énergétique des pays, au cours de leur développement économique, décrirait une courbe passant par un maximum. (Martin, 1988).
Sur la Figure 2.14, on observe aussi que le maximum historique atteint par des pays industrialisés plus récemment est plus bas que celui des pays industrialisés plus tôt. Le maximum du Japon, par exemple, est inférieur au maximum de l’Allemagne. Cette remarque aussi est confirmée par d’autres observations. La décroissance des pics successifs correspond au progrès technique général.
L’intensité énergétique est le ratio de la consommation énergétique sur la consommation de biens et services finaux. C’est le troisième terme de l’identité dite de Kaya, la quantité d’énergie qu’il faut pour produire une unité de richesse moyenne. Par exemple, on mesure le nombre de sacs de charbon qu’il faut pour faire un lingot de fer. Notons que la mesure concerne ici les formes d’énergies commerciales. Si on inclut la biomasse, les courbes sont monotones décroissantes. Source Grübler (1989), Nakicenovic (1986) et Martin (1988), d’après Chapuis (1996).
Cela explique comment la production de richesses peut augmenter sans que la consommation d’éner-gie suive le même chemin. Il semble que c’est bien le cas dans les pays de l’OCDE depuis le milieu des années 70. La Figure 2.15 illustre ce découplage. On constate toutefois que le rythme actuel de dématérialisation semble insuffisant pour conduire à des réductions sensibles des émissions de gaz à effet de serre dans un délai proche.
D’un point de vue moins agrégé, plusieurs études indiquent que dans de nombreuses régions du monde, le rendement énergétique peut être accru de 10 à 30% à un coût négatif ou nul par rapport au niveau actuel dans les secteurs industriels, des transports ou de l’habitat, grâce à des mesures tech-niques d’économie et à l’amélioration des pratiques de gestion au cours des 20 à 30 prochaines années (M.J. Grubb, 1996). En utilisant les techniques qui, actuellement, fournissent la plus grande quantité de service énergétique pour un apport d’énergie donné, il serait techniquement possible, dans les mêmes pays, d’aboutir à des gains d’efficacité de 50 à 60% pendant la même période.
En conséquence, il est réaliste de vouloir agir sur l’intensité énergétique pour diminuer significative-ment les émissions. Bien que de grands progrès aient été observés, les perspectives d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le monde restent encore importantes.
Pour les pays développés, la diminution des émission évoquée plus haut signifie une baisse en termes absolus de la consommation énergétique. Mais pour les autres elle ne peut s’entendre que relative-ment à ce que les émissions auraient pu être en l’absence de politiques spécifiques. Dans ces pays, l’installation de nouveaux équipements rendus nécessaires par la croissance de la population et de la richesse augmentera nécessairement le niveau des émissions. On peut néanmoins concevoir ces équi-pements de manière à ce qu’au cours de leur cycle de vie, ils induisent des économies d’énergie no-tables par rapport à ce qu’a pu être le chemin de développement suivi par les pays de l’OCDE. Ce besoin d’équipements nouveaux peut donc aussi être vu comme une opportunité.
Le contenu en carbone des énergies
Promouvoir une utilisation plus efficace de l’énergie en général est nécessaire mais certainement in-suffisant pour limiter les émissions de gaz à effet de serre39. L’énergie reste un facteur de production parmi les plus importants, et on envisage difficilement une diminution notable de sa consommation à moyen terme, même dans un scénario de grande efficacité énergétique, le scénario C1 de l’IIASA illustré Figure 2.16 par exemple.
Il existe toutefois des différences notables dans le contenu en carbone des différentes sources possibles d’énergie. A énergie produite égale, le gaz naturel émet moins de COque le pétrole, lui même plus propre que le charbona. Agir sur la composition du mélange des sources d’énergie primaire (en anglais energy mix) constitue donc l’autre idée directrice des politiques visées ici, qui peuvent s’articuler en trois volets.
Le premier concerne la substitution entre les combustibles fossiles. Nous avons au chapitre pré-cédent que la ressource est considérée comme largement suffisante à l’échelle du siècle. consom-mer tout le potentiel techniquement réalisable de pétrole et de gaz classique, soit 300 GtC, ainsi que le quart des réserves de charbon, soit 800 GtC, conduirait dans l’hypothèse haute à un réchauf-fement global de 6.4 °C. Accroître l’utilisation du gaz naturel au siècle prochain est donc une me-sure susceptible de modérer le changement climatique, à condition que les fuites de méthane soient bien maîtrisés.
Le second concerne les énergies renouvelables (énergie solaire, énergie hydroélectrique, énergie éolienne, biomasse traditionnelle et moderne, énergie thermique des mers, par exemple). Celles ci en sont à divers stades de développement technique et de maturité commerciale, mais on s’attend à des réductions de coût importantes dans les prochaines décennies. La vision de leur rôle dans le futur est difficile à préciser, toutefois il est clair que leur potentiel n’est pas complètement exploité. Le troisième point concerne l’énergie nucléaire. Représentant actuellement environ 5% de l’énergie primaire produite (17% de l’électricité), c’est une technologie exploitée depuis plusieurs dizaines d’années dans de nombreux pays. Cependant, son utilisation pose des problèmes d’acceptabilité sociale, comme celui du choix des sites et la méfiance relative aux accidents; des problèmes poli-tiques comme le risque de prolifération des matières fissiles, et des problèmes écologiques comme le démantèlement et stockage des déchets. Des recherches actuelles visent à rendre son utilisation plus intrinsèquement sûre41, mais pour d’autres les perspectives concernant le coût de l’énergie nucléaire à moyen terme sont moins optimistes que celles concernant les énergie renouvelables. Comme le montre la Figure 2.16, on s’attend à ce que les combustibles fossiles constituent encore la source majoritaire d’énergie pour les prochaines décennies, mais que leur contenu en carbone tend à diminuer. Cette idée provient notamment de l’analyse du passé représenté Figure 2.17, et du fait que dans beaucoup de pays, il existe déjà une volonté consciente d’utiliser davantage de gaz naturel à la place du charbon42. Toutefois, on peut voir Figure 2.16 qu’il serait nécessaire d’aller bien au delà des tendances actuelles (scénario B) pour éviter un doublement des émissions d’ici 2050.
Une façon de comparer les divers combustibles consiste à calculer le rapport du nombre d’atomes de carbone sur le nombre d’atomes d’hydrogène dans une quantité donnée de combustible. Le bois est le plus riche en car-bone, avec un ration C:H de l’ordre de 10, puis viennent le charbon (C:H » 1), le pétrole (C:H» 1:2) et enfin le méthane (C:H» 1:4)
La discontinuité en 1974 reflète que les données 1860-1974 proviennent de l’IIASA, celles sur 1974-1995 de ENERDATA. La qualité données est variable, l’évaluation de la biomasse restant problématique, et la conver-sion de l’électricité l’hydro et nucléaire en énergie primaire étant conventionnelle. On observe toutefois que la part relative des combustibles les plus riches en carbone tend à décroître avec le temps. La période de domina-tion du charbon a coïncidé avec l’expansion du chemin de fer, de l’acier et de l’électrification des usines. Dans les années 1960, la prédominance du pétrole a coïncidé avec le développement du transport automobile, de l’industrie pétrochimique, et du chauffage domestique au fioul. En prolongeant ces tendances par un modèle logistique, Nakicénovic (1979) projette que le gaz naturel sera la source d’énergie prédominante au siècle pro-chain, le pétrole conservant toutefois la seconde place jusque dans les années 2020.
Conclusion
En résumé, les conditions socio-économiques du problème sont marquées par l’opposition entre la croissance (démographique et économique) et le progrès technique. Ce dernier, peut être entendu comme la décroissance du ratio CO / PIB . En première approximation, on peut étudier à la place le ratio E / PIB, ce qui a l’avantage de se ramener à problème étudié depuis longtemps, celui de l’inten-sité énergétique du PIB, mais l’évolution du contenu en carbone des formes d’énergie (ratio2 CO/E) est aussi importante.
La Figure 2.18 illustre l’existence d’un tel progrès technique : l’intensité en COdu PIB mondial a diminué d’environ 1/6 en 20 ans, soit une baisse de l’ordre de moins de 1% par an. Compte tenu de l’augmentation du PIB et de celle de la population, il est aisé de conclure que à l’évidence que, sans mesures politiques spécifiques, le progrès technique fera suffisamment progresser l’efficacité énergé-tique pour stabiliser les émissions.
On peut donc conclure qu’en l’absence de politiques spécifiques, il se produirait quand même un cer-tain progrès technique, le taux de pollution baisserait « naturellement », mais pour éviter les interfé-rences sérieuses avec le climat, il serait nécessaire d’accélérer le progrès technique au delà de ce taux « naturel ». Toute la thèse est à propos de cette accélération.