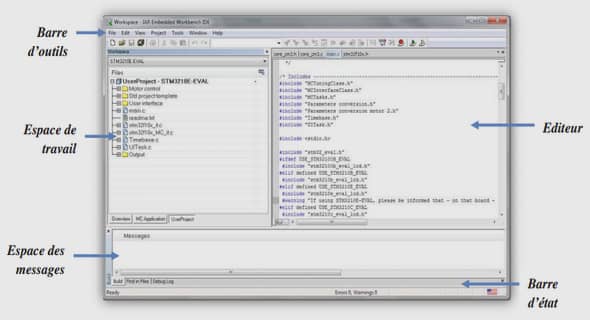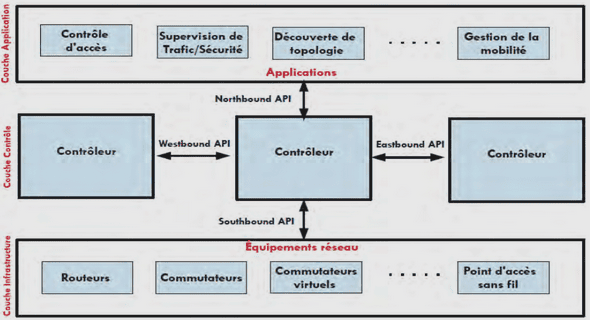Le vieillissement des individus et les « personnes âgées »
Le vieillissement est un processus global progressif, une transition de l’âge adulte à la fin de vie caractérisée par des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l’organisme. L’homme étant à la fois un être biologique, pensant et social (Henrard, 2002), le vieillissement constitue un processus complexe qui se caractérise par différentes facettes.
Vieillissement biologique
Pris dans sa dimension biologique, le vieillissement (ou la sénescence) de chaque individu correspond au produit de l’accumulation d’un vaste éventail de dommages moléculaires et cellulaires au fil du temps qui entraine une dégradation progressive des capacités physiques, mentales, une majoration de risque de maladie et finalement le décès (OMS, 2018a). Le vieillissement est la résultante des effets conjugués de facteurs génétiques, des habitudes de vie et d’autres facteurs environnementaux auxquels est soumis l’organisme tout au long de la vie et qui agissent comme facteurs de risque ou de protection (Henrard, 2002 ; Jeandel, 2005 ; OMS, 2002). Le nombre, le poids de ces facteurs ainsi que leurs différents degrés d’interaction rendent le vieillissement biologique très hétérogène d’un individu à l’autre. Chaque individu se caractérise par une marque génétique acquise en grande partie dès la naissance. Des mutations génétiques peuvent être observées au cours de la vie rendant le génome instable et susceptible de modifications. En outre, des facteurs exogènes, relatifs le plus souvent à l’environnement des individus et à leurs conditions de vie sont en interrelation avec ce génome dont ils influencent la stabilité. Par exemple, un travail physiquement éreintant et des conditions de vie pénibles peuvent entrainer une usure prématurée de l’organisme. Le vieillissement biologique résulte donc à la fois du patrimoine génétique, qui commande la plus ou moins grande susceptibilité aux maladies, et du parcours de vie des individus. C’est un processus lent et progressif qui se distingue des manifestations de maladie, l’état de santé des individus résultant des effets du vieillissement et des effets liés aux maladies actuelles et passées (Collège national des enseignants en gériatrie, 2000).
Vieillissement psychologique
Tout comme le vieillissement biologique, le vieillissement psychologique est la résultante d’une action conjuguée de facteurs génétiques et environnementaux qui se caractérise par un déclin progressif des fonctions intellectuelles (Henrard, 1997). Un vieillissement différentiel existe selon le type de fonction et le niveau d’instruction des individus. En effet, les aptitudes développées lors de l’apprentissage sont celles qui se maintiennent le plus tandis qu’il existe en général un déclin des facultés de concentration. De plus, même si les aptitudes développées lors de l’apprentissage se maintiennent en général, un déclin plus prononcé peut tout de même s’observer chez les personnes ayant un faible niveau d’instruction.
Vieillissement social
Enfin, au-delà des changements biologiques et psychologiques, le vieillissement est également associé à l’idée que chaque société définit un parcours de vie marqué par des étapes spécifiques dont le passage d’une étape à la suivante dépend d’évènements socialement significatifs de l’avancée en âge (Henrard, 1997). Le vieillissement social correspond à une succession de changements relatifs au rôle familial, au rôle professionnel, aux ressources ou encore aux relations sociales et à la santé. Le passage à la retraite qui n’est pas physiologique ni psychologique constitue un phénomène social qui fait passer les individus dans le groupe des retraités et des personnes âgées (Hervy, 2008). Le regard que la société porte sur ce groupe de population devient alors différent de par son inactivité professionnelle. Dans certains pays du Nord, les retraités sont perçus comme une charge qu’il importe à la famille et aux pouvoirs publics d’assumer. Dans certains pays du Sud, notamment les pays asiatiques, le regard de la société sur les retraités est beaucoup plus mélioratif car ils sont respectés par tous et sont perçus comme profitant d’une retraite bien méritée après avoir effectué leur devoir envers leur famille et leur pays (Vigouroux-Zugasti, 2014).
Le vieillissement de chaque individu dispose d’une composante biologique, psychologique et sociale. Ces différentes dimensions qui agissent en interaction sont variables d’un individu à l’autre, d’une époque à l’autre ou encore d’un pays à l’autre.
Le groupe des « personnes âgées »
Les individus, leurs parcours de vie et leurs vieillissements sont infiniment diversifiés. Comme nous venons de le voir, les catégories sociales, comme celles des
• personnes âgées », peuvent dépendre aussi bien de processus biologiques, psychologiques, sociaux, culturels et économiques. Il n’est donc pas possible de déterminer avec certitude le moment où chaque personne est à inclure parmi les
• personnes âgées ». Dans le cadre de notre recherche, le choix se porte plus particulièrement sur la population âgée de 65 ans et plus. Même si ce regroupement reste imparfait il est nécessaire étant donné que les données statistiques disponibles se réfèrent avant tout à un critère d’âge. En outre, cette définition est commode puisque cet âge est étroitement associé au moment décisif que représente le retrait de la vie active. C’est une étape de la vie qui entraine d’importants changements dans les niveaux et les sources de revenus, les activités, les attentes et le statut social.
Cette limite d’âge est également souvent reprise par les lois et les institutions.
Le vieillissement de la population
Le vieillissement de la population (aussi appelé vieillissement démographique) représente aujourd’hui un phénomène mondial. Ce terme est généralement utilisé pour désigner une augmentation de la proportion de personnes âgées de plus de 60 ou 65 ans. Il est à distinguer du « vieillissement » propre à chaque individu qui se manifeste avec l’avancée en âge.
Un phénomène mondial
Selon les Nations Unies (2017), plusieurs aspects démographiques vont caractériser les cinquante prochaines années. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus s’élève en 2017 à 962 millions ce qui représente environ 13% de la population mondiale. Cette proportion de personnes âgées augmente plus rapidement que les autres tranches d’âge avec une hausse d’environ 3% par an. D’ici 2050, le nombre de personnes âgées devrait être à l’échelle mondiale de 2 milliards et pourrait atteindre en 2100 les 3,1 milliards. La population la plus âgée, c’est-à-dire la catégorie des 80 ans et plus, est elle-même vieillissante. Son nombre devrait tripler d’ici 2050 et représenter 1/5ème de la population âgée. L’élargissement par le sommet de la pyramide des âges à l’échelle mondiale entre 2007 et 2057 (cf. Figure 1) fait nettement ressortir cette structure vieillissante de la population. A mesure que la proportion des populations les plus jeunes (0-20 ans) diminue et que celle des 60 ans et plus augmente, la pyramide des âges qui prend une forme triangulaire en 2007 est progressivement remplacée par une structure de forme plus cylindrique en 2057. Même si la proportion de personnes âgées est plus élevée en Europe (25% de la population) et en Amérique du Nord (22% de la population), l’ensemble des continents (mis à part l’Afrique) auront d’ici 2050 plus d’un quart de leur population âgé de 60 ans et plus.
Ce vieillissement de la population mondiale résulte d’une transition démographique, c’est-à-dire du passage des sociétés d’un régime pré-moderne caractérisé par des taux élevés de fécondité et de mortalité à un régime post-moderne caractérisé par des taux plus faibles (McCracken & Phillips, 2005). La transition débute lorsque le taux de la mortalité infantile est en baisse grâce au contrôle des maladies infectieuses et parasitaires. La croissance de la population s’accélère avec une hausse de la proportion des enfants et des jeunes adultes : c’est la génération du « boom ». En raison de progrès sociaux, médicaux et de santé publique, le taux de fécondité amorce ensuite un repli faisant reculer ainsi le nombre d’enfants et augmenter la proportion de personnes en âge de travailler. La dernière phase de la transition démographique se caractérise enfin par une vague de vieillissement liée à celui de la génération du boom qui, conjuguée à la baisse de la fécondité et à l’allongement de l’espérance de vie, amorce une population démographiquement vieillissante.
A l’échelle mondiale, les taux de fécondité ont baissé de façon constante mais selon un rythme variable en fonction des régions (Nations Unies, 2017). Il y a encore un siècle, les femmes avaient dans les pays développés en moyenne cinq ou six enfants alors que la norme d’aujourd’hui est passée à un ou deux enfants. La taille des familles est également en baisse dans les pays en développement. L’Afrique qui enregistre les taux de fécondité les plus élevés à l’échelle mondiale affiche un taux de fécondité passant de 5,1 enfants par femme en 2000-2005 à 4,7 enfants par femme en 2010-2015. Les pays à faible fécondité comprennent désormais toute l’Europe et l’Amérique du Nord mais également plusieurs pays d’Asie (Singapour, la Corée du Sud et la Chine ont des taux de fécondité inférieurs à 2 enfants par femme) et d’Amérique Latine (le Brésil, le Costa Rica et le Mexique ont des taux de fertilité inférieurs à 3 enfants par femme). Les taux de fécondité chutent dans ces pays depuis les années 1970-1980. D’ici 2045-2050, environ 69% de la population mondiale devrait vivre au sein de pays dont le taux de fécondité serait en moyenne de 2,1 enfants par femme (cf. Figure 2). De plus, un nombre croissant de pays affiche désormais des taux de fécondité inférieurs au niveau de remplacement qui est de 2,1 enfants par femme. Certains d’entre eux, parmi lesquels la Bulgarie, la Croatie, la Pologne, la Roumanie ou encore la Serbie, se localisent en Europe et affichent parfois des taux de fécondité atteignant 1,0 enfant par femme. La taille de leur population devrait diminuer si la perte liée à l’excédent des décès sur les naissances n’est pas compensée par un gain lié à une migration nette positive.