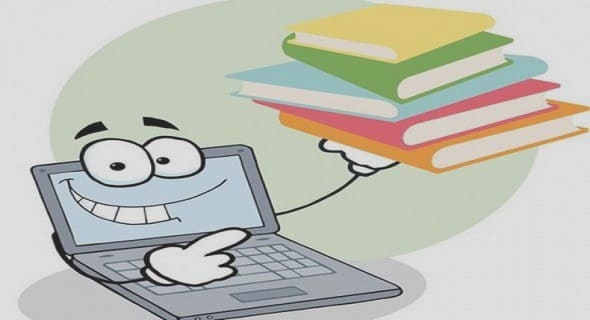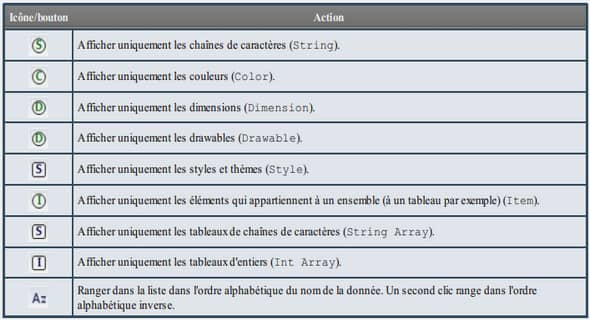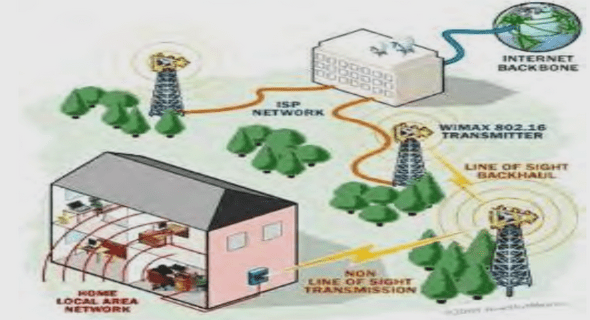Le centre historique comme laboratoire du changement social
Les mutations socio-spatiales intervenues dans le centre-ville d’Athènes ont été développées en détail dans notre mémoire du Master 1. Brièvement ici, nous allons présenter quelques dates de référence de cette évolution, ainsi que de sa relation avec les questions d’immigration et d’intégration.
Selon Paul Levy, le centre-ville est tout d’abord un « espace social » qui témoigne, d’une part, des rapports sociaux qui évoluent dans une société à un moment donné et, d’autre part, d’un ensemble de transformations sociales, économiques, politiques et idéologiques. Autrement dit, le centre-ville est « un excellent poste d’observation du changement social »1. Selon lui, il est un objet d’étude qui permet d’analyser les spécificités locales, mais surtout de généraliser à travers ces mécanismes et ces processus.
Pour la plupart des auteurs, le centre-ville athénien est vu comme un espace transitoire et présente un grand intérêt sociologique. On ne peut pas comprendre son état actuel sans étudier son histoire récente. En effet, comme dans d’autres villes, « les rapports que la société et les classes sociales ont établi avec l’espace urbain, ne peuvent être appréciés que replacés dans la durée »2.
En 1830, Athènes est déclarée capitale du jeune état grec. Un choix hautement symbolique. Selon Yannis Tsiomis, « les raisons qui conduisent à son choix comme capitale du nouvel Etat hellénique tiennent justement à son nom et à la charge de l’histoire, plutôt qu’à ses qualités »11.
A la fin des guerres balkaniques, qui durent jusqu’en 1917, et après la catastrophe d’Asie Mineur en 1922, la ville connait une importante croissance démographique et économique. Elle est surtout due à l’arrivé des réfugiés, plus d’un 1.200.000 sur une population de moins de 4.000.000 d’habitants. Après la deuxième guerre mondiale et la guerre civile, l’urbanisation est rapide et les fortes mutations sociales qui en résultent laissent leurs empreintes sur l’espace. Nombreux auteurs, comme Guy Burgel12 et Bernard Kayser,13 soulignent ces changements. Le premier analyse les stades de la formation de la capitale dite « hypertrophique » qui concentre tout le pouvoir administratif et économique du pays. Le second, met en évidence les fortes coupures sociales qui apparaissent dans l’espace.
Dans les années quatre-vingt-dix, un Grec sur trois habite déjà dans l’Agglomération urbaine d’Athènes (59 municipalités et communes) soit 35% de la population grecque. Aujourd’hui, ce pourcentage a augmenté, il approche 38%, puisque presque 3.800.000 personnes habitent dans le Grand Athènes, sur une population totale de 10.500.000 d’habitants. Il s’agit d’une des plus fortes concentrations de population dans l’espace européen.
Notre quartier de recherche, le quartier de Metaxourgio, est situé dans la partie ouest du centre-ville, et fait partie des premiers quartiers historiques de la capitale. Il possède un plan d’aménagement depuis ses débuts, mais puisque ce plan n’a pas été appliqué dans son ensemble, cette partie de la ville a été formée illégalement. Tandis que les habitations bourgeoises, le palais et les bâtiments administratifs se localisaient à l’est de la ville, l’ouest acquiert un tout autre caractère15. Deux usines, l’une de gaz et l’autre de soie, ainsi que de plus petites unités artisanales et industrielles ont contribué, avec les divers lieux de stockage, au caractère industriel du quartier.
Ce caractère industriel attire à son tour une population de travailleurs pauvres dans leur ensemble, y compris des immigrés des différentes provinces de la Grèce insulaire16. Parallèlement, ce fort accroissement de la population de la capitale du principalement à l’exode rurale durant l’entre-deux-guerres conduit à une augmentation de la demande d’habitations. L’habitat se mélange avec les autres fonctions, et tout au long de la première moitié du XXème siècle le quartier conserve ce mélange fonctionnel et social. Comme le souligne Christina Agriantoni, la formation du quartier est le résultat de l’interaction entre deux tendances opposées17 : d’un côté, l’extension de la zone d’habitat et, de l’autre, la forte présence d’activités productives.
Même après une première vague de départs dans les années soixante, cette mixité fonctionnelle reste visible jusqu’aux années quatre-vingt-dix. De plus en plus de chercheurs parlent de cette partie de la ville comme d’un territoire « en transition ». Ils soulignent l’image diachronique et les dynamiques que traversent l’espace et sa population18. D’un espace abandonné par la population sédentaire dans les années 1960-1970, le quartier voit apparaître des dynamiques multiples et se trouve au centre d’enjeux partagés entre divers acteurs: l’état et la municipalité, les investisseurs privés, les immigrés chinois et leurs commerces.
Dans ces mêmes années quatre-vingt-dix, Athènes reçoit les premières vagues d’immigration. Les migrants trouvent au début de leur installation des logements dans le centre-ville, à coté des places centrales, Omonoia et Vathis. Selon Dina Vaiou19, ces premiers arrivés ont quitté leurs premiers lieux d’installation pour s’installer dans d’autres quartiers, comme Kipseli et Patissia. Aujourd’hui, ce sont les immigrés asiatiques de l’Inde, du Pakistan, de la Chine et du Bangladesh, qui habitent et travaillent dans ces zones de transition, en remplaçant les premiers venus20.
Les chercheurs de l’Ecole de Chicago ont été les premiers à souligner le rôle prépondérant du centre-ville comme laboratoire du changement social. Le schéma d’Ernest Burgess21 sur la division de la ville et la concentration de migrants dans des zones de transition à coté des centres-villes, présente un intérêt particulier pour notre étude de cas. C’est particulièrement vrai pour les quartiers à l’ouest du centre historique athénien où de nombreux migrants s’installent, comme c’est le cas du terrain d’étude choisi.
L’homogénéité de l’espace social remis en question
Dernièrement, un débat scientifique s’est ouvert autour de la ségrégation urbaine à Athènes, de l’existence ou non de véritables ghettos urbains. Tandis que certaines études parlent de phénomènes absolus d’exclusions spatiales et sociales22, d’autres affirment qu’on ne peut pas encore parler d’espaces totalement ségrégés.
Aujourd’hui, dans certains quartiers d’immigrés récents et où vivent de nombreux illégaux, Liosia et Agios Panteleimonas plus particulièrement, les problèmes sociaux augmentent et deviennent même très aigus23. La relativement bonne « cohabitation » qui existait entre immigrés et sédentaires s’effrite24. Dans d’autres quartiers, comme Patissia et Kipseli, des problèmes de cohabitation existent mais sans encore prendre des aspects négatifs concrets. Le manque de politique d’intégration et d’amélioration des conditions de vie et de séjour des immigrés, se fait de plus en plus sentir.
De manière générale, à notre avis, Athènes réussit mieux que d’autres capitales européennes à éviter les fortes coupures sociales provoquées par l’isolement des migrants dans les quartiers périphériques, un des avantages de l’espace urbain athénien restant la persistance d’une forte mixité sociale et urbaine.
Pourtant cet avantage régresse. En mai dernier, après un contrôle policier dans le centre-ville, a eu lieu la première grande manifestation d’immigrés devant le Parlement, sur la place de la Constitution. Elle a tourné à l’émeute et à la destruction de commerces et de voitures sur la voie publique. Cette première manifestation spontanée, quelques jours avant les élections européennes, reflète un véritable problème de fond25.
Une autre particularité du cas d’Athènes est que les différenciations sociales et économiques s’inscrivent nettement dans le tissu urbain et tout particulièrement dans la distribution verticale des appartements dans les immeubles. Selon ce principe, qui a été analysé à travers les travaux de recherches dirigées par Thomas Maloutas, aux sous-sols et dans les plus bas étages s’installent les immigrés, aux étages moyens les étudiants et divers bureaux et aux étages supérieurs, dans les appartements dits « en retirés », habitent des familles grecques, le plus souvent composées de personnes âgées. Ils sont propriétaires pour la plupart. Cette distribution verticale reflète un véritable « ordre social » dans l’espace urbain26.
Durant ces vingt dernières années, les clivages sociaux dans la capitale grecque s’intensifient, d’une part à cause de l’abandon du centre-ville par les classes aisées et moyennes et les jeunes ménages au profit des quartiers nord-est et sud de la ville et, d’autre part, par l’arrivée massive de nouveaux migrants. Ceci contribue à un net processus de ségrégation social qui est en cours27.
Populations migrantes et répartitions géographiques
PULL FACTORS : vers un modèle méditerranéen
A la fin des années quatre-vingt, la Grèce, dans un très court laps de temps, se transforme de pays d’émigration en pays d’immigration. Au recensement de 2001, le nombre d’immigrés dans le pays s’élève à 762.000 personnes, pour une population de 11.000.000 habitants. Parmi les pays d’Europe du sud, Italie et Espagne, la Grèce à le plus grand nombre d’étrangers à sa population28. En plus, il faut noter que ces sources officielles ne sont qu’indicatives du nombre réel des immigrés en Grèce, car elles ne tiennent pas compte de ceux au statut illégal29.
Parmi les nombreux facteurs qui expliquent le tournant migratoire apparu en Grèce, nous soulignons, les changements politiques survenus dans les pays de l’ex Union Soviétique et des Balkans et la déstabilisation économique qui y a conduit à un courant d’émigration important. Parallèlement, les taux d’évolution économique en Grèce restent élevés, entre 4% et 6%, et cela jusqu’aux Jeux Olympiques de 2004. Depuis ils faiblissent. En vue de cet événement, une forte demande en main d’œuvre flexible et temporaire a été créée.
Le taux élevé de développement économique conduit un nombre grandissant de femmes grecques à entrer dans la vie professionnelle, ce qui crée de nouveaux besoins pour une main d’œuvre féminine avec des bas salaires, surtout dans la confection et le travail domestique. Ce phénomène est à la base d’une « féminisation » grandissante de l’immigration. Notons que 45% des migrants sont des femmes30.
Une autre caractéristique importante qui influence l’immigration vers le Grèce est l’existence d’un large secteur économique informel. Dans la société d’accueil, ce type de travail est bien accepté et il est nettement renforcé par le statut illégal de nouveaux migrants. Nous pouvons même dire que c’est un arrangement communément admis, surtout dans le secteur de la construction et du travail domestique.
Ces deux caractéristiques sont aussi observées dans les pays d’Europe du sud, particulièrement en Italie et en Espagne. Ensuite, la formation urbaine toute différente par rapport aux pays de l’Europe occidentale conduit certains chercheurs à parler d’un Caractéristiques sociales et répartitions géographiques
La majorité des immigrés en Grèce sont des Albanais (56%), ensuite viennent les Bulgares (5%), les Georgiens (3%) et les Roumains (3%). Une grande asymétrie caractérise la répartition par sexe des différents catégories ethniques: la présence de femmes est inexistante chez les migrants originaires du Pakistan, Bangladesh et Inde, tandis qu’elles sont majoritaires parmi les migrants venant de Bulgarie, Géorgie, Ukraine, Moldavie ou Philippines. La répartition par sexe chez les Albanais est presque égale : 60% des hommes et 40% des femmes.
L’occupation professionnelle des migrants suit des modèles différents, tant au niveau du genre que des origines ethniques. Les migrants hommes venant d’Albanie, de Pologne ou de Géorgie travaillent dans le bâtiment, tandis que ceux originaires d’Inde et du Pakistan s’occupent dans l’agriculture. Plus de la moitié des femmes, toutes origines confondues, ont un travail domestique, principalement le soin de personnes âgées ou d’enfants en bas âge33. Les migrantes de Roumanie et de Bulgarie travaillent elles exceptionnellement dans l’agriculture et le tourisme.
Ne manquons pas de souligner ici que l’Etat grec n’a pas de politique d’ensemble pour l’intégration des immigrés dans la vie sociale et économique du pays. Les services compétents font preuve d’incapacité ou de laxisme dans la gestion des courants migratoires. Il laisse au marché le soin de répondre aux problèmes d’emploi et d’hébergement des nouveaux venus. Au niveau de leur insertion spatiale, aucune mesure n’est prise pour faciliter l’accès au logement. En effet, le rôle de l’état s’exprime surtout à travers sa volonté de contrôler les flux et les entrés dans le pays, surtout pour ceux qui désirent entrer illégalement des côtes turques. Caractéristique de la réalité qu’affrontent les migrants en Grèce est que la première loi pour la légalisation de leur statut n’apparaît qu’en 1997.
La loi 358/1997, après un recensement rapide des migrants, a conduit à la délivrance de carte de séjour, les cartes dites « vertes », pour 200.000 immigrés. Elle a été suivie d’une politique de restriction des entrées et à un strict contrôle policier qui visait à l’expulsion des illégaux34. Ce premier cadre juridique a été complété en 2001 lorsque certaines mesures de politique sociale ont été prises : reconnaissance des droits fondamentaux, mesures facilitant l’intégration et le regroupement familial, droits à la sécurité sociale, accès des mineurs à l’éducation, reconnaissance du statut de réfugié.
Au niveau national, la plus grande concentration d’immigrés est observée à Athènes où ils représentent 17% des habitants. Ensuite, une importante concentration est observée en Grèce insulaire et en particulier en Crète, à Rhodes, à Corfou et à Zakynthos. On peut dire que leur répartition géographique se trouve en liaison étroite avec la forte demande de main d’œuvre, en premier lieu dans la capitale et ensuite dans les îles pour les besoins du tourisme.