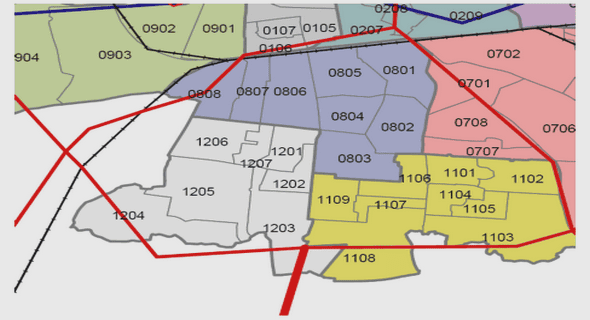La fameuse définition d’Edward Tylor :
Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. (Tylor, 1871)
Ou encore celle de Richerson et Boyd par exemple :
Culture is information capable of affecting individuals’ behavior that they acquire from other members of their species through teaching, imitation, and other forms of social transmission. (Richerson & Boyd, 2005)
sont des définitions de type tout ou rien. Au contraire, avec la définition que nous proposons, les éléments peuvent être plus ou moins fortement culturels. Ainsi, l’information qu’il y a du beurre dans le réfrigérateur doit certaines de ses propriétés, comme la référence au beurre, à des chaînes de transmission sociale étendues, mais d’autres propriétés comme la référence au moment présent et à un réfrigérateur particulier, à une chaîne de transmission très courte et très locale. Considérer la culture comme une propriété graduelle plutôt que comme une chose ou un ensemble de choses nous semble pertinent pour en décrire l’évolution (voir aussi la partie 1.1, pp 21).
Avec la définition de la culture que nous proposons, trois ensembles de théories de l’évolution culturelle utilisent le darwinisme dans un sens analogique : la théorie mémétique, la théorie de la coévolution gène-culture et la théorie de l’épidémiologie culturelle. Bien que ces trois théories se réclament toutes du darwinisme, elles font chacune appel à différentes versions, plus ou moins contraignantes, de la théorie darwinienne. Pour analyser les relations qu’entretiennent ces différentes théories entre elles et avec les théories biologiques, il nous sera utile de commencer par définir un cadre d’analyse qui nous servira de guide tout au long de ce travail.
La méthode générale que nous développerons dans le premier chapitre sera fondée sur une approche naturaliste des phénomènes culturels et des éléments d’analyse historique et conceptuelle des théories darwinienne ayant cours en biologie.
Dans un premier temps nous verrons que les phénomènes sociaux, comme une manifestation par exemple, peuvent être décrits comme une succession de micro-événements constitués d’un enchaînement de représentations mentales, comme le fait que je pense qu’il faut aller manifester, et de productions publiques, comme le fait que je me rende effectivement à la manifestation, ou que j’en parle à mes collègues. Généralement ces enchaînements causaux sont limités dans le temps et dans l’espace, une manifestation n’impliquant qu’un nombre limité de personnes durant une courte période. Cependant, dans certains cas ces chaînes causales sociales peuvent s’étendre, dans le temps et dans l’espace, de telle sorte que les éléments qui en font partie deviennent culturels. Pensez par exemple à un conte pour enfant, transmis de génération en génération des adultes vers les enfants et reproduits dans les livres, les dessins animés, etc. De ce point de vue, l’étude de la culture, de son origine et de son évolution, revient à étudier les facteurs psychologiques, écologiques et autres qui stabilisent ou déstabilisent les chaînes causales, donc qui modifient la fréquence des éléments culturels.
Cette description des phénomènes culturels permet d’envisager ceux-ci sous un angle populationnel favorable à un développement des modèles darwiniens. Nous verrons que les théories darwiniennes peuvent être séparées en trois cadres conceptuels emboîtés : le cadre de la pensée populationnelle, le cadre sélectionniste et le cadre des réplicateurs (du plus large au plus restrictif). Le cadre populationnel est lié à la description de l’évolution en termes de changements des caractéristiques des populations et s’oppose au cadre typologique, ou essentialiste. Par exemple, la position des continents sur terre évolue au cours des temps géologiques par transformation des propriétés de la croûte terrestre et du manteau sous-jacent. Cette évolution n’implique pas un modèle populationnel. Au contraire, lorsque l’on dit que les espèces évoluent, ce n’est pas par transformation progressive des individus qui les composent, mais par modification des caractéristiques des populations d’individus.
Le cadre sélectionniste, en plus des hypothèses du modèle populationnel, suppose que la sélection darwinienne joue un rôle dominant dans l’évolution. C’est le cas en biologie bien sûr, où l’évolution biologique s’explique principalement par la sélection naturelle.
Enfin, le cadre des réplicateurs suppose, en plus des hypothèses du cadre sélectionniste, que la réplication est un mécanisme fondamental donnant lieu au processus d’évolution par sélection darwinienne. En biologie la réplication correspond au fait qu’une molécule d’ADN est utilisée pour produire deux molécules d’ADN quasiment identiques (aux mutations près). Ce processus garantit la transmission fidèle de l’information génétique des parents aux descendants et c’est cette fidélité qui permet la sélection naturelle de se mettre en place, comme nous aurons l’occasion de l’expliquer plus en détail.
A chacun de ces cadres conceptuels darwiniens – populationnel, sélectionniste et des réplicateurs – correspond une théorie de l’évolution culturelle : la théorie de l’épidémiologie culturelle, la théorie de la coévolution gène-culture et la théorie mémétique respectivement.
Les termes ‘épidémiologie culturelle’, ‘mémétique’ et ‘théorie de la coévolution gène-culture’ peuvent désigner des ensembles théoriques assez vastes. La mémétique par exemple, qui connaît un succès grandissant, a donné lieux à la publication de nombreuses variantes théoriques dont les ouvrages suivants donnent un aperçu de la diversité. Robert Aunger dans Electric Meme (2002) suggère qu’il est primordial de trouver le substrat physique des mèmes pour fonder une science mémétique et propose que les mèmes sont des patterns d’activité électrique cérébrale. Susan Blackmore dans Meme Machine (1999), Aaron Lynch dans Thought Contagion (1996) et Richard Brodie dans Virus of the Mind (1996) développent les conséquences de l’approche mémétique pour des phénomènes aussi divers que l’évolution du langage, le sexe, l’augmentation de la taille de l’encéphale dans la lignée humaine, la politique, l’économie, etc. Stephen Shennan dans Genes, Memes and Human History (2002) prend quant à lui une position plus distante vis-à-vis de la théorie mémétique et vante les mérites d’une approche darwinienne en archéologie. Shennan considère la mémétique comme un exemple, ou une source d’inspiration pour développer une approche darwinienne des phénomènes culturels, plus que comme une théorie à part entière ayant des propositions spécifiques. Le spectre des positions et des variations concernant la mémétique est donc assez vaste, il couvre aussi bien les personnes attribuant aux mèmes une réalité physique que celles prenant la mémétique pour une incitation à développer l’analogie entre phénomènes culturels et biologiques.
Notre objectif dans ce travail ne sera pas de fournir une étude exhaustive et détaillée de toutes les théories modernes de l’évolution culturelle. Au contraire, nous chercherons à extraire de toutes ces théories des ensembles de propositions originales pouvant être reliées au darwinisme et comparées à l’évolution biologique. Nous passerons donc moins de temps à discuter de la diversité rencontrée au sein de chaque ensemble théorique, que des propositions qui les unissent. Nous utiliserons les termes ‘épidémiologie culturelle’, ‘mémétique’ et ‘théorie de la coévolution gène-culture’ dans ce sens restreint, comme désignant un ensemble de propositions originales formant le cœur de l’ensemble des positions qui leur sont généralement associées.
Partant de l’analogie la plus poussée entre l’évolution culturelle et l’évolution biologique, c’est-à-dire de la mémétique, nous élargirons progressivement le cadre darwinien de notre étude en nous tournant successivement vers la théorie de la coévolution gène-culture et ensuite vers la théorie de l’épidémiologie culturelle.
La mémétique, proposée initialement par Richard Dawkins, suggère que l’évolution biologique et l’évolution culturelle sont étroitement analogues et qu’il existe un équivalent culturel des gènes, les mèmes, qui sont les briques fondamentales de l’évolution culturelle. Nous montrerons que cette théorie repose sur l’idée qu’il existe dans le domaine culturel un mécanisme psychologique équivalent à la réplication en biologie.
Pour qu’un tel équivalent psychologique existe, il faut que le mécanisme de transmission des éléments culturels soit fidèle et indépendant du contenu des éléments qu’il transmet (comme la réplication est fidèle et indépendante du contenu informationnel de la molécule d’ADN). Nous montrerons qu’il existe un compromis (‘trade off’) entre la fidélité et la quantité d’information qui peut être répliquée fidèlement par un mécanisme : plus la quantité est importante, plus la fidélité doit être élevée. En biologie, la fidélité de la réplication est sous contrôle de la sélection naturelle et nous en conclurons que pour qu’un mécanisme psychologique analogue à la réplication en biologie existe, il faut nécessairement qu’il ait été sélectionné pour être fidèle. Nous verrons que les mécanismes d’acquisition du chant de certains oiseaux ainsi que celui d’acquisition de la phonologie ont des caractéristiques proches du mécanisme de réplication. Dans ces deux cas particuliers et probablement dans d’autres cas qui restent à étudier, la mémétique pourrait être appropriée.
Dans le cas général cependant, le principal mécanisme susceptible de jouer un rôle équivalent à la réplication, l’imitation, n’est pas assez fidèle pour jouer pleinement ce rôle. Nous en conclurons que le modèle mémétique possède un domaine d’application relativement restreint et ne peut pas servir de base à une théorie générale des phénomènes culturels.
Une alternative à la théorie mémétique considère que le mécanisme de réplication n’est pas indispensable à la théorie darwinienne, du moment que la sélection est un facteur dominant de l’évolution. La théorie de la coévolution gène-culture part de cette idée. Tout en reconnaissant qu’il existe de nombreux mécanismes propres au domaine culturel, elle suggère que la sélection darwinienne joue un rôle fondamental dans l’évolution culturelle. Pour les défenseurs de la théorie de la coévolution gène-culture, l’évolution biologique aurait donné naissance à des mécanismes psychologiques originaux comme le biais de prestige ou le biais de conformisme, qui seraient à l’origine de la sélection culturelle. Tout en reconnaissant que la sélection des éléments culturels contribue à guider l’évolution culturelle, nous montrerons que son importance est à relativiser et dépend d’autres forces et mécanismes qui jouent aussi un rôle important dans cette évolution.
Cela nous conduira à évaluer l’importance de ces forces et mécanismes dans une dernière partie, dédiée à l’étude de l’épidémiologie culturelle. Nous défendrons l’idée selon laquelle les mécanismes psychologiques tendent à être modulaires et à maximiser la pertinence. Ces deux propriétés font que les mécanismes psychologiques transforment activement les inputs qu’ils reçoivent, donc qu’ils construisent les éléments culturels qu’ils transmettent. Par exemple, une histoire est rarement racontée deux fois de la même manière, même quand il s’agit du même conteur, car les locuteurs adaptent leurs discours en fonction des circonstances, de leur auditoire, de leur humeur, de l’endroit dans lequel ils se trouvent, etc. Cette grande hétérogénéité des transformations devrait logiquement conduire à une grande instabilité des éléments culturels. C’est ce qu’on observe très facilement en jouant au téléphone arabe par exemple, jeu dans lequel quelques phrases sont complètement transformées en seulement quelques étapes de transmission. Cependant, si les transformations successives qui ont lieu le long des chaînes causales ont une orientation particulière, cela peut donner lieu à une certaine forme de stabilité, que nous désignerons par le terme d’attraction.
Le phénomène d’attraction, conséquence à l’échelle de la population de ces transformations successives, permet d’expliquer de manière originale la stabilité des éléments culturels. La prononciation d’un mot par exemple, change en fonction de la personne qui le prononce, de l’endroit où le mot est prononcé… cependant, cela n’empêche pas cette prononciation d’être relativement stable à l’échelle de la population car les individus ‘corrigent’ les variations qu’ils perçoivent en en introduisant de nouvelles. Les variations successives s’annulent l’une après l’autre, donnant lieu à une prononciation stable.
Attraction et sélection sont donc les deux sources complémentaires de la stabilité des éléments culturels et nous verrons que cela suggère que l’évolution culturelle diffère sensiblement de l’évolution biologique. L’évolution culturelle est à penser dans un cadre darwinien, celui du modèle populationnel, où les modèles sélectionnistes et mémétiques ont une place, mais pas une place exclusive.
DEFINIR UN CADRE NATURALISTE ET DARWINIEN
Avant de nous lancer dans l’étude des modèles darwiniens de l’évolution culturelle à proprement parler, il faut trouver un moyen de décrire ces modèles dans des termes qui facilitent la comparaison et la mise en évidence des relations qu’ils entretiennent entre eux et avec les modèles de l’évolution biologique. Pour cela, nous suivrons l’approche proposée par Sperber dans le cadre de son épidémiologie culturelle. L’approche des chaînes causales repose sur la caractérisation des enchaînements causaux qui donnent naissance aux phénomènes sociaux et culturels. Par exemple, lorsqu’une personne vous tient la porte ouverte et qu’ensuite vous-même la tenez à une autre personne et ainsi de suite, il s’agit d’un enchaînement causal social typique.
En adoptant ce point du vue sur les phénomènes sociaux, nous aurons la possibilité de préciser d’avantage la définition de ‘culture’ que nous avons esquissée en introduction et nous verrons que les phénomènes culturels peuvent être conçus comme le résultat de chaînes causales sociales particulièrement longues et stables. Pour donner un exemple concret, le fait de tenir la porte à la personne qui vous suit est une pratique qui se transmet et diffuse d’individus en individus à travers l’observation du comportement d’autrui, à travers certaines conversations, etc.
L’évolution d’une pratique est ainsi conçue comme le résultat d’un ensemble de micro-événements comme la réalisation de cette pratique, la lecture ou l’écriture d’instructions la concernant, la démonstration par un individu compétent de sa réalisation, etc. Ces micros-événements contribuent plus ou moins fortement à stabiliser ou à déstabiliser la pratique en question et ainsi permettent d’expliquer la persistance de différences culturelles. Le fait de tenir la porte au suivant par exemple, est une pratique typiquement française. L’approche défendue par Sperber permet ainsi de faire le lien entre les micros-événements sociaux et leurs conséquences macroscopiques à l’échelle de la population.
Cette approche générale trouve bien évidemment son origine dans le domaine biologique. L’évolution des espèces résulte des conséquences d’événements microscopiques, comme la mort ou l’accouplement de tel ou tel individu, à l’échelle de la population. Regarder les phénomènes culturels en termes de chaînes causales peut donc mettre en évidence les correspondances et aussi les différences entre théories culturelles et biologiques.
Dans un second temps nous verrons que les théories darwiniennes de l’évolution biologique peuvent être regroupées en trois grands cadres conceptuels emboîtés : le cadre populationnel, le cadre sélectionniste et le cadre des réplicateurs. A chacun de ces cadres conceptuels correspondent des hypothèses différentes sur les mécanismes à l’œuvre dans l’évolution biologique. C’est en considérant ces mécanismes et en étudiant le contexte historique de leur développement que nous définirons les cadres conceptuels darwiniens qui serviront ensuite à jauger la profondeur de l’analogie entre l’évolution culturelle et l’évolution biologique.
La définition des différents cadres conceptuels darwiniens et des mécanismes qu’ils supposent conditionne l’analyse des rapports qui nous intéressent ici.
Définir un cadre naturaliste et darwinien
L’objet de cette partie sera de présenter l’approche naturaliste de l’évolution culturelle qui nous servira dans l’étude des cadres conceptuels darwiniens. Il s’agit de l’approche qui a été développée par Dan Sperber3 et dont nous articulons ici les principaux arguments pertinents à notre propos.
NATURALISATION DES SCIENCES SOCIALES ET ENCHAINEMENT CAUSAL
Les phénomènes sociaux et les phénomènes psychologiques ont longtemps été considérés comme étant d’une nature radicalement différente des phénomènes physiques et biologiques. A l’intuition matérialiste (tous les phénomènes causaux relèvent d’une explication physique) s’opposait notre incapacité à mettre en œuvre cette intuition pour expliquer des phénomènes tels que la perception, le raisonnement ou la religion. Les sciences cognitives sont nées de la résolution partielle de ce conflit. Le programme des sciences cognitives est en effet très clair, il s’agit de déterminer comment des processus matériels et en particulier neurologiques peuvent donner lieu aux phénomènes psychologiques. Il n’est désormais plus possible, dans une perspective scientifique, de penser un phénomène psychologique (comme l’apprentissage du langage, la mémoire à court terme ou la prise de décision) sans se soucier de la plausibilité de sa réalisation biologique dans le cerveau. Même si les liens précis entre phénomènes neurologiques et psychologiques restent pour l’essentiel à découvrir, on sait comment concevoir ces liens, comment les modéliser et comment les étudier empiriquement. Par naturalisation de la psychologie on entend donc donner aux phénomènes psychologiques des causes naturelles, c’est-à-dire liées au fonctionnement de notre cerveau.
Cette naturalisation de la psychologie permet de concevoir une nouvelle approche naturaliste de l’objet des sciences sociales. En effet, pour Sperber : …les phénomènes sociaux sont des agencements de phénomènes psychologiques et écologiques à l’échelle des populations. (Sperber, 2007a)
Prenons un exemple ethnographique concernant les indiens Txikao du Brésil dû à Patrick Menget et discuté par Sperber :
Par une fin d’après-midi pluvieuse, Opoté revint chez lui tenant un beau poisson matrinchao qu’il avait pris dans ces nasses. Il le déposa sans un mot auprès de Tubia, l’un des quatre chefs de famille de la maison. Ce dernier se mit à le boucaner. Jusqu’à la nuit, il en mangea, seul, par petites bouchées, sous les regards intéressés des autres habitants de la maison. Personne d’autre ne toucha au matrinchao ni ne manifesta l’envie d’en avoir une part. Pourtant la faim était générale et la chair du matrinchao une des plus réputée. (Menget, 1979 cité dans Sperber 1996)
Cette description que fait Menget d’un événement de la vie des Indiens Txikao ne nous apporte jusqu’ici aucun renseignement sur la cause de tels comportements, il se contente de relater des faits. Mais le travail de l’anthropologue ne s’arrête pas là, et Menget ajoute :
Le pêcheur, Opoté, possesseur de la magie de la pêche, ne pouvait consommer sa prise sans risquer d’affecter l’efficacité de cette magie. Les autres chefs de familles évitaient la chair du matrinchao pour ne pas mettre en péril la vie et la santé de leurs enfants en bas âge, ou leur propre santé. Leurs épouses puisqu’elles allaitaient, devaient s’en abstenir pour la même raison. Les enfants auraient enfin absorbé l’esprit, particulièrement dangereux, de cette espèce. (Menget, 1979 cité dans Sperber 1996)
L’analyse de Menget se décompose donc en deux temps, le premier consiste à observer et décrire les comportements des individus, le second à interpréter ces comportements en termes de croyances, de désirs, d’émotions, etc.
Sperber distingue deux types d’objets différents qui doivent être articulés dans l’étude anthropologique : les représentations mentales et les productions publiques. Les représentations mentales sont les briques élémentaires du fonctionnement psychologique, elles sont issues de la perception ou de l’inférence, stockées en mémoire, l’origine des actions et surtout, elles ne sont pas directement accessibles aux autres individus, elles sont internes. Les anthropologues ne peuvent pas percevoir les représentations mentales des individus, ils ne peuvent qu’en inférer la présence et le contenu à partir de leurs observations des événements publics – public au sens d’observable. En particulier, les productions publiques, faites des comportements et des modifications de l’environnement résultant de ces comportements, peuvent être vues, entendues, analysées, etc. La première citation de Menget fait références à ces productions publiques, à des faits comportementaux que l’auteur a observés tout comme les Txikao eux-mêmes. La seconde citation fait référence au contenu et à l’organisation des représentations mentales qu’il a pu inférer à partir de ces observations. Le travail anthropologique consiste donc pour une part à expliquer les comportements observés à partir de représentations mentales inférées : si Opoté ne mange pas le poisson [comportement] c’est parce qu’il pense que s’il mange ce poisson sa magie va se trouver affectée [représentation mentale]. Il s’agit là d’expliquer en interprétant, c’est-à-dire en attribuant un sens aux actions.
Dans ces explications interprétatives, le rôle donné aux représentations mentales, et plus généralement aux significations, faisait obstacle à une approche naturaliste de la culture car jusqu’à très récemment le caractère matériel ou naturel des représentations pouvait tout au plus être postulé mais restait mystérieux. L’avènement des sciences cognitives permet aujourd’hui de concevoir comment les représentations résultent du fonctionnement cérébral.