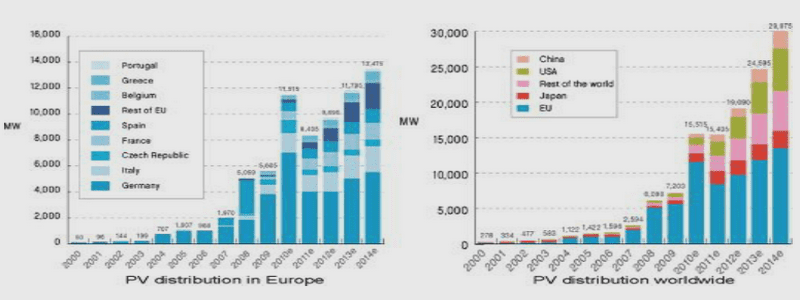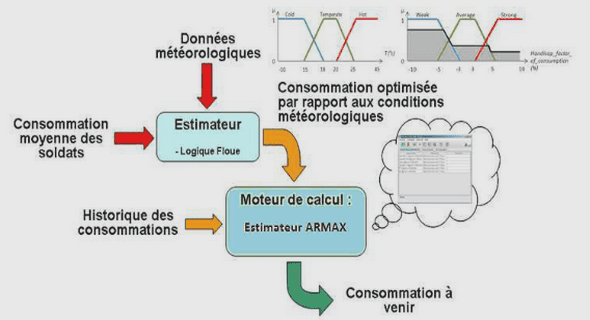Conséquences des déchets sur l’environnement et sur la santé humaine
Les déficits d’ordre organisationnel, technique et institutionnel, l’insuffisance des infrastructures ainsi que le manque de civisme poussent les populations à abandonner leurs déchets n’importe où. Or, l’abandon et le mauvais traitement de ces derniers peut provoquer des nuisances et des impacts sur le sol, l’eau, l’air, la faune, la flore et la santé humaine. Des études montrent que les déchets ménagers sont sources de microbes pathogènes (MEENA et al., 2011). L’infection par ces microbes résistants retarde la guérison de la maladie, augmente le taux de mortalité et de morbidité avec des conséquences économiques qui s’ensuivent (WHO, 2012). Ainsi, quelles peuvent être les conséquences potentielles des déchets sur la santé humaine et sur l’environnement ?
Les déchets et le cadre de vie ne sont compatibles
Les déchets ont des incidences sur le cadre de vie. Ils occupent des espaces importants (trottoirs, chaussées, …) qui s’accroissent en fonction de l’évolution de la population et du temps. L’absence de leur enlèvement offre un spectacle désolant car ils polluent le cadre de vie (qualité visuelle du paysage) en particulier et l’environnement en général. Une telle situation ternit l’image de la ville par l’obstruction des caniveaux et ouvrages d’évacuation des eaux usées et pluviales. La situation est aggravée surtout pendant la saison des pluies avec des conséquences telles que la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi que la dégradation de l’environnement humain. A Conakry, il n’est pas rare de constater des dépotoirs sauvages qui se multiplient surtout avec des montagnes d’immondices qui se développent dans les points de regroupement jusque sur les emprises des routes. Les rues et les espaces publics y sont considérés comme des lieux où il est permis de jeter les déchets de toutes sortes. Les bordures des eaux de surface sont dégradées à cause des rejets bruts des déchets par la population. Il en est de même que les abattoirs, les petites industries et les services situés aux abords, et ce, en toute impunité. Aussi, certains déchets biomédicaux issus des cliniques, les boues des vidanges inappropriées des fosses septiques, les huiles usagées issues des garages, les eaux de lavage d’engins roulants et celles issues de la teinture sont rejetées en plein air sans traitement. Une telle pratique est à la base de la perturbation du milieu aquatique par un dépôt excessif d’éléments minéraux. Ce phénomène correspond à une eutrophisation ou une dystrophisation selon les spécialistes, pouvant avoir des répercussions sur les ressources aquatiques. En plus, les déchets affectent par leur rejet les milieux récepteurs (eau, sol, air). Cela peut conduire les substances produites par le lessivage du sol et provenant des déchets solides à la contamination des sources souterraines et de surface, aggravant ainsi les problèmes entraînés par l’insuffisance de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. L’un des corollaires d’une telle situation est l’augmentation du risque de transmission des maladies (PNUE, 2002). On comprend alors que les déchets ont de multiples impacts sur les milieux récepteurs. Comme le souligne la BANQUE MONDIALE, (2003 :139), « un système de traitement inapproprié des déchets solides perturbe le réseau de drainage des eaux pluviales, favorise la contamination des sols, des eaux souterraines et la pollution de l’air par le dégagement du méthane ».
Les milieux récepteurs (sol, eaux, air) face aux déchets
La collecte irrégulière des déchets entraîne une prolifération des dépôts sauvages et anarchiques dans les villes. En effet, dans la ville de Conakry, les ménages n’ayant pas accès au service de collecte se servent des espaces nus les plus proches d’eux pour se débarrasser de leurs déchets. Ces lieux inappropriés de dépôts de déchets contribuent au développement d’organismes microbiens qui sont sources d’infections des milieux récepteurs (sol, eaux, air).
Effets négatifs des déchets sur le sol
Le sol, constitué par une mince couche externe de la terre, représente l’espace de vie de tous les êtres vivants : hommes, animaux, végétaux et micro-organismes. C’est une ressource très faiblement renouvelable au sens où sa dégradation peut être rapide (quelques années), alors qu’il met plusieurs milliers d’années pour se former et se régénérer. La pollution au niveau de cet écosystème est engendrée par des accumulations de déchets qui contiennent des substances dangereuses dont la mobilisation est susceptible de provoquer des troubles sur l’environnement et sur la santé de la population. Car, au-delà d’un certain seuil de contaminant, un sol est considéré comme pollué.
Selon HENK DE ZEEUW et KAREN LOCK (2000), le sol de la plupart des villes des PED contient suffisamment de métaux lourds qui causent des intoxications aiguës et que leur concentration accrue et prolongée dans la chaine alimentaire humaine peut avoir des effets nuisibles sur la santé (effets carcinogènes et mutagènes). Bien que l’analyse méthodique des sols soit récente, elle a été imposée en 1996 pour la gestion des sites et sols pollués (ABDELI, 2005) en raison de l’importance que revêt ce genre d’analyse des sols.
En Guinée, des études sur les incidences des décharges de Labé (ABDELI, 2005) et de Conakry (TOURE, 2010) par exemple, ont montré que les sols aux environs des décharges sont contaminés. Or, les populations riveraines font le maraichage : maïs, choux, laitue, tomate, patates, … sur ces sols. La consommation des récoltes de ces cultures au sein de ces décharges ou les herbes qui s’y trouvent, constitue une voie de contamination des riverains ainsi que d’autres consommateurs (tels que les bétails). Car, les métaux lourds peuvent s’accumuler dans la partie comestible des cultures consommées par l’homme ou les animaux. L’homme peut être exposé directement aux contaminants du sol de trois façons :
par ingestion (manger et boire) ;
par exposition cutanée (contact avec la peau) et
par inhalation c’est-à-dire par respiration (EARTH INSTITUTE COLUMBIA, 2012).
En général, la contamination par ingestion directe du sol (poussière) ou cutanée (main dans la terre) est beaucoup plus risquée que la consommation de légumes (SHAYLER et al., 2009). La contamination des sols constitue un enjeu fondamental non seulement parce qu’elle affecte notre environnement proche chargé en symbole (la terre nourricière), mais aussi et surtout parce qu’elle affecte l’eau. Le sol pollué par des lixiviats86, est le fait de dépôts sauvages ou de décharges non contrôlées. Bien que dispersés dans l’atmosphère, les biogaz conditionnent la pollution dans la décharge. Selon FARQUHAR (1989), « les lixiviats de décharge renferment de nombreux contaminants minéraux qui se révèlent souvent très toxiques. Leur composition varie en fonction de la nature des déchets, de l’âge de la décharge, de la technique d’exploitation et des conditions climatiques ». Pour NGNIKAM et al, (2006 :69), « dans les décharges de déchets ménagers, le lixiviat véhicule plusieurs formes de pollution dont la plus dangereuse est celle générée par les métaux lourds87 ». Au contact des lixiviats, les eaux de surface et souterraines se dégradent aussi bien chimiquement que bactériologiquement.
Effets négatifs des déchets sur les ressources en eau
La mauvaise gestion des déchets affecte dangereusement nos eaux. En effet, l’eau est le principal vecteur de la pollution engendrée par les déchets abandonnés ou éliminés dans des conditions écologiques peu satisfaisantes. La pollution des ressources en eau par un rejet inconsidéré des déchets est bien connue du fait de ses conséquences qui apparaissent comme la mort des poissons par exemple. Cette pollution se fait à travers les eaux de percolation qui sont en contact avec des déchets qui atteignent les nappes phréatiques ou les eaux de surface.
Ainsi, la pollution des eaux souterraines qui contribuent à l’alimentation en eau destinée à la boisson « apparaît comme le résultat de l’infiltration et de la diffusion de lixiviats en sous-sol perméable ou fissuré. Quant à la pollution des eaux de surface, elle peut résulter du débordement et de l’écoulement des bassins de stockage des lixiviats dans le réseau hydrographique » (CNIID, 2001) ou des eaux de ruissellement entraînant une partie des déchets en dépôts dans des cours d’eau. Les eaux de ces cours d’eaux régulièrement consommées ou utilisées par une partie de la population et des animaux dans les PED est la cause de la mortalité de 14 000 personnes par jour dans le monde. Qu’en est-il des eaux de puits ?
En Guinée, les eaux sont protégées contre la pollution au sens des articles 31 et 32 du chapitre 9 du Code de l’eau. L’évacuation et le déversement, l’immersion ou l’élimination des déchets dans les eaux continentales sont soumises à l’autorisation préalable du Ministère de l’environnement avec celui de l’Hydraulique et de l’Energie (loi n° L/94/005/CTRN du 15 février 1994). Malgré ces prescriptions, les eaux de Guinée sont polluées. A Conakry, les analyses physico-chimiques et microbiologiques des eaux et lixiviats prélevés dans des puits aux alentours de la décharge de la Minière montrent que les eaux des puits environnants sont contaminées (TOURE, 2010 :59). Cette contamination résulterait de l’envahissement des bords de ces puits par les lixiviats riches en micro-organismes pathogènes et de leur percolation. L’un des puits situé à 10 m de la décharge, est souvent envahis par les lixiviats et les déchets solides, ce qui explique son taux plus élevé en coliformes fécaux (14NCF/100ml)88. D’après l’étude, les températures des échantillons d’eau sont relativement élevées. Cette élévation de la température des eaux de puits qui résulte du dégagement de chaleur lors de la décomposition des déchets organiques, favorise le développement des micro-organismes et des algues qui donnent une mauvaise odeur à l’eau (TOURE, (Ibid: 57). Les eaux des puits se trouvant à côté de la montagne de déchets vers le niveau supérieur de la décharge a une turbidité élevée (14NTU) à cause des particules qu’elles reçoivent souvent à travers les envolées des déchets et poussières, l’envahissement par la boue et les lixiviats. Cette valeur de turbidité des puits, malgré qu’elle soit proche de celles trouvées par MOKHTARIA et al., (2007) (2 et 13NTU), est supérieure à la norme de l’OMS (2006) qui est de 2NTU.
Selon la même étude, les eaux des puits renferment plus de substances dissoutes. Les valeurs des conductivités des eaux de certains puits (1313 à 6170µs/cm) sont au-dessus de la norme de l’OMS (valeur souhaitée 400µs/cm) et celle du puits témoin. Cette élévation expliquerait l’envahissement des puits environnants par les lixiviats et les débris des déchets. Aussi, avec un taux plus élevés des ions nitrites (3,465mg/l) et nitrates (158,4mg/l), et d’ions phosphates (bien que ces taux soient au-dessous de la norme OMS (2006) (2mg/l)) dans les eaux des puits en aval, l’étude atteste que les eaux des puits aux alentours de la décharge de la Minière sont polluées par les composés azotés et renferment plus de phosphates. La teneur du cadmium (Cd) et du plomb (Pb) dans les échantillons d’eau et de lixiviats sont faibles. Ces taux de Cd et de Pb dans les échantillons d’eau sont inférieurs aux normes OMS (0,005mg/l pour Cd et 0,01mg/l pour Pb) et ceux dans les lixiviats sont inférieurs aux normes algériennes de rejets (0,2mg/l pour Cd et 1mg/l pour Pb). Cependant, ils témoignent de la présence des métaux lourds (Cd et Pb) qui, par effet cumulatif, sont toxiques même à faible dose. Leur présence dans ces eaux s’expliquerait par l’accumulation des résidus des piles et d’autres accumulateurs renfermant ces métaux dans les eaux de lessivage des déchets, qui constituent les lixiviats (BANGOURA, 2006 ; TOURE, 2010 :59).
Par ailleurs, l’utilisation des eaux de ces puits de mauvaise qualité physico-chimique et surtout bactériologique par la population comme eau de poisson ou pour d’autres fins (irrigation, arrosage) constitue également un risque de contamination élevé. D’après CAMARA (2000) et BANGOURA, (2006), l’utilisation de ces eaux généralement infectées par des matières fécales, des urines (humaine et animale), favorise la pollution des cultures maraîchères. Consommer de telles cultures constitue une source de maladie d’origine hydrique (choléra, bilharziose, dysenterie, …) pour l’homme mais aussi un risque de contamination pour les animaux.
Le déchet et ses effets négatifs dans l’air
L’une des pollutions auxquelles l’homme est le plus sensible est certainement la pollution atmosphérique. Certains déchets sont susceptibles de polluer directement au contact de l’air ou de l’eau ou d’un acide qui dégage un gaz toxique. Mais ils peuvent aussi participer indirectement à la pollution atmosphérique lorsque leur traitement par incinération est réalisé dans de mauvaises conditions. Par exemple, en cas de brûlage à l’air libre ou dans une installation dont le système d’épuration des fumées ne présente pas l’efficacité requise. Les pollutions générées dans de telles conditions par les déchets deviennent de plus en plus inquiétantes au regard des émissions de gaz inflammables, corrosifs et toxiques appelés gaz de décharge. Ce gaz est composé de biogaz, d’air et de composés volatiles qui résultent de la décomposition des déchets organiques par les micro-organismes. Le biogaz est composé principalement de méthane et de gaz carbonique. Les composés volatiles sont responsables des mauvaises odeurs (ils contiennent des dérivés soufrés) et de la toxicité du gaz de décharge dérivés soufrés, dioxines, ou autres polluants atmosphériques liés à certains processus d’incinération.
A une dose voisine du millionième de gramme par kilogramme de masse corporelle et par jour, elles provoquent des cancers, des malformations de l’embryon au cours de la grossesse et des troubles du développement. C’est ce qui s’est produit par exemple pour les victimes de « l’agent orange » lors de la guerre du Vietnam (UPMC, 2009: 17)89. D’autres études épidémiologiques réalisées dans certains pays développés avaient indiqué que la malformation congénitale des nouveau-nés était le risque le plus élevé pour la santé des populations à côté des décharges (FIELDER et al. 2000 : 19 ; ELLIOT et al. 2001 : 363). Il semble également qu’une mauvaise qualité de l’air peut tuer bon nombre d’organismes, y compris l’homme. Ce genre de pollution provoque « des complications respiratoires, des maladies cardiovasculaires (dues à des particules fines présentes dans les déchets) ; il entraine des lésions cutanées et endommage les systèmes nerveux et immunitaire (dues à des pluies acides) ; des troubles respiratoires (dues à certains gaz polluants tels que le dioxyde de soufre et l’oxyde d’azote), l’inflammation de la trachée, les douleurs abdominales et la congestion ». Les personnes âgées sont plus exposées à des maladies liées à la pollution de l’air ainsi que celles ayant des problèmes pulmonaires ou cardiovasculaires. Les substances chimiques et radioactives entraînent le cancer et des maladies congénitales. Il convient de retenir, comme disait MARTIN (2009 : 17) :
Les émissions atmosphériques peuvent engendrer des impacts qui agissent à différentes échelles. Au niveau global, elles contribuent au réchauffement climatique ou à la destruction de l’ozone stratosphérique. Cette ozone est principalement affectée par les gaz CFC, interdits depuis 1987 par le Traité de Montréal mais encore présents dans les anciens réfrigérateurs par exemple. Au niveau régional, on peut mentionner les pluies acides qui nuisent aux écosystèmes et aux infrastructures humaines. Plus localement, les émissions contribuent au smog urbain et la formation de l’ozone troposphérique nocive pour l’homme.
Le stockage des déchets entraîne aussi le dégagement d’odeurs désagréables et incommodes aux populations environnantes. « L’air pollué est responsable de la mort de 2,4 millions de personnes par an dans le monde. Il diminue l’espérance de vie des hommes et cause des troubles cardiaques ainsi que des maladies respiratoires comme l’asthme »90. Il affecte également la santé reproductive chez l’homme, mais aussi chez certaines espèces animales et végétales. Le PNUE (1999) estime qu’environ 50% des maladies respiratoires chroniques sont dues à la pollution de l’air.
Incidences des déchets sur la faune et la flore
Les influents riches en azotes et les eaux de ruissellement transportant des engrais tendent à stimuler la croissance des algues dans les eaux côtières, pouvant causer une réduction d’oxygène capable d’entraîner la mort des poissons en eau profonde et de réduire la diversité biologique marine par la compétition (PNUE, 1999). Ces dépôts de déchets peuvent entraîner la destruction des éléments utiles pour l’homme et pour les animaux. Dans les pays industrialisés, la faune ichthyologique est surtout menacée par la pollution industrielle : les engrais azotés et phosphatés avec les phénomènes d’eutrophisation qu’ils provoquent, les déchets ménagers, les influents industriels et nombreux toxiques rejetés quotidiennement dans les milieux aquatiques rendent ces derniers inhabitables par les poissons (KHASIRIKANI, 2008). Quant aux dépotoirs, ils sont des cadres propices à la prolifération de la flore cryptogamique (champignons).