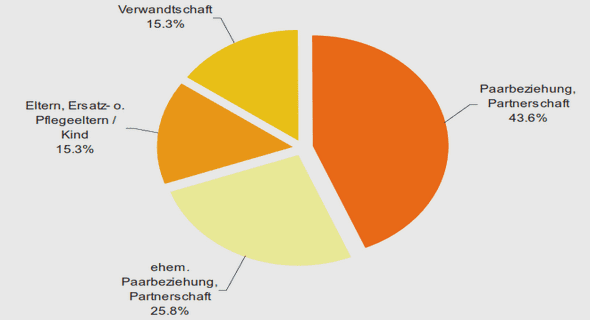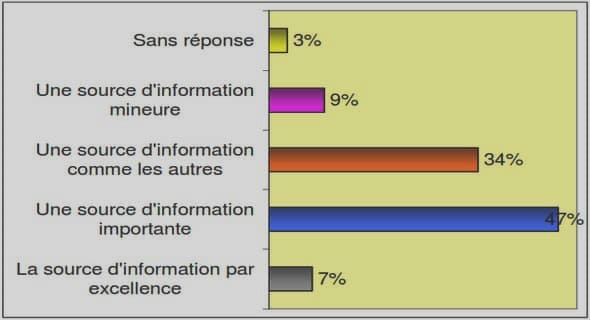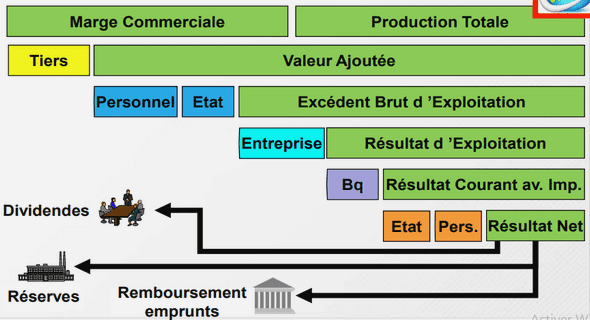La santé au travail : un droit de l’Homme reconnu par la communauté internationale
Dé des droits de l’Homme.Les droits de l’Homme sont constitués d’un ensemble de droits fondamentaux 114 inaliénables et inhérents à toute personne en raison de son appartenance à l’espèce humaine. Nul besoin de textes ou d’une autorité pour accorder ces droits, sinon pour les identi, car ils sont d’o reconnus à l’Homme. Ils nécessitent toutefois d’être reconnus en tant que tels par la communauté internationale pour tenter de les faire respecter à travers le monde, la mondialisation économique s’accompagnant d’une nécessaire mondialisation des droits 115.
Cette idée de suprématie de certains droits dits fondamentaux découle de la théorie du droit naturel selon laquelle il existe des droits provenant de la nature même de l’Homme, que lui-même ne peut modi. Ainsi en va-t-il, par analogie, des lois de la physique. Le droit naturel s’oppose donc au droit positif qui est constitué de l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un temps et sur un territoire donnés.
Les droits liés à la nature humaine, attribués par essence à l’homme, sont considérés comme antérieurs à toute construction étatique ou sociale et supérieurs à toute forme d’organisation collective comme l’État 116. Par conséquent, les lois de la République, celles créées par l’Homme, re du droit positif, doivent alors se conformer aux droits naturels de l’être humain dont le premier est le droit à la vie, le droit à la santé émanant directement de ce droit. Ce qui pourrait être dé comme une obligation morale de reconnaître ces droits de l’Homme, constitue, selon la lettre même du préambule de la déclaration des droits de l’Homme de l’ONU, « le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Dès lors, « les droits de l’Homme deviennent une obligation pour tous les États » 117.
Pour protéger ces droits innés, la communauté internationale leur a attribué des caractéristiques propres. L’inaliénabilité, l’universalité et l’unité comptent parmi les déterminants indispensables des droits fondamentaux.
L’inaliénabilité des droits fondamentaux. Ce caractère constitutif des droits de l’Homme 118 leur confère une force supplémentaire qui protège l’individu des atteintes ses droits par des tiers, mais aussi par lui-même. Le destinataire de ces droits ne peut lui-même les céder au pro de quiconque, fût-il l’État. Ils s’imposent à ce dernier : que ce soit par le pouvoir législatif ou par le pouvoir réglementaire 119, l’État ne peut y porter atteinte même si l’individu y consent. L’autonomie de la volonté ne s’applique pas face au caractère fondamental de certains droits. Ainsi en va-t-il, par exemple, du principe d’inaliénabilité et d’indisponibilité du corps humain, selon lequel nul ne peut vendre ou conférer une valeur patrimoniale à son corps ou à l’un de ses éléments. Ce principe trouve pourtant à s’atténuer en droit du travail 120 puisqu’il s’agit de céder une force de travail qui ne peut émaner que d’un corps, travail intellectuel compris puisque la pensée n’est pas dissociable du corps qui lui permet d’exister.
La nécessité de travailler dans le modèle social actuel étant actée, le droit du travail fait o d’exception au principe d’inaliénabilité du corps humain. Il est cependant entouré d’autres principes fondamentaux qui jouent le rôle de garde-fou. Le principe d’inaliénabilité est suppléé par l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou à la dignité de l’individu au travail, qui découle des droits fondamentaux au travail a par l’Organisation internationale du Travail 121.
L’inaliénabilité des droits fondamentaux, certes impose à l’État une abstention de porter atteinte, mais il suppose aussi une action de sa part pour les protéger. Lorsqu’il délègue son pouvoir régalien d’écrire la lettre de la loi aux partenaires sociaux, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent avoir le souci de garantir aux travailleurs la constance des droits qui leur sont reconnus en tant qu’être humain par la communauté internationale.
L’universalité des droits de l’Homme. Les droits fondamentaux sont uni-versels en ce qu’ils sont reconnus à tout être humain, de tout peuple et en tout lieu, même s’il semble que « la violation de ces droits est beaucoup plus universelle que leur reconnaissance » 122. Le fait que les États reconnaissent des violations des droits de l’Homme dans le comportement de leurs homologues actent de l’existence des droits de l’Homme et leur reconnaissance par ces derniers.
La question de l’universalité s’est posée au prisme des diences culturelles, idéologiques ou philosophiques entre les peuples. Existe-t-il des règles unanimement approuvées par tous les êtres humains ? Si l’on répond à cette question par l’approche naturaliste 123, les droits de l’Homme sont intrinsèquement liés à ce dernier. Ils priment sur le caractère culturel, idéologique ou philosophique et forment les grands principes de l’humanité. Ils ont donc vocation à s’appliquer « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » 124.
À l’inverse, selon une autre approche, le concept de droits de l’Homme serait une invention de l’Europe moderne 125 qui souhaite par cette notion imposer sa philosophie au reste du monde sans tenir compte des particularités des peuples 126. En e certaines régions du monde n’ont pas la même conception sur les droits à accorder aux individus et s’opposent sur leur hiérarchie entre droits individuels et droits collectifs. Toutefois, même si les points de vue divergent, plusieurs régions du monde ont adopté leur propre Déclaration des droits de l’Homme 127. Ainsi, malgré les diences entres les peuples, l’attachement aux droits fondamentaux de l’être humain subsiste.
Ces diences peuvent apparaître au sein d’une même approche puisque ces droits sont amenés à évoluer au fur et à mesure de l’évolution de la société. En e l’universalité des droits de l’Homme n’exclut pas la possibilité de les faire évoluer en reconnaissant de nouveaux droits comme étant essentiels à la dignité humaine. Plu-sieurs vagues de droits ont donc été promues, dans ce que l’on appelle les dientes
générations de droits de l’Homme ». Classiquement, les droits dits de première gé-nération regroupent les droits civils et politiques ; les droits de deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels ; et, les droits de troisième génération, les droits collectifs tels que les droits des générations futures à un environnement sain, le droit au développement et à la protection ou encore le droit à la libre détermination des peuples 128.
Le droit à la santé physique et mentale des travailleurs s’inscrit dans chacune de ces générations. Tout d’abord, il s’insère dans le droit civil qui donne des garanties minimales concernant l’intégrité physique et mentale des individus (par exemple, le droit de ne pas être tué ou torturé), l’égalité, la liberté, le droit d’expression. Ces derniers points peuvent être source de risques psychosociaux pour l’individu lorsqu’ils ne sont pas respectés. Ensuite, le droit à la santé physique et mentale s’intègre dans les droits sociaux, dits de deuxième génération, en ce qu’ils sont créateurs de droits pour les travailleurs. Certains concernent directement ou indirectement la protection contre les risques psychosociaux. En au regard des dommages à la société causés par les risques socio-organisationnels, les droits dits de troisième génération appellent à prendre des mesures favorables à la collectivité, à la santé publique et, par là même, à lutter contre les risques psychosociaux au travail.
On peut par exemple citer : Convention européenne des droits de l’Homme, Rome, 1950, amendée Droits fondamentaux et générations des droits de l’Homme. Les droits fondamentaux sont découverts au fur et à mesure de l’avancée des préoccupations touchant directement et en premier lieu à la personne humaine. La communauté in-ternationale a identi successivement plusieurs lots de droits inhérents à l’Homme, communément appelés « générations de droits de l’Homme ». Les droits fondamentaux désignent toutes les générations de droits de l’Homme. Ils ont été réunis et proclamés dans la Charte des droits de l’Homme qui comprend la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, le Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de la même date.
Les droits fondamentaux ont vocation à s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de la société avec toujours pour directeur le respect de l’être humain et de sa dignité comme principe inhérent à la construction sociale collective. Les droits reconnus à l’individu seul ou à un ensemble d’individus (droits collectifs) et les droits reconnus, en premier lieu ou postérieurement, ne préjugent pas d’une certaine hiérarchie des uns par rapport aux autres. Tous les droits de l’Homme présentent en e un caractère d’unité et d’universalité indispensables et sont « indissociables, interdépendants et intimement liés » 129. De plus, les droits civils et politiques d’une part, et les droits économiques, culturels et sociaux d’autre part, bien que n’ayant pas fait l’objet d’un texte unique, ont été adoptés le même jour. Cette dichotomie s’explique par la nécessité de faire adopter des mesures consensuelles avec la signature de la majorité des pays. Or, si les droits civils et politiques, qui font suite aux tragédies de la Seconde Guerre mondiale 130, n’ont pas trouvé de fortes oppositions, les droits de deuxième génération ont subi plus de réticence de la part de certains pays. Ainsi, la France, pays des droits de l’Homme, n’a rati les deux pactes qu’en 1981.
Les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux s’inscrivent dans la volonté d’a des principes ayant vocation à garantir la justice et la paix dans le monde 131 en octroyant aux individus des conditions d’existence décentes. Ils érigent la santé au travail en principe fondamental reconnu dans la charte de l’ONU (§1). Une autre organisation con ce principe. La protection du droit fondamental à la santé mentale au travail par l’Organisation internationale du Travail (§2) est également une source importante en la matière.
La santé au travail, un principe fondamental dans la Charte des droits de l’Homme des Nations Unies
La Charte des droits de l’Homme des Nations Unies comprend plusieurs textes dont la Déclaration universelle des droits de l’Homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Chacun de ces textes exprime des droits à la protection de la santé qui, combinés, forment un socle solide contre les atteintes à la dignité et à l’intégrité physique et mentale des individus.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme a fait l’objet de plus de 418 traductions dans toutes les langues et dialectes du monde. Il est important que les droits fondamentaux soient connus et reconnus par toute la communauté internationale. En e la mondialisation croissante de l’économie, la disparition économique des frontières, donnent lieu à des dérives telles que l’exploitation sociale dé par Marc parler d’un relativisme économique et social » 135 : les droits de l’Homme trouveraient alors à s’appliquer d’abord dans les pays où la situation économique le permet.
Cette lecture n’est toutefois pas celle de l’ONU pour qui la reconnaissance des droits fondamentaux à tous les peuples est la condition sine qua non du développement et de la lutte contre la pauvreté 136. Elle est donc venue préciser, à la suite de la DUDH, dans le traité international de 1966, les droits économiques et sociaux reconnus à tous et permettant le développement des droits de l’Homme, car l’un ne va pas sans l’autre.
Le droit à la santé au travail s’appuie sur la notion de dignité de la personne humaine proclamée dans la DUDH comme élément inhérent aux droits fondamentaux qui trouvent à s’appliquer au travail (A.). Le PIDESC vient préciser, comme son nom l’indique, les droits économiques et sociaux dont l’étude nous intéresse particulièrement ici (B.).
La dignité dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et le droit de la santé au travail
La Déclaration universelle de 1948 érige la notion de dignité en concept princeps (1.) à l’origine de l’ensemble des droits fondamentaux énoncés dans le texte. Cette notion intéresse de dientes manières le droit à la santé au travail. La traduction de la dignité dans les droits fondamentaux applicables au travail (2.) permet d’identi les correspondances entre la dignité et le droit fondamental à la santé au travail.
La notion de dignité : un concept princeps
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » sont les premiers mots du préambule de la DUDH. La dignité est la première notion à laquelle il est fait référence dans le texte. Elle constitue le fondement de la DUDH. Si la notion de dignité n’est pas dé dans le texte, ce dernier en donne toutefois les éléments constitutifs : tous les droits reconnus à la personne dans la déclaration font partie de la dignité de l’Homme. Elle énonce les droits minimums qui doivent être concédés à chaque individu en raison de sa qualité d’être humain et de la valeur 137 qui doit lui être donnée par ses pairs.
Toute atteinte aux droits reconnus dans la DUDH est une atteinte à la dignité de l’Homme. Les droits fondamentaux tirent donc directement leur justi de la notion de dignité reconnue à tous les êtres humains. La dignité est alors le « principe fondateur du droit » 138, un principe « matriciel » 139, c’est-à-dire un principe majeur qui engendre d’autres principes dits dérivés 140. Leur caractère dérivé indique leur nécessaire conformité au principe matriciel puisque ce dernier constitue leur essence.
Un paradoxe intervient toutefois : la dignité constitue le socle matriciel des droits fondamentaux, mais elle ne trouve à se matérialiser qu’à travers eux. Ils sont interdépendants et le droit à la dignité trouve sa consistance juridique 141 dans ces principes dérivés 142 qui peuvent se démultiplier pour s’adapter aux évolutions de la société.
L’imprécision de la notion a l’avantage de ne pas restreindre le champ des atteintes à la dignité. Le droit doit pouvoir répondre aux évolutions de la société. Ainsi, une notion aussi fondamentale que la dignité ne peut être enserrée dans une détrop étroite sous peine de voir les évolutions technologiques, par exemple, prendre le pas sur les intérêts de l’homme.
Cette notion, parfois critiquée, a permis de protéger l’espèce humaine contre les dérives en matière de biomédecine (eugénisme, clonage humain). L’atteinte à la dignité a été le moteur de la protection du génome 143, du corps humain et de ses éléments pendant
Cinquième considérant de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 : « les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine » la vie et après la mort. La dignité est un rempart contre l’exploitation de l’homme par l’homme. Comme l’explique bien le Professeur Bertrand Mathieu 144, « La stratégie, consciente ou inconsciente qui vise à relativiser ou à a la portée du principe de dignité permet d’éroder le seul obstacle qui se dresse face à l’instrumentalisation de l’homme par l’homme. L’économie a aujourd’hui besoin du matériau humain comme elle avait, hier, besoin de la force de travail de l’homme. L’individu n’est aujourd’hui pas plus protégé par le seul principe du consentement que le travailleur ne l’était (…) par le seul principe de la liberté contractuelle ». En matière de santé comme en droit du travail, il est nécessaire de protéger l’individu de l’atteinte à sa dignité par l’utilisation de sa personne comme un produit 145 ou un moyen de production dénué de valeur humaine.
Traduction de la dignité dans les droits fondamentaux applicables au tra-vail
Dignité et protection de la personne humaine. La dignité s’exprime dans un certain nombre d’articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui trouvent à s’appliquer en santé au travail en commençant par le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté 146. Le droit à la santé en général, et au travail en particulier, émane du droit à la vie qui ne s’arrête pas au temps du travail 147. Excepté dans les cas où l’activité de travail est dangereuse par nature 148, aucun individu ne doit travailler au péril de sa vie. Même dans les activités où le danger est inhérent, les activités connexes se doivent d’être sûres pour les travailleurs.
La sûreté peut être dé comme le sentiment de vivre en sécurité. Le diction-naire Larousse en donne la dé suivante : « état de quelqu’un ou de quelque chose qui est à l’abri, n’a rien à craindre. » Elle est la condition d’exercice de la liberté reconnue chaque individu 149 car ce dernier ne peut revendiquer ses droits-liberté 150 que s’il a l’assurance qu’il ne subira aucune mesure de représailles.
L’État a la charge non seulement de garantir ces droits en empêchant des tiers d’entraver les droits d’autrui, mais aussi en s’abstenant d’y porter atteinte de par ses propres actions. La notion de sûreté a été introduite dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme en premier lieu pour protéger les individus contre les dérives étatiques telles que les arrestations ou détentions arbitraires qui portent atteinte aux libertés fondamentales des individus. À l’époque de la promulgation de la DUDH, la sûreté visait en particulier les abus commis par les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions. En ce sens strict, l’atteinte au droit fondamental qu’est le droit à la protection de la santé dans l’exercice de ses fonctions devrait être mieux protégée dans le secteur public que dans le secteur privé.
Il relève de la responsabilité des États de préserver les droits fondamentaux des individus. Le recours à la force publique est donc rendu possible pour faire respecter les lois protégeant les droits de l’Homme.
L’article 3 de la DUDH entendait protéger les individus contre les dérives étatiques du pouvoir. Or, aujourd’hui, l’activité économique ayant pris le pas sur la politique et l’État-providence 151, les atteintes à l’intégrité des individus proviennent aussi des entreprises, atteintes que l’État-souverain et l’État-employeur ont la charge d’éradiquer. Ces atteintes peuvent se traduire par la « soumission [des individus] à des traitements inhumains ou dégradants 152 » totalement prohibés par la DUDH y compris en milieu de travail.