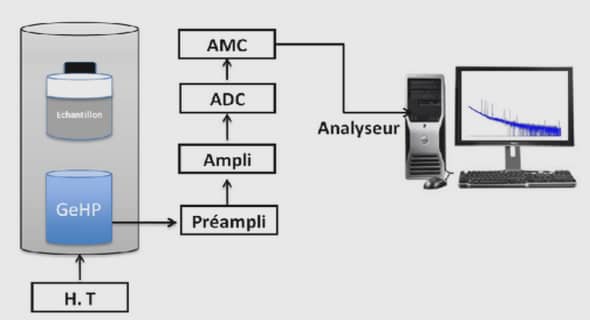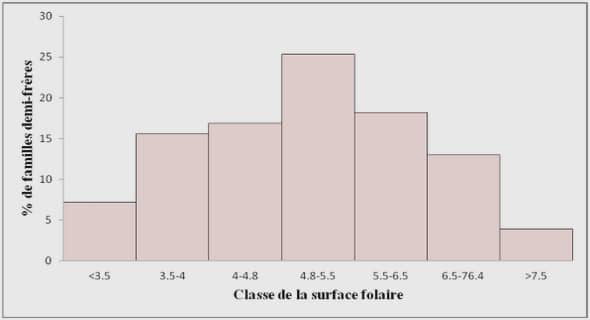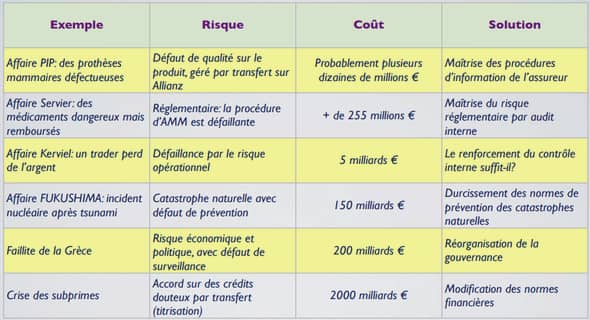Identifier et compter les enfants évacués ?
A priori, circonscrire le groupe des enfants espagnols évacués en France n’est pas chose facile. L’historiographie sur les âges de la vie, depuis les travaux pionniers de Philippe Ariès, a bien montré que la limite entre l’enfance et l’âge adulte est tout sauf figée24. Cette frontière poreuse dépend des époques et des lieux, mais aussi des classes sociales et du sexe. À l’époque qui nous intéresse, on reste un enfant plus longtemps lorsque l’on vient d’une famille aisée que des milieux populaires, où l’on commence en général à travailler dès l’âge de 13 ans, en France comme en Espagne. Dès lors, certaines catégories d’âge ne valent que dans certains secteurs de la société. Ainsi, Agnès Thiercé étudie la lente émergence de l’adolescence en France entre 1850 et 1914. Cette période de la vie, explique-t-elle, est d’abord réservée aux garçons de la classe bourgeoise avant de toucher les jeunes filles puis les jeunes gens des classes populaires25. L’appartenance subjective à l’enfance est également liée aux circonstances. Comme l’a montré Manon Pignot, les petites filles vivant en zone occupée pendant la Première Guerre mondiale se perçoivent de plus en plus comme appartenant au groupe des femmes et se dissocient de celui des enfants, dans un contexte spécifique où le genre en vient à primer sur l’âge face à l’occupant26.
Le choix de notre objet – la mobilisation pour l’évacuation et l’accueil des enfants espagnols en France – commande cependant une autre approche. Dans le cadre de cette étude, l’appartenance au groupe des enfants espagnols évacués en France ne sera déterminée ni par des représentations sociales, ni par un sentiment subjectif. Il suffit de faire partie d’un convoi d’évacuation ou d’être hébergé par l’entremise d’un comité d’accueil quelconque – en somme, de bénéficier de la mobilisation étudiée. Les critères pour entrer dans ce système de prise en charge sont d’ailleurs changeants : les expéditions sont, selon les moments et les lieux de départ, ouvertes à différentes tranches d’âge. Il faut parfois avoir entre 5 et 14 ans, d’autres fois entre 5 et 12 ans ou encore entre 6 et 13 ans. D’ailleurs, bien des familles parviennent à inscrire leurs enfants même lorsqu’ils n’ont plus ou pas encore l’âge réglementaire. En ce qui nous concerne, dès lors qu’un individu est évacué vers la France et/ou hébergé au sein du réseau de familles d’accueil ou de colonies collectives mis en place à cet effet, il est pour nous un « enfant espagnol évacué et/ou accueilli en France » même si, comme il arrive parfois, il atteint et dépasse les 18 ans au cours de la période considérée. C’est à cette définition pragmatique que nous nous tiendrons dans l’ensemble de ce travail.
Si les limites du groupe des enfants évacués sont néanmoins perméables, c’est moins en raison des limites d’âge que de la complexité de nombreuses trajectoires individuelles et de la relative ouverture du dispositif d’hébergement théoriquement destiné aux seuls enfants espagnols évacués exprès depuis l’Espagne. Entre 1936 et 1939, le territoire français, frontalier de l’Espagne, est traversé de nombreux aller-retour de réfugiés. Or, il n’est pas rare que certains enfants, arrivés en France avec leurs parents ou même, parfois, sans eux mais en tant que réfugiés, intègrent après coup le réseau d’hébergement familial et collectif destiné aux enfants évacués exprès. C’est le cas, par exemple, d’une dizaine de réfugiés logés dans le centre préfectoral de Chantegrillet dans la Loire en juin 1937, qui sont ensuite placés par le Comité d’accueil aux enfants d’Espagne (CAEE) départemental dans des familles de Saint-Étienne27. De même, au long de l’été 1937, de nombreux enfants se trouvant au centre de Talence sont récupérés par le consul d’Espagne à Bordeaux et distribués dans diverses colonies supervisées par les autorités espagnoles ou basques en France, théoriquement destinées aux groupes spécifiquement expédiés d’Espagne à cet effet28. Enfin, certains enfants ont également été envoyés en France de manière particulière par leurs parents et il arrive que ces derniers cherchent, après coup, à leur faire intégrer le dispositif d’hébergement des enfants évacués. C’est le cas de Pierre Marqués Posty. En mars 1937, son père l’envoie avec sa sœur chez leur oncle maternel, un immigré résidant à Lyon. Mais ce dernier est un simple ouvrier qui n’a bientôt plus les moyens de subvenir aux besoins de ses deux neveux. Susana Posty fait alors des démarches, tant auprès du gouvernement espagnol que du CAEE de Lyon, pour placer ses deux enfants dans une colonie ; en désespoir de cause, elle contacte la dirigeante anarchiste Federica Montseny pour lui demander de l’aide29. Elle finit par obtenir gain de cause. Comme Pierre Marqués le précise lui-même dans son livre, il est hébergé pendant un temps à la colonie « Iberia » à Lyon30, créée le 16 août 1938 et supervisée par un organisme officiel espagnol, la Délégation espagnole à l’enfance évacuée (DEEE31). À partir de cette date (mais pas lorsqu’il est hébergé chez son oncle), il entre dans le champ d’études de cette thèse.
La porosité de la limite entre les enfants réfugiés et évacués en France n’est que l’une des difficultés qui se présente au chercheur qui souhaiterait fixer une fois pour toutes le nombre des enfants évacués en France entre 1936 et 1939. Outre le caractère souvent partiel des listes d’enfants expédiés depuis l’Espagne ou hébergés dans telle ou telle colonie ou par tel ou tel comité, la population en question est mouvante. Certains enfants sont renvoyés en Espagne, soit parce qu’ils sont réclamés par leurs parents, soit par mesure de punition. D’autres passent d’un pays à l’autre : ainsi, sur les 450 enfants arrivés de Bilbao le 21 mars 1937 à la Maison heureuse sur l’Île d’Oléron, 200 partent un mois plus tard en direction de la Belgique où des familles d’accueil les attendent : faut-il, ou non, les intégrer dans notre population32 ? Ces difficultés ne se présentent pas pour les pays plus lointains, qui ne reçoivent pas de réfugiés sur leur sol et où les enfants évacués arrivent dans des convois bien identifiés. Ainsi, en Grande-Bretagne, ce groupe est nettement borné : le 22 mai, les 3 826 enfants qui le composent arrivent en une fois de Jesús Alonso Carballés – qui ne concerne, rappelons-le, que les enfants évacués depuis le Pays basque – présentent également des difficultés. Le chiffre total de 15 383 qu’il donne pour la France est construit à partir de listes d’embarquement qui mêlent des enfants isolés et des enfants partis avec leurs parents, comme le révèle une lecture attentive de sa thèse36. Il en est de même, d’ailleurs, des chiffres concernant les rapatriements, construits à partir de documents qui ne permettent pas de distinguer les enfants partis du Pays basque vers la France en 1937 et ceux qui, réfugiés en Catalogne jusqu’au début de l’année 1939, passent ensuite en France avec le grand exode catalan du début du mois de février37.
C’est donc intentionnellement que dans la première phrase de cette introduction, nous restons évasive, chiffrant autour de dix mille le nombre d’enfants qui passent, à un moment donné, dans le dispositif d’hébergement élaboré par des comités français et étrangers et par les autorités espagnoles en France (sachant que plusieurs milliers d’enfants transitent quelques semaines par la France avant de repartir pour la Belgique, la Suisse ou le Danemark). Notre estimation, prudente et beaucoup plus basse que celles qui circulent habituellement dans l’historiographie, se fonde sur les chiffres des acteurs eux-mêmes. Dans son rapport de novembre 1937, la Délégation espagnole à l’enfance évacuée (DEEE), qui dépend du ministère de l’Instruction publique et de la Santé espagnol, rend compte de 2 683 enfants en colonies et de 4 143 placés dans des familles, soit en tout 6 826 enfants espagnols en France38. Selon la délégation de l’Assistance sociale – dont le réseau d’hébergement ne coïncide qu’en partie avec celui de la DEEE –, le Comité d’accueil de la CGT et elle hébergeraient environ 7 000 enfants en mars 193839. Vers la même date, le consul de France à Bilbao indique au chargé d’affaires du Saint-Siège en Espagne que « 8.216 enfants espagnols se trouv[ent] […] sur le territoire français où leur hébergement est assuré par des comités d’assistance privée40 » : il est fort probable que ce chiffre a été obtenu soit de la CGT, soit des autorités espagnoles républicaines en France. En octobre 1938 enfin, le rapport sur « l’Accueil aux enfants d’Espagne41 » préparé pour le Congrès de la CGT évalue à « environ dix mille le nombre des enfants » sous sa protection – il inclut d’ailleurs de nombreux groupes d’enfants qui semblent n’avoir eu qu’un rapport fort lointain, en réalité, avec le Comité d’accueil aux enfants d’Espagne mis en place par la CGT. Mais d’autres lui échappent de toute façon : ainsi des 500 enfants recueillis dans la Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port par un comité catholique. Ce qui nous importe, en tout état de cause, c’est moins de chiffrer une population totale telle qu’elle aurait existé à un moment donné que de connaître la taille des groupes dont s’occupe tel ou tel acteur à tel ou tel moment. Ces chiffres-là, construits non par nous mais par les contemporains, interviennent dans notre récit lorsqu’ils éclairent l’argumentation. Si nous avons, nous aussi, construit une base de données (présentée en annexe) et produit, à divers moments, des chiffres, ce n’était à aucun moment pour mesurer une fois pour toutes le nombre total d’enfants évacués en France – quitte proposer plusieurs chiffres, selon les périodes – mais bien à appréhender divers sous-groupes, en nous replaçant dans la perspective des acteurs qui en ont la responsabilité dans un contexte et à un moment donnés.
Cartographier les acteurs d’une mobilisation transnationale
Une cause, des engagements, trois « nébuleuses »
Afin de comprendre pourquoi tant de partis, de syndicats, de comités, de personnalités et d’institutions apparemment si différents s’intéressent à l’évacuation et l’accueil d’enfants espagnols en France, nous sommes partie de l’hypothèse que cette cause se situe à la rencontre de deux logiques de mobilisation distinctes. La première ressortit du mouvement de solidarité envers l’Espagne républicaine et, la seconde, d’une aide à l’enfance qui s’incarne à la fois dans des politiques publiques nationales et dans l’action humanitaire privée internationale. En ce sens, notre étude vise à croiser deux histoires : celle des réactions françaises à la guerre d’Espagne et celle de l’histoire de la protection de l’enfance42. Afin d’appréhender l’interaction entre ces deux fils directeurs, nous avons prêté une attention soutenue à la formulation par les différents groupes étudiés de la cause qu’ils promeuvent, à ses transformations successives et à son caractère souvent ambivalent, à la jonction de ces deux logiques.
Mais nous avons également postulé que l’investissement en faveur de l’évacuation et de l’accueil d’enfants espagnols en France ne s’envisage pas seulement en fonction du rapport d’un acteur donné à cette cause spécifique, quel que soit le sens qu’il lui donne (soutien à la République espagnole, aide à l’enfance). Son engagement se comprend également en considérant l’ensemble des choix qui s’offrent à lui. Par exemple, dans le domaine de la solidarité à l’Espagne républicaine, d’autres actions que l’hébergement d’enfants espagnols sont disponibles et effectivement réalisées par de nombreux partis politiques, syndicats et associations. Une organisation qui décide de soutenir la lutte républicaine peut acheminer des convois de vivres et de vêtements, ouvrir une souscription, envoyer des ambulances, recruter des brigadistes. L’aide aux enfants peut elle aussi se concrétiser de bien des manières : en finançant des colonies en Espagne, en ouvrant des cantines scolaires, des dispensaires. En France même, l’aide se dirige bien souvent vers les réfugiés au sens strict plutôt que vers les enfants évacués. La question devient désormais non plus : pourquoi, par exemple, certains catholiques français décident de créer un réseau d’hébergement pour des enfants évacués en France, mais pourquoi choisissent-ils de s’investir dans cette cause spécifique plutôt que dans une autre ? Quel est l’éventail de leurs options ?
Réciproquement, l’évacuation et l’accueil d’enfants espagnols en France sont susceptibles d’intéresser de nombreux acteurs. La responsabilité de ce programme, en France et en Espagne, suscite d’ailleurs des rivalités. Dans un article programmatique publié l’année même où nous commencions cette recherche, Frédéric Monier s’interroge « sur l’importance des choix politiques ou des affiliations partisanes dans les mécanismes d’aide aux Espagnols43 ». Il remarque que : Les logiques politiques ont […] eu des incidences lourdes. Les mésententes entre partis, syndicats et associations groupés dans le Rassemblement populaire en France, rendent compte de la dispersion des efforts de solidarité, et de la mise sur pied d’organismes à vocation humanitaire distincts, sinon concurrents44.
Il appelle ainsi à « éclaircir les relations entre membres de différents groupes45 ». Suivant cette proposition, nous avons cherché à comprendre pourquoi, parmi l’ensemble des organisations de gauche solidaires de l’Espagne républicaine, certaines s’approprient l’accueil d’enfants espagnols, et d’autres non ; ou encore pourquoi, au sein du monde catholique français, certains s’engagent dans cette cause, et d’autres non. La même question s’applique d’ailleurs, mutatis mutandis, aux acteurs espagnols, à cette différence près qu’il s’agit non plus d’étudier les relations entre des organisations privées au sein d’un champ associatif ou religieux, mais entre des ministères au sein d’un ou de plusieurs gouvernements.
Pour répondre à ces interrogations, nous avons cherché à reconstituer, d’une part, l’espace des possibles46 » pour les acteurs que nous étudions et, d’autre part, « le contexte organisationnel47 » dans lequel chacun d’entre eux s’insère. Cette réflexion s’est appuyée sur une historiographie française en plein essor et qui, sous l’inspiration de la sociologie politique, traite les engagements associatifs, non plus par des monographies d’organisations, mais en étudiant comment ces organisations interagissent avec d’autres dans des champs traversés par des rapports de complémentarité, de distinction, de collaboration et de rivalités48. Ainsi, dans son travail sur la Ligue sociale d’acheteurs (LSA), Marie Chessel situe les femmes qui animent cette association dans plusieurs sous-ensembles : celui des catholiques sociaux, celui des organisations féminines et celui de la réforme sociale. Elle montre que les fondatrices de la LSA, que leur catholicisme empêche de collaborer avec les féministes, mais qui ne se reconnaissent pas dans leurs coreligionnaires intransigeantes, trouvent dans la cause de la consommation un engagement acceptable pour leur milieu social et qui leur permet d’affirmer leur position spécifique au sein des différents univers dans lesquels elles évoluent – celui des associations féminines, celui des catholiques, celui des réformateurs. Ceci amène Marie Chessel à distinguer la cause ouvertement défendue (celle d’une consommation responsable) et des “raisons d’engagement” qui ne sont pas nécessairement liées à l’objet de l’association49 » : en l’occurrence, pour les femmes catholiques de la LSA, il s’agit d’abord de « prendre place dans la IIIe République, par le biais de l’action sociale et plus spécifiquement de la consommation50 ». Dans un domaine fort différent et tout aussi éloigné, en apparence, de notre sujet, les analyses de Michel Dobry sur les ligues d’extrême-droite en France dans les années 1930 mettent l’accent sur une étude, non de chaque mouvement en lui-même, mais de ses relations avec les autres et de la manière dont chacun d’entre eux se définit et se positionne selon des stratégies « de distinction et [des] luttes de classement51 ». Michel Dobry invite ainsi mettre en œuvre « un point de vue relationnel », c’est-à-dire à analyser « les constructions identitaires des mouvements, leurs prises de position, leurs programmes, leurs tactiques, leurs alliances, et jusqu’à maints aspects de leurs formulations idéologiques » non pas en eux-mêmes, mais en les réintégrant dans les « espaces ou univers de compétition dans lesquels [ils] agissent et se définissent, dans leurs relations aux autres mouvements qui y “opèrent” mais aussi aux contraintes et structures de concurrence propres à ces univers52 ». Pour prendre un dernier exemple, le travail d’Axelle Brodiez sur le Secours populaire français (SPF) vise, certes, à retracer l’histoire de cet organisme entre 1945 et 2000, mais aussi à lier son évolution idéologique et celle de ses modes d’action aux deux champs organisationnels auxquels il appartient. Son étude vise dès lors à éclairer comment le SPF en vient à abandonner « ce qui était un “conglomérat” communiste au profit d’un glissement vers le champ en structuration des associations de solidarité53. » C’est donc en observant les relations du SPF, d’une part avec le parti communiste et la CGT, d’autre part avec le Secours catholique, la Croix-Rouge ou encore l’Armée du salut54, que ses prises de position et les campagnes qu’il choisit de mener prennent tout leur sens.