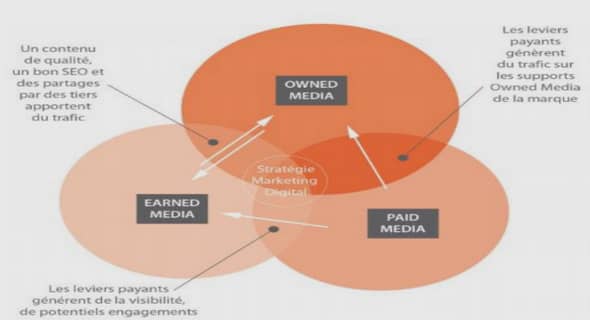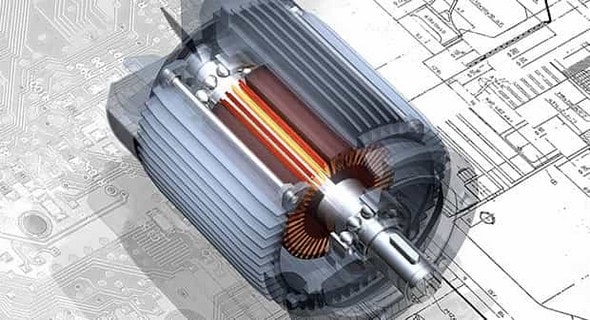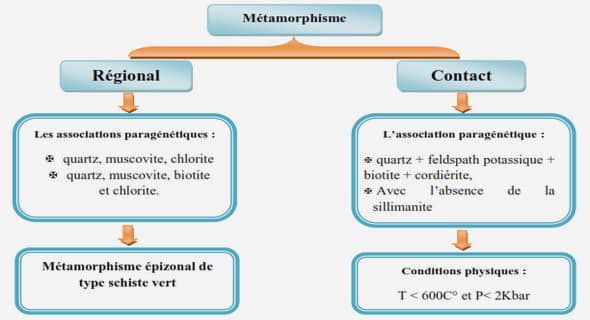Les litiges avec les autres détenteurs de la technologie d’Arkwright
Milne s’oppose à l’exécution de l’arrêt qui accorde un privilège et des subventions à Martin et ses associés pour les aider à lancer leur entreprise.
Se disant auteur et unique inventeur des machines introduites et présentées par les Amiénois, il les accuse de lui avoir purement et simplement volé son travail. Selon une lettre d’Hugand au baron de Marivets datée du 10 juillet 1784, Martin aurait été vu à Neuville, en mai, débauchant des employés de la manufacture de Milne, avec si peu de discrétion que Hugand doit faire appel au juge du lieu : « Ce fut après la mort du sieur Perret et dans l’instant critique où la manufacture de Neuville flottait entre sa prospérité et sa ruine que les sieurs Flesselle et Martin s’y rendirent furtivement pour y dérober le secret de ses machines, et en débauchant les ouvriers, ce qui donna lieu à une plainte contre eux devant le juge de ce lieu » . Toujours selon le même courrier, des rapportsde ses « conférences» avec les ouvriers lui ont été transmis, prouvant des connaissances limitées sur les procédés de filature103. Un autre mémoire, reprenant les mêmes affirmations, outeaj que le directeur de la manufacture de Neuville, Perret, allait installer les nouvelles mécaniques, et que c’est à ce moment que Martin en profite pour y « dérober le secret de ses machines»104.
Milne s’oppose à l’arrêt du 18 mai 1784, et demande sa révocation. En outre, il demande les subsides accordés aux Amiénois et leurprivilège. Martin et Flesselles, eux, soulignent le fait que Milne se présente comme l’inventeur des machines d’Arkwright, alors que celles-ci sont connues depuis 14 ans en Angleterre. De plus, ces derniers affirment que Milne aurait dû déposer des plans, des modèles, oules deux, auprès de l’administration, et cela avant la demande de Martin, pour qu’il puisse se dire inventeur de machines et afin de prouver l’antériorité de ses découvertes. Il serait, en effet, facile de trouver un moyen de copier les machines et de se présenter comme inventeur ou introducteur des mécanismes privilégiés, afin de récupérer les avantages donnéspar l’administration. S’ensuit nombre de mémoires virulents, dont voici certains extraits : « Jamais peut-être l’ignorance avide n’a usurpé, avec plus de hardiesse, les fruits du talen ; et jamais elle n’abusa, avec plus d’audace, du penchant de sa Majesté à protéger et à encourager les arts utiles. Le suppliant [Milne] vient, avec confiance, aux pieds du trône, pour réclamer contre cette usurpation. », ou encore : « un étranger [Milne] qui semble ne s’être expatrié que pour s’approprier, à ce titre seul, les fonds destinés à entretenir et exciter le zèle des artistes vraiment utiles », etc.
L’affaire se poursuit par une visite et une description des mécaniques par l’abbé Rochon, Coulon et Desmarets, ordonnée le 17 mars 1785 au Conseil d’Etat : « l’établissement rs rs abbé Rochon, Coulon formé par les S Martin, Flesselles et Lamy sera vu et visité par les S et Desmarets que sa majesté a commis et commet à l’effet d’examiner les mécaniques construites dans led. établissement , de constater les différences ou les rapports qui peuvent se trouver entre lesd. machines et celles construites par le S. Milne, dont lesd. Srs Commissaires ont déjà eu connaissance, et de donner leur avis, tant sur lesd. rapports ou différences que sur la perfection plus ou moins grande, de ces machines comparées les unes avec les autres, ensemble sur la priorité d’invention réclamée tant par led. S. Milne que par lesdits Martin, Flesselles et Lamy. »105. Après examen, le rapport des trois éminents personnages soutient, tout d’abord, que la machine à carder a bien été introduite en France par Milne et présentée au gouvernement en 1779, comme le prouve une lettre de Tolozan, intendant du Commerce adressée à Holker, inspecteur général des manufactures étrangères. D’autre part, la machine à carder de Milne semble plus perfectionnée, puisqu’elle effectue en une étape ce que Martin réalise avec deux machines et donne un meilleur produit que celles qui sont détenues par celui-ci. Cependant, ces dernières, d’un usage plus simple et plus robuste, demandent moins d’entretien et sont recommandées par les trois commissaires. Mêmes remarques pour les machines à faire les mèches des deux parties : les mécanismes de Milne,plus complexes, sont désavantageux, face aux machines de l’Epine faisant un travail plus parcellisé et plus simple. Ensuite, la description des machines à filer ne révèle que de légères différences, premièrement au niveau de la force motrice : ainsi, la force hydraulique fait mouvoir les machines de Martin, par précédemment, les commissaires chargés de l’inspection préfèrent les machines plus simples des Amiénois, plus faciles à fabriquer, à réparer et à entretenir. L’abbé Rochon, Coulomb et Desmarets affirment que les machines de l’un et l’a utre sont construites sur le même principe, dont l’inventeur est incontestablement Arkwright. En outre, ils ne voient pas en Milne l’inventeur qu’il se prétend être, ses seules idéesont constituées de la substitution des engrenages aux poulies et à la réunion de plusieurs procédés distincts. Par contre, il semblerait bien, comme on l’a vu, qu’il soit le précurseur de l’introduction de ses machines en France. Reprenant les idées d’Holker, il se refuse à réclamer tout privilège exclusif, qui « nuit au progrès de l’art et cause enfin une perte à l’Etat qui est incomparablement plus grande que le profit qui en résulte pour l’individu qui le possède ». Les inspecteurs concluent que le plus sage serait de récompenser les deux parties, mais «sans cependant avoir le plus faible droit de gêner les particuliers qui voudraient s’en occuper »106. Ce Rapport cherchant à ménager les deux parties, prouve que Martin et Flesselles ont, les premiers, fondé une manufacture sur le principe d’Arkwright, dont les mécanismes se meuvent grâce à la force hydraulique.
Il n’est pas impensable que cette querelle ait un quelconque rapport avec la rivalité entre Holker et Roland de la Platière. On pourrait même penser que ce n’est qu’un prolongement de l’inimitié entre ces deux hommes.
En effet, Milne, dans plusieurs de ses mémoires, cite le nom de l’inspecteur général des manufactures étrangères comme son protecteur etsoutien lorsqu’il est venu en France , pour lui avoir présenté ses mécanismes et, en contrepartie, celui-ci s’est chargé des frais de voyages de Milne jusqu’à Paris. Madame Roland nous donne, à cet égard, un portrait peu flatteur de Milne : « Si l’Anglais à la mécanique dont vous voulez parler était par hasard un nommé Milne, croyez que c’est un maître fripon, bien connu dans ce pays-ci, et qu’il n’est bon, comme tant d’autres, à attraper l’administrati on »107.
Roland, ami de Flesselles depuis son arrivée à Amiens108, a abondamment oeuvré pour l’obtention des aides de la monarchie . Ici, nous pouvons dire quelques mots sur les relations particulièrement épidermiques entre Holker et Roland de la Platière. L’inimitié entre les deux hommes se double d’un désaccord sur la politique économique. Roland de la Platière, dans sa préface de l’Art du fabricant du velours de coton de 1780 à 1783, affirme que la supériorité des velours de coton anglais vient des conséquencesdes mauvais principes économiques : le perfectionnement des techniques et une meilleure organisation du travail, la diminution du coût de revient et l’augmentation de la qualité, d’après Roland, ne sert à rien. Il faut tout d’abord supprimer le système des manufactures privilégiées, qui permet à des gros entrepreneurs monopolisant la production de s’accorder sur les prix et les bloquer à des niveaux élevés. D’autre part, les entrepreneurs devraient partager leurs secrets afin de diffuser largement les procédés de production. D’après l’auteur, il est impératif de poser les bases d’une concurrence équitable au-dedans des frontières françaises, afin de supporter la concurrence et de vaincre l’industrie anglaise. L’a ttaque contre Holker, noyée dans sa pensée économique, est soulignée par Roland en traitant le Britannique de « calandreur de Manchester […] échappé et fuyant». Cet antagonisme des deux personnages est encore présent dans les six Lettres imprimées à Rouen en octobre 1781, dont quatre rédigées par Roland, où Holker est qualifié de «chevalier d’industrie », et dans lesquelles l’auteur insiste sur la bassesse de ses origines. Il donne comme raison de la réussite de l’expatrié «l’intrigue transformée en impudence» doublée de «l’art de se faire valoir »109. La rancune de Roland vient sûrement du fait que Holker, pendant les dix ans où l’inspecteur est resté à Rouen, lui a fermé la porte de sa manufacture au nez, cumulant ainsi une charge administrative et une entreprise, tout en privilégiant ses intérêts personnels, et, comme on l’a vu, en voulant connaître les autres procédés anglais importés à Amiens.
Les attaques de Roland se heurtent aux défenseurs de Holker. Brown rappelle dans la Lettre d’un citoyen de Villefranche à M. Roland de la Platière, académicien de Villefranche la vie et l’œuvre de Holker, et souligne le soutien accordé à beaucoup de ceux qu’il a rencontrés. Les plaintes de Holker, entendues par l’Académie des Sciences, ont eu comme conséquence la suppression de la Préface del’Art du fabricant de velours de coton . Différend doctrinal, où Holker a un intérêt, et où les rancunes personnelles se cumulent. Cette querelle entre Roland de la Platière et Holker paraît s’êtreprolongée et confondue avec celle de Martin et Milne110.
« Cet homme, qui se dit de famille noble, est né et avécu dans la plus grande abjection et dans la misère : il n’avait pour rouler sa calandre qu’un cheval aveugl e, auquel il faisait la litière et qu’il pansait lui-même ; son nom était perdu dans la plus vile populace de Manchester ; son humble épouse, qui lui aidait à tout de son mieux, ne savait ni lire ni écrire… il ment, il ne savait rien quand il y est venu ; il n’y a rien importé que de l’intrigue transformée en impudence… il ment, lorsq u’il dit que sa tête était à prix ; prisonnier à Newgate comme un échappé de la Conciergerie, il eût été exécuté si on l’eût repris, mais il ne fut jamais question d’argent pour un homme de cette sorte… il ment touj ours… Ledit chevalier est un chevalier d’industrie. », écrit L’affaire se poursuit le 2 février 1785 : dans un mémoire adressé à Montaran, «à la veille de commencer à jouir du fruit de tant de tra vaux et de dépenses», Martin, Flesselles et Lamy nous apprennent que, non loin de l’Epine, à Ra mbouillet, et grâce à des relations bien placées, leur rival Milne veut établir une manufacture concurrente à la leur, avec l’aide de la monarchie, ou, « à l’ombre du trône », comme écrivent de manière délicate les associés amiénois. Ceux-ci réclament une sorte de « protection éducatrice » pour leur établissement, car l’installation de Milne à Rambouillet, avec les appuis bien placés dont il dispose aurait comme conséquence «leur ruine entière [et] inévitable», et « ne pourrait qu’étouffer, pour ainsi dire dans son berceau celui du S. Martin, Flesselles et Lamy, et par suite ruiner ces malheureux pères de famille et leurs créanciers .»111. Le projet d’installation de Milne à Rambouillet semble en rester là, « l’importance des dépenses nécessaires y fit renoncer »112.
La fin du litige entre Milne et Martin s’achève par la victoire de l’intérêt général sur les intérêts particuliers. En effet, une lettre ducomte d’Angivilliers du 7 avril 1785 souligne l’importance de conserver les étrangers « qui peuvent aller porter leur industrie dans les pays étrangers et surtout en Amérique», et désire «le plus simple et le plus juste », que « chacun d’eux eut globalement un privilège »113.
Cette recherche de compromis entre industrialisation et intérêts particuliers est aussi souligné par une autre lettre écrite le 12 avril par le duc de Mouchy, qui souhaite le profit de tout le monde, mais en aucun cas la destruction d’industrie, encore moins la ruine des uns ou des autres : « Il seroit d’ailleurs très malheureux pour d’honnêtes gens, qui ont tout quitté pour monter [des entreprises], de se trouver ruinées eux et leur familles faute d’avoir été bien et suffisamment examinés». D’autre part, il met en exergue le fait qu’il n ’a « nul autre intérêt personnel que de les avoir établi dans mes terres où je serois très aise qu’ils pussent prospérer pour les bien de mes vassaux.»114. Le travail du coton est ici conçu par le duc de Mouchy comme un moyen de lutter contre la pauvreté des campagnes115. On reconnaît par là les idées de Holker, qui s’oppose à tout privilège exclusif, procédé bloquant la diffusion des nouveautés industrielles. Martin et Flesselles conservent leur privilèges, et Milne, le 5 octobre 1785, se voit accorder un encouragement de 60 000 livres, dont 36 000 livres pour rembourser un de ses créanciers, Leroy de Chaumont, et 24 000 livres comme « prix et récompense » de leurs mécaniques, plus 6 000 livres de gratification annuelle et un local, et enfin une prime de 1 200 livres par chaque machine construite116. Il s’engage à résider en France, à fournir également un assortiment complet de ses mécaniquespour la filature continue au Cabinet des machines du Gouvernement, qui est placé « dans un dépôt rue de Charonne »117, à Paris, et à diriger personnellement l’activité d’un atelier pour la construction des machines afin de pouvoir en doter d’autres manufactures françaises 118, « dans le cas où ils ne pourraient convenir du prix, il sera fixé et déterminé par MMles. intendants du commerce chargé du département des toiles ». Enfin, les Milne sont autorisés à « former dans le royaume, soit personnellement, soit par le moyen des sociétés qu’ils pourront contracter tel nombre d’établissement du même genre qui, jusqu’à ce jour,ont obtenu des privilèges à cet effet »119.
Le litige qui oppose Milne et Martin ne va pas êtrele seul. En effet, deux autres ouvriers anglais introduisent la machine de filature continue en France, Flint et Theakston, dits Wood et Hill, des anciens employés d’Arkwright, en association avec Lecamus de Limare, Decrétot et Piéton, puis Defontenay120. En 1785, « Lesd. Sieurs Vood, Flin [sic], Decrétot et Compagnie réclament contre l’établissement formé par lesd. Martin et Flesselles attendue la similitude qu’ils prétendent exister dans les deux mécaniques[…] ». Le 21 janvier 1785, une lettre de la veuve Defontenay et fils, de Jean-Baptiste Decrétot et Petou adressée à Montaran et recommandée par le marquis de Conflans expose leurs réclamations. «La voix publique » leur a appris que Martin et Flesselles se proposent d’établir une usine semblable à la leur. Les associés de Louviers réclament contre« cette tentative » la « sagesse » et la « justice » de Montaran. Ils exposent dans leur lettre qu’ils ont entretenus « les Srs Woode [sic] et Hill, possesseurs du vrai secret de cette mécanique », qu’ils leur ont fourni les fonds nécessaires à leurs essais, et « obtenir en traitant avec eux qu’ils fermassent les oreilles aux propositions de l’étranger ». Ils affirment en outre qu’ils n’auraient pas ef fectué tout cela en vue de fonder leur entreprise « auprès de Louviers, situation intéressante par sonvoisinage avec une manufacture de draps célèbre» s’ils n’avaient pas obtenu du gouvernement un privilège exclusif, le 19 octobre 1784. On peut également y lire l’état d’avancement à cette date des opérations préparatoires à l’installation de la filature : « Nous y avons déjà acheté un emplacement à un prix très cher, parce que nous avo ns été forcés par le local et pressés par le temps. Nous avons arrêté des marchés avec des vriersou et fait un traité avec les Srs Wood et Hill ». Ils se plaignent, en outre, que l’administration prodigue des avantages et les fonds publics « à tout ceux qui lui présenteront des projets séduisants dont le plus grand nombre tromperai » le gouvernement : il faut distribuer des « privilèges sagement limités». Ils rappellent ensuite que le privilège dont ils jouissent « n’a que quinze ans de durée : il est attaché à la condition que nous établirons la première mécanique à Louviers dans un an, et quatre autres de deux ans en deux ans dans les lieux que le Gouvernement indiquera ». Si les associés ne remplissent pas ces conditions, leur privilège cessera et « la liberté sera rendue à une industrie plus heureuse ». Par contre, s’ils remplissent leurs engagements, la durée de leur privilège « ne peut être ni une gêne trop dure pour le public,ni une récompense excessive de [leurs] soins et de [leurs] avances ». Enfin, ils indiquent que leur privilège « empêche la multiplication trop rapide de ces machines », que « c’est par cela qu’il est digne de faveur, parce que cinq cent mille ouvriers ne subsistent en ce moment que par la filature, et qu’il seroit dangereux de leur ôter trop précipitamment ce moyen de vivre »121. L’administration résout le litige le 26 janvier 1785 en affirmant que les réclamations des Decrétot et C n’ont pas lieu d’être : l’arrêt accordé à Martin et Flesselles étant antérieur en date à celui des manufacturiers de Louviers, « ce serait plutôt aux premiers à se plaindre, à moin s que la machine de Decrétot ne soit pas la même que celle edFlesselles »122. Il ne semble pas que les associés amiénois aient réclamé contre l’installation de la filature de Louviers.
Le Bureau du Commerce ne compte pas annuler le privilège exclusif des uns ou des autres. Il veut « limiter l’envergure des privilèges », et la « dimension des affaires qui tendent au gigantisme », car « les concurrents sont puissants grâce à leur assise financière et à leurs protecteurs » : « Philippes de Noailles et Roland de la Platière pour Martin, le marquis de Conflans pour Wood et Hill et l’administration puis le duc d’Orléans pour Milne »123. Plus que le favoritisme pour un parti ou l’autre, la priorité est donnée à la diffusion du machinisme en France : il faut, selon Blondel, « favoriser l’établissement des mécaniques anglaises » par « les vues sages du gouvernement qui cherchent à exciter le zèle et l’industrie ». Le gouvernement n’a donc pas de scrupules dans la poursuite de la politique de mutation des structures productives, lorsqu’il récompense successivement, le 18 mai et le 19 octobre 1784, le 20 octobre 1785, par trois privilèges analogues et exclusifs pour l’introduction des machines d’Arkwright, Martin et Flesselles, les fabricants de Louviers et les Milne, « assurant ainsi trois centres d’expansion aux mécaniques dont il voulait propager l’emploi », afin d’introduire le plus largement possible les nouveaux procédés dansl’industrie française 124.
Le gouvernement facilite les atteintes aux quelques monopoles d’exploitations accordés, qui sont perçus comme des entraves à la c oncurrence, en permettant la création d’exploitations rivales, afin de jeter les bases de plusieurs manufactures-pilotes, « points nodaux de réseaux de diffusion, souvent liés à des transferts technologiques et matrices d’entreprises innovatrices »125.