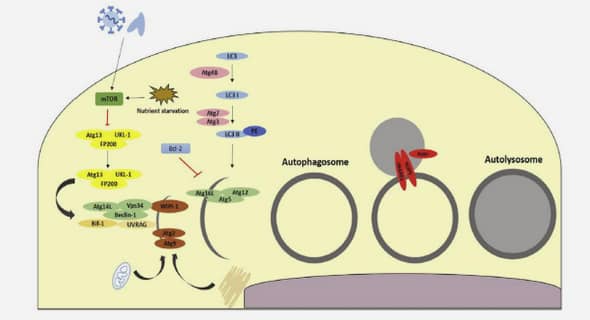La douleur selon l’I.A.S.P : International Association for the Study of Pain définit celle ci comme étant une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire présente ou potentielle ou décrite en termes évoquant une telle lésion. Définition élaborée en 1971, mais qui est toujours de mise et d’actualité car elle est consensuelle, concerne la douleur aigue, la douleur chronique, la douleur organique, la douleur psychogène, et la douleur expérimentale.
La Douleur aigue :
La douleur aigue est un symptôme, un signal d’alarme, elle est utile et protectrice. Elle peut être : récente, transitoire, d’évolution brève et souvent de forte intensité. Avec une durée inférieure à trois(03) mois. Elle signale une agression ou un dysfonctionnement qui doit être traité. La prise en charge de la douleur aigue est simple. Il existe de nombreuses recommandations et protocoles pour la gestion de celle-ci. Il est important de signaler que non traitées, les douleurs aigues constituent le lit de la chronicisation.
La Douleur chronique :
Elle n’est plus un symptôme ; il s’agit d’une véritable maladie dont les complications constituent des répercussions délétères pour l’individu (sociales, psychologiques). [8] Elle est dévastatrice [21].et déstructure l’individu dans sa totale intégralité. On définit la douleur chronique quand sa durée dépasse 3 mois à 6 mois.
Les Composantes Fondamentales :
La Douleur est une expérience subjective
Une Composante Sensori-discriminative :
Elle assure la détection des stimuli de la douleur et permet l’analyse de sa topographie, de son intensité, de ses caractéristiques. Ainsi est définie la nociception « Souffrir dans sa chair ». [22].
Une composante affectio-émotionnelle :
Elle est exprimée par la notion « désagréable » pénible de la perception douloureuse pouvant entrainer anxiété et dépression. « Souffrir avec son cœur »[22].
Une composante cognitive :
Elle se réfère à l’ensemble des processus mentaux pouvant moduler les autres dimensions de la douleur. « Souffrir avec sa tête » .
Une composante comportementale :
C’est l’ensemble des modifications observables induites par la douleur (psychologique, verbale, motrice) « Souffrir avec des gestes » [22]. Pour toutes ses composantes, la douleur est considérée comme pluridimensionnelle.
Mécanismes générateurs
La douleur nociceptive :
Elle résulte de la stimulation de nocicepteurs, elle est de cause mécanique ou inflammatoire. Elle est de topographie régionale mais non neurologique. Pour cela l’examen du système nerveux est normal.
DIFFERENCES ENTRE DLR AIGUE ET DLR CHRONIQUE.
L’interrogatoire et l’examen clinique permettent le diagnostic [21] du mécanisme de la douleur qui peut être nociceptive ou neuropathique induisant une prise en charge différente selon la cause.
Les douleurs par excès de stimulation des « nocicepteurs » d’origine somatique ou viscérale entrainent la libération de substances algogènes et inflammatoires.
Ex : traumatisme, brûlure, ischémie de l’infarctus du myocarde. L’envahissement tissulaire d’un cancer peut constituer un exemple. La douleur neuropathique : zona, Neuropathie diabétique, S.E.P (sclérose en plaques).
Douleur Mixte : la douleur nociceptive est associée à la douleur neuropathique.
Douleur d’origine psychogène : il s’agit d’une douleur « sine matéria » :
Sans lésion tissulaire, sans lésion nerveuse décelable. Le diagnostic doit être évoqué sur les données de l’examen clinique :
– Elle est de topographie atypique,
– Elle est de description imagée, avec importance de signe d’accompagnement (insomnie [21], anxiété, asthénie) et un contexte psycho-socio-professionnel. Il s’agit ici d’un diagnostic constructif[22], mais non d’élimination.
Conséquences de la Douleur
La douleur entraine une :
• Douleur physique avec une lésion douloureuse et des symptômes associés.
• Une douleur morale avec anxiété, dépression, peurs, solitude, perte de l’autonomie et perte de contrôle.
• Une douleur sociale avec la perte de la position sociale, des revenus, et du rôle dans la famille.
• Une douleur spirituelle avec des interrogations .
I- INTRODUCTION |