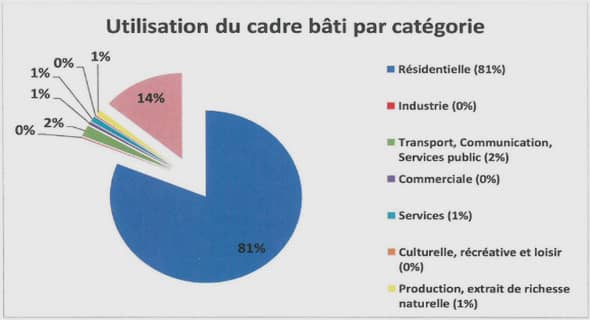Le sexe du syndicalisme
La féminisation du syndicalisme en Suisse n’avait pas donné lieu jusqu’à présent des recherches sociologiques. Les recherches sur les syndicats en Suisse étaient surtout composées de quelques travaux historiques, souvent effectuées à la demande des syndicats de l’USS ou par les syndicats eux-mêmes. Parmi elles, on soulignera principalement les recherches de Robert Fluder (Fluder et al. 1991) ainsi que les nombreux travaux de l’historien bâlois Bernard Degen (Degen 2014) qui apportent une riche contribution à l’histoire syndicale et qui ont contribué à la mise en place d’archives1 peu explorées. Concernant les travaux historiques sur les femmes et le mouvement ouvrier, nous noterons les contributions de l’historienne Brigitte Studer (Studer 1995; 1996; 2001) ainsi que la thèse de Nora Natchkova (Natchkova 2011). Il y a quelques années, un numéro du Cahier d’histoire du mouvement ouvrier a été également consacré aux femmes dans le mouvement ouvrier (Valsangiacomo et Villiger 2013). Un récent livre retrace les cycles de grèves des années 1970 (Deshusses 2014). La question plus spécifique des femmes dans le mouvement ouvrier et dans les syndicats est abordée dans quelques rares travaux d’historiennes (Studer 1995; Mahaim et Gaillard-Christen 2000; Gül 2004; Natchkova 2011; Marti 2013). En science politique, il existe quelques recherches concernant la structure du champ syndical helvétique ainsi que son évolution du 20e siècle à aujourd’hui (Kriesi 1998; Oesch 2008). Elles relèvent principalement la structure clivée et fragmentée des organisations syndicales tant au niveau national que régional. Elles avancent des explications macrosociologiques de la structuration de l’espace syndical en Suisse. L’étude des groupes d’intérêt consacre également des points d’analyse du rôle des syndicats dans le système des relations professionnelles en Suisse (Mach 2015) et des syndicalistes au Parlement (Pilotti 2017). Concernant les profils des dirigeant×e×s des syndicats, une étude sur « le renouvellement des élites » au sein de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l’horlogerie (FTMH)2 permet d’entrevoir quelques transformations sociologiques (Widmer 2007). Mach et Widmer observent notamment ce changement dans l’élite syndicale de la FTMH. Il existerait une rupture relativement nette entre les caractéristiques sociologiques des membres du comité́directeur du syndicat FTMH jusqu’à la fin des années 1980 et celles de leurs successeurs » (Mach et Widmer 2004, 123). Les « nouveaux dirigeants » ont ainsi des profils de formation plus élevé (universitaire), ne sont pas issus de la branche professionnelle qu’ils/elles organisent et sont actifs dans les partis politiques de gauche (souvent le Parti socialiste suisse (PSS)) avant d’occuper un poste de permanent×e syndical×e. Ce changement de profil des syndicalistes va de pair à la même période, avec le fait que la FTMH développe un nouveau rapport à l’État et fait recours à une plus grande diversité des registres d’action que la seule négociation de conventions collectives de travail (CCT) (Widmer 2007).
Cette faiblesse de la recherche contraste avec le renouveau en Europe des recherches sur le monde syndical dans une perspective de genre. Il existe en effet une littérature anglo-saxonne et francophone importante au sujet de la féminisation des syndicats dont nous retraçons quelques questionnements principaux. Les recherches anglophones, ancrées dans le champ des relations professionnelles, se sont interrogées sur la place des femmes dans les syndicats, avec des chercheuses au profil particulier1 comme Cynthia Cockburn qui pose déjà au début des années 1980 la question de la sous-représentation des femmes et de leurs intérêts dans les syndicats (Cockburn 1983). Elles ont également largement investigué le rôle des politiques d’égalité (Kirton et Healy 2013), et plus spécifiquement des dirigeantes féministes (Kirton et Healy 1999) et des commissions non mixtes (Briskin 1993) sur l’engagement des femmes dans les syndicats. Elles ont interrogé également l’impact sur l’engagement des femmes du type de syndicalisme, interprofessionnel ou corporatiste (Cobble 1990) ou ont encore analysé des campagnes en faveur de la syndicalisation des femmes (Briskin 2011). Elles ont analysé les étapes des carrières des femmes syndicalistes (Ledwith, Sue et al. 1990; Briskin 1990), et l’existence de carrières alternatives (Kirton 2006), dont l’analyse invite à sortir d’une vision androcentrée prenant uniquement les carrières masculines comme modèle. En France, après les travaux pionniers de Margaret Maruani (1979) ou de Marie-Hélène Zylberberg-hocquard (1978), et de Danièle Kergoat sur la coordination infirmière (Kergoat et al. 1992), ce n’est que plus tard que ce domaine de recherches va se développer en élargissant les questionnements notamment aux militantes syndicales et aux difficultés de combinaison de l’engagement politique ou syndical avec la vie privée (Le Quentrec et Rieu 2003; Le Quentrec 2009), aux politiques internes mises en place par les organisations pour inclure davantage de femmes (Guillaume 2007a; Guillaume et Pochic 2009) ou aux mobilisations de femmes dans des secteurs peu qualifiés (Béroud 2013). La revue Travail, genre et sociétés consacre même un numéro en 2013 à la question du « genre, féminisme et syndicalisme » faisant dialoguer dans le dossier « des enquêtes inédites sur les stratégies syndicales en faveur de la représentation des femmes et de leurs intérêts, dans des contextes nationaux différents » (Guillaume, Pochic, et Silvera 2013, 30).
Un constat partagé par ces études comparées (Silvera 2009) et qui nous intéresse particulièrement ici est que malgré la féminisation des adhérent×e×s syndicaux×ales et une volonté affichée de féminiser les organisations, les femmes restent sous-représentées dans les structures syndicales. Le contexte organisationnel n’est pas le même en Suisse. À commencer par les taux de féminisation des adhérent×e×s qui sont bien plus bas. Comment se féminisent des syndicats dans un système sans décharge syndicale, où le syndicalisme s’exerce généralement sur le temps libre des militant×e×s ou de manière complètement professionnelle » ? Quels sont les profils et les trajectoires des femmes syndicalistes dans ce contexte particulier ? Comment les femmes syndicalistes en Suisse se font-elles une place dans un milieu encore plus masculin qu’ailleurs ?
Définir le genre et l’observer
L’étude de la féminisation du syndicalisme rend nécessaire une attention particulière aux rapports sociaux de sexe dont l’analyse a longtemps été délaissée par les scientifiques. Or, un des apports des études féministes est d’avoir montré que les organisations militantes, même celles dont les discours s’inscrivent dans la défense des droits des femmes, ne sont pas neutres en termes de fonctionnement (Acker 1990). En effet, « les rapports sociaux de sexe imprègnent en profondeur tous les mouvements sociaux, et cette considération doit toujours être présente quand on les analyse » (Kergoat et al. 1992, 122). Les syndicats, comme les autres organisations, ont longtemps été considérés comme « neutres » du point de vue du genre. Les femmes y sont souvent invisibilisées, que ce soit dans les luttes elles-mêmes, dans la manière dont les organisations se construisent ou parce que les sciences sociales sont longtemps restées aveugles et androcentrées (Chabaud-Rychter et al. 2010), contribuant à cette invisibilisation. Nous utiliserons donc ici les apports des recherches récentes pour mettre le syndicalisme à l’épreuve du genre.
La recherche féministe a montré que les inégalités ne sont pas la conséquence naturelle d’une différence biologique qui d’une part n’est pas binaire, il n’existe pas que deux sexes biologiquement, et d’autre part, n’aurait pas particulièrement d’impact si la société n’y donnait pas une telle importance. Ainsi, « si le genre n’existait pas, ce qu’on appelle le sexe serait dénué de signification, et ne serait pas perçu comme important ; ce ne serait qu’une différence physique parmi d’autres » (Delphy 2001, 27). Nous nous inscrivons dans une perspective féministe matérialiste, où le genre est considéré comme un système de relations sociales de pouvoir, structuré par une division binaire entre « les hommes » et « les femmes », constituées en catégories naturalisées alors qu’elles sont socialement construites (Cameron et Scanlon 2014). Ces deux catégories sociales ne recoupent pas la complexité des identités sexuelles qui existent dans la société. En revanche, elles façonnent des individus genrés et structurent fortement la société et son fonctionnement. Comme d’autres rapports sociaux de domination (en particulier la classe et la « race » au sens sociologique), elle se caractérise par la subordination d’un groupe social (les femmes) sur l’autre (les hommes). Dans cette thèse, lorsque nous utilisons le terme « homme » ou « femme », nous ne l’entendons donc pas comme une catégorie biologique, mais bien comme une catégorie socialement construite.
Contre l’idée que l’égalité est aujourd’hui acquise ou presque, nous suivons l’analyse de Kergoat qui oppose l’amalgame entre le déplacement des relations sociales et la fin du rapport social de sexe. Il existe en effet deux niveaux de réalité : celui des relations sociales et celui des rapports sociaux. La différence est que les relations sociales sont immanentes aux individus concrets entre lesquels ils apparaissent alors que les rapports sociaux sont abstraits et opposent des groupes sociaux autour d’un enjeu. Kergoat attire l’attention sur le fait que si les relations sociales bougent, et qu’une femme dans un couple hétérosexuel peut par exemple gagner plus que son conjoint, il n’en reste pas moins que structurellement, le groupe social des femmes est toujours exploité. Ainsi, le rapport social de domination des hommes sur les femmes continue à opérer et à s’exprimer sous ses trois formes canoniques : l’exploitation, la domination et l’oppression (Kergoat 2009, 113). L’exploitation s’illustre notamment par le différentiel de salaires, la domination par le plafond de verre et l’oppression par les violences machistes. Dans une approche relationnelle des sexes, s’il y a donc bien déplacement des lignes de tension, le rapport social, en tant que rapport de production idéelle1 et matérielle (Godelier 1982), reste inentamé. Ce rapport social que nous analyserons est donc un rapport de pouvoir dans lequel les « hommes », en tant que groupe socialement constitué, forment une classe de sexe » et occupent une position sociale dominante dans le système patriarcal. Pour penser ce rapport social de sexe, nous tenons compte du fait que chaque catégorie de sexe se définit dans son rapport à l’autre. Il n’y a pas « un monde féminin » et « un monde masculin », mais un système de genre qui produit le féminin et le masculin et en fait un « arrangement social », informant chacun×e sur qui est dominé×e et qui est dominant×e (Goffman 2002). Même si notre objet porte sur la féminisation des syndicats, et si les femmes syndicalistes sont au cœur de notre recherche et de nos analyses, nous enquêtons sur l’ensemble des acteurs et actrices syndicaux, sur leurs parcours et leurs interactions. C’est par la combinaison des entretiens approfondis et de l’observation des pratiques et des interactions que nous pensons pouvoir mettre au jour de manière située les rapports sociaux de sexe dans les syndicats.
Pour appréhender la féminisation du syndicalisme, nous combinerons une approche par les acteur×trice×s et par leur propre récit de leur parcours de vie et par les organisations. En effet, la réalité est à la fois objectivée dans le sens où les individus et les groupes « se servent de mots, d’objets, d’institutions, etc. légués par les générations antérieures, les transforment et en inventent de nouveaux », mais ces ressources objectivées « agissent en retour comme contraintes sur leur action » (Corcuff 1991, 516). La réalité est également le produit des représentations et des pratiques des individus et des groupes et existe à l’état intériorisé via divers processus de socialisation (Berger et Luckmann 1986). Dans cette perspective, nous articulerons différents niveaux de compréhension de la réalité sociale en ne nous arrêtant ni aux seules structures ni aux seuls individus.
Pour mener à bien notre recherche, nous avons donc associé deux traditions et orientations de recherche : l’approche interactionniste et la sociologie des organisations, qui permettent de ne pas dissocier les engagements des pratiques dans des organisations régulées par des normes, des règles et des interactions.
Dans le sens où tout rapport social inclut une part de pensée et n’est pas seulement un rapport de domination matériel.
Des organisations genrées
la suite des travaux fondateurs de Connell (1987) qui introduit la notion de régime genré » pour pointer la construction du genre à l’échelle locale, c’est essentiellement sur l’approche de Joan Acker que nous nous appuyons, avec la notion d’organisation genrée » et du renouveau des études sur la socialisation par le déplacement du regard des « produits » de la socialisation vers la socialisation « en train de se faire » et par la concentration sur les socialisations secondaires aux dépens de la seule socialisation primaire.
Plutôt que d’expliquer les inégalités de genre uniquement par des facteurs externes aux organisations, nous veillerons à ne pas négliger les processus internes. Nous considérons que les rapports sociaux de sexe se produisent aussi au sein même du syndicalisme. Nous nous inscrivons ainsi dans le prolongement de recherches qui en ont éclairé certains aspects, comme l’impact du modèle du militant consacré corps et âme à l’activité militante (Buscatto 2009; Le Quentrec et Rieu 2003), les exigences de disponibilité et de mobilité pour progresser à la CFDT (Guillaume 2007b), le sacrifice de la vie privée (Trat et Zylberberg-Hocquard 2000; Guillaume et Pochic 2011). Nous ne considérerons pas uniquement la place des femmes dans les syndicats comme le simple produit statique de déterminations sociales globales, mais comme résultant aussi de processus d’actualisation des rapports sociaux de sexe au sein même du fonctionnement syndical (Dunezat 2006; Guillaume 2007b) et du caractère genré du façonnage organisationnel dans les syndicats (Fillieule et Monney 2013). Nous interrogerons les pratiques quotidiennes et la culture en train de se faire des syndicats pour comprendre comment les femmes syndicalistes font leur place et s’insèrent dans ces milieux d’hommes. Dans notre analyse de la féminisation des syndicats, nous porterons donc une attention particulière au poids de la socialisation organisationnelle en analysant le rôle joué par les syndicats dans la production des inégalités.
Des carrières genrées
L’approche par la sociologie des organisations n’étant pas suffisante pour comprendre ce qui amène les individus à agir, à s’engager et à se désengager des syndicats, nous utiliserons des outils de la sociologie des engagements militants en utilisant en particulier le concept de « carrière », qui s’inscrit dans la tradition sociologique interactionniste (Hughes 1956; Becker 1966; Goffman 1968). « Appliquée l’engagement politique [ici syndical], la notion de carrière permet de comprendre comment, à chaque étape de la biographie, les attitudes et comportements sont déterminés par les attitudes et comportements passés et conditionnent à leur tour le champ des possibles à venir, restituant ainsi les périodes d’engagement dans l’ensemble du cycle de vie » (Fillieule 2001, 200). C’est la multiplicité des sites d’inscription des syndicalistes et la variabilité de la valeur accordée, au cours du temps, à l’engagement dans tel ou tel site que nous avons explorées. Inscrire les trajectoires dans leur contexte permet de porter une attention particulière aux temporalités de l’action collective et aux possibles « effets de périodes » (Sommier 2011, 262). Elle permet également d’analyser l’imbrication entre les différentes sphères de vie, en évitant de prendre la carrière professionnelle rémunérée comme principale source identitaire (Kirton 2006, 48) et de tenir compte de « leur multipositionnalité et [de] la pluralité des modes de relations et des formes d’intérêts qui en découlent » (Sawicki 1997, 27). Elle permet également de mettre au jour les logiques de désengagement, essentielles dans la compréhension de la féminisation des syndicats, car le turn-over y est conséquent. Les récentes recherches sur les conséquences biographiques de l’engagement des militant×e×s des années 1968 montrent effectivement que les effets du militantisme s’énoncent fréquemment en termes de coût, encore plus pour les femmes sur lesquelles repose principalement la prise en charge du travail domestique (Leclercq et Pagis 2011; Biland, Moalic-Minnaert, et Yon 2018; Lechaux et Sommier 2018; Masclet, Porée, et Bargel 2018). Ces outils de la sociologie de l’engagement militant permettent de questionner le syndicalisme en sortant des approches macro et par le haut en réinterrogeant les pratiques et les acteurs/actrices. Si certains travaux sur les femmes syndicalistes intègrent des aspects des trajectoires dans leurs analyses, peu utilisent pleinement le concept de carrière en évitant les écueils d’une analyse coûteuse en termes de dispositif de recherche (Agrikoliansky 2017). C’est ce dispositif que nous retraçons dans la section suivante.