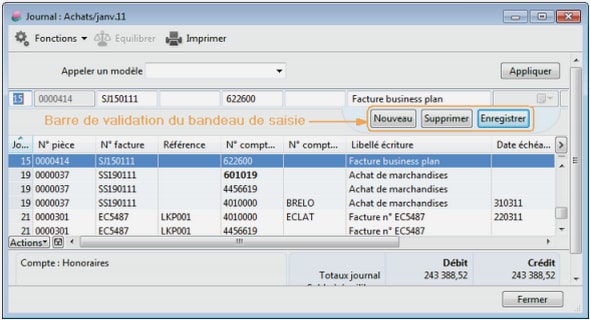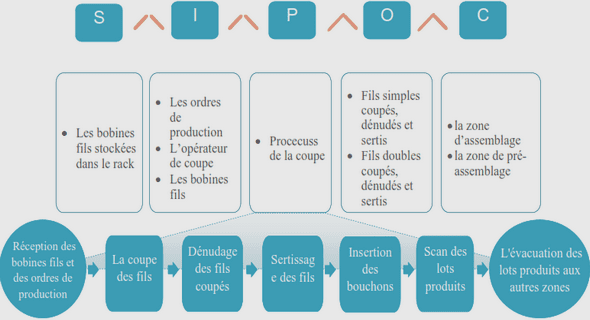Méthode et plan
La sélection des meubles, objets et vêtements d’apparat, dans les inventaires après décès de ces femmes nobles, se fait selon plusieurs critères.
Tout d’abord, l’estimation du prix, fournie par le notaire, est un des premiers éléments qui me permet de distinguer ce qui est luxueux et ce qui ne l’est pas. Néanmoins, un objet ou un meuble peut perdre en valeur, si ce dernier est usé, démodé ou si une partie de ce dernier est cassée. J’accorde également beaucoup d’importance à ce type d’informations, afin de discerner si l’usure est due au temps ou à une négligence volontaire ou involontaire, de la propriétaire de ce meuble ou de cet objet. Si un meuble ou objet possède un prix élevé, je m’intéresse tout de suite à la composition et à sa structure fournies par les détails indiqués par le notaire. J’essaye, dans la majeure partie des cas, de rattacher ce meuble ou objet à une mode, à un règne de production. Vient ensuite l’étape de la comparaison, et de la généralisation de ces différentes données afin d’aboutir à une typologie des goûts et volontés de cette femme noble. Je m’attarde alors sur l’emplacement de ce meuble ou objet, aux éléments qui l’entourent. Je compare les détails de sa composition à ceux des autres meubles qui l’entourent, afin de discerner si ce meuble fait partie d’un tout ou s’il détone. Ces différentes informations recueillies, sur chaque meuble ou objet, me permettent de connaître si cette femme noble suit les principes de mode, et de distribution harmonieuse de son siècle. Après avoir recueilli ces différents renseignements pour toutes les pièces dites d’apparat, je les rassemble et les compare, en essayant de dégager les spécificités de cette femme noble en termes de goût, et les raisons qui ont amené à ces choix.
Pour les vêtements, je me concentre surtout sur certains détails, outre le prix estimé par le notaire : la couleur des tissus, leurs matières, leurs motifs et les coupes des robes. Ces diverses informations me permettent d’accéder, de manière directe, aux goûts de ces femmes nobles, à l’image que celles-ci souhaitaient renvoyer d’elles-même. Enfin, je compare ces différents habits, aux modes de l’époque, afin de connaître l’attention que ces dernières portaient aux nouveautés et aux changements concernant l’idéal de beauté féminine.
Après avoir répertorié ces différentes informations textuelles, il m’est nécessaire de les comparer avec des sources iconographiques, afin de pouvoir appréhender « visuellement » les sensibilités de ces différentes femmes nobles. Après une détermination du style exact et l’époque de production, je recherche dans les différents ouvrages théoriques cités dans l’Inventaire des sources, des dessins les représentant. En regroupant des gravures des différents meubles présents dans une pièce ou des habits possédés par la femme noble, il m’est possible de comprendre leurs goûts, leurs choix, leurs ambitions et d’accéder, d’une certaine manière, à leurs vies.
Enfin, la généralisation des données et la comparaison des goûts entre les femmes nobles, sont une étape importante. En effet, elles me permettent de créer un « modèle-type » de sensibilités et, ainsi, de repérer l’inadéquation ou, au contraire, la participation, d’une femme noble à la norme admise.
Le plan de mon mémoire s’élabore en suivant le processus de construction d’une identité. De la formation aux questionnements sur la « programmation » d’une sensibilité, le plan de mon mémoire traite des différents aspects de l’établissement de cette conscience collective.
La première partie « Une identité construite : l’élaboration d’un groupe spécifique, les femmes nobles » s’attache à traiter des fondements de cette identité. Rivalités internes, tensions face à l’altérité, et retour en importance des femmes forment le socle de ce groupe spécifique.
La deuxième partie « Être une femme noble : une identité restrictive qui évolue et s’ouvre progressivement » met en perspective cette ouverture d’esprit des femmes nobles, avec une volonté de rompre avec le passé. A lieu un dépassement des règles qui « figeaient » les femmes nobles. Cela engendre une véritable évolution de la demeure, et de l’apparence de ces dernières.
La troisième partie « Une identité multiple, les différentes facettes de la femme noble » souligne les résultats de cette identité, et les réactions multiples à celle-ci. L’adaptation, le rejet, les nouvelles possibilités offertes à la femme noble sont au cœur de cette troisième partie.
Enfin, la quatrième partie « La sensibilité des femmes nobles : une identité préprogrammée ? » s’intéresse à l’adaptation et à l’insertion des femmes nobles, dans leur époque. La mondialisation, le dépassement de goûts genrés ou encore la révolution des sensibilités ont des conséquences sur cette identité, et sur son « programme ».
Historiographie
Mon mémoire s’inscrit dans trois volets de l’historiographie : l’histoire de la culture matérielle, l’histoire des femmes et du genre et l’histoire des sensibilités.
L’histoire de la culture matérielle est centrale pour mon mémoire. Prenant comme objets d’étude les meubles et les vêtements d’apparat, mon sujet entre parfaitement dans la continuité de l’histoire de la culture matérielle. Néanmoins, il y apporte une certaine revisite, en ne s’intéressant qu’à une simple catégorie d’objet, et à un genre unique de détenteur de meubles et de vêtements.
Apparu dans les années 1960-1970, ce volet de l’historiographie intègre les objets, dans leur matérialité, dans l’analyse historique. Elle s’intéresse tant à la possession d’objets, qu’à la société de consommation dans laquelle ils s’inscrivent, ainsi qu’aux techniques et à la sphère de production. Cette tradition d’étude des objets remonte à Viollet-le-Duc et à son intérêt pour le mobilier, compilé dans un dictionnaire le répertoriant. Fernand Braudel a affirmé la nécessité d’étude de la culture matérielle dans le discours historique, notamment dans ses enquêtes qui ont précédé l’écriture de sa Civilisation matérielle et capitalisme. Cet élan moderniste vers le mobilier s’est poursuivi avec Daniel Roche, dans les années 1980-1990, mais connaît un essoufflement depuis une dizaine d’années.
Le deuxième volet historiographique, essentiel à mon mémoire, concerne l’histoire des femmes et du genre. En effet, en ne m’intéressant qu’aux femmes et en étudiant leurs sensibilités, mon sujet contribue à valoriser ces « personnes de l’ombre », au détriment d’une histoire où le masculin est au centre. Mon mémoire s’inscrit dans une lacune dans l’histoire des femmes, celle de la noblesse au féminin.
L’histoire des femmes est apparue dans les années 1970, en lien avec l’apogée des luttes féministes. Elle s’inscrit contre une histoire favorisant les hommes, et donnant une place de « sujettes » aux femmes. L’histoire du genre, menée par Joan Scott et Françoise Thébaud, s’attache, quant à elle, à montrer l’impact particulier que les événements historiques ont eu sur les femmes. Elle souligne, également, les différences sexuelles, qui ont parcouru les siècles, et ont fomenté une relation de supériorité favorable aux hommes. L’histoire des femmes, en France, s’est établie grâce à Michelle Perrot, et son colloque de 1973 à Paris VII – Jussieu ayant pour sujet « Les femmes ont-elles une histoire ? ». A suivi un autre colloque en 1983, à Saint-Maximin, sur le thème « Une histoire des femmes est-elle possible ? », pour aboutir à un colloque en 1988 sur « Une
18
IV- Sources utilisées
Dans mon étude des sensibilités nobles, j’utilise deux grandes catégories de sources : les sources notariales et des sources iconographiques, sous forme de planches.
Dans la catégorie des sources notariales, les inventaires après décès forment la source essentielle et majoritaire de mon mémoire. En effet, j’utilise dix inventaires après décès séparés (au nombre de six en termes de reliure), relatant les possessions de cinq femmes nobles. Nécessaires à mon mémoire, ils me permettent d’appréhender la consommation, la possession, mais surtout la sensibilité de ces femmes nobles. Ils sont une source déterminante pour cerner l’environnement de vie d’une personne. Leurs précisions, leurs descriptions et la quasi-exhaustivité dont ils font preuve, en font la source première de mon mémoire. J’ai choisi d’étudier un échantillon de cinq femmes nobles, de situations diverses, tant géographiques que financières, afin d’embrasser le plus large panel de sensibilités. En les comparant, il m’est alors possible d’établir les fondements et l’évolution de l’identité féminine nobiliaire.
Toutefois, les inventaires après décès présentent souvent des lacunes, notamment la garde-robe de la femme noble concernée. En effet, certains vêtements sont distribués avant la prisée du notaire, et les vêtements portés par la femme noble, pour son enterrement, sont exclus.
Les contrats de mariage (au nombre de deux) me sont également utiles pour les informations qu’ils fournissent, concernant l’épouse. Étant établi pour protéger les droits de chaque époux, le contrat de mariage fournit un inventaire des biens apportés par les deux mariés. Cela me permet d’appréhender ce que possédait la femme noble, avant son mariage, son héritage familial, et d’une certaine manière, son histoire de vie.
Les dernières sources, présentes dans la catégorie des documents notariés, sont les ventes après décès et les séparations de biens. Elles sont porteuses de nombreuses informations, quant aux biens possédés par les hommes, et la volonté de ces femmes de les acquérir ou non. Elles me permettent de « catégoriser » les différents meubles.
Autre source présente dans les Archives Départementales, les états civils m’offrent beaucoup de renseignements sur l’âge des femmes nobles et leurs situations familiales. Ils dévoilent une partie de leurs histoires.
Les plans d’intendance, du cadastre napoléonien, ainsi que le plan du château de Saint-Cyr-la-Rivière me sont également très utiles pour situer les demeures de ces
20
femmes nobles. Ils me permettent d’évaluer la taille de leurs habitations, mais également leurs liens à l’urbanité, ou au contraire, l’éloignement de la ville.
La deuxième catégorie de sources, qui me permettent de donner du relief aux inventaires après décès et contrats de mariage, concerne les planches des sources imprimées.
Le tome II de l’ouvrage de Jacques-François Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général, outre l’aspect théorique présent dans le traité, me fournit de nombreuses planches essentielles à mon mémoire. Elles pallient à une lacune des inventaires après décès, l’architecture et la distribution des meubles dans les pièces. Elles mettent en évidence les grands principes réglant la distribution, et l’ornementation, et permettent d’appréhender la possible adaptation des femmes à ces ceux-ci.
Les planches de l’Encyclopédie me fournissent une grande quantité d’informations sur la structure des meubles, des parties qui les composent. Elles mettent en valeur la structure « vide » du meuble, dépourvue de parure ou garniture. Ainsi, il m’est possible de « visualiser » les évolutions d’ébénisterie ou de menuiserie, qui ont traversé le siècle. Elles permettent de comprendre la variété de meubles, peuplant les demeures nobiliaires.
Enfin, les différentes planches de l’ouvrage de Nicolas Dupin de la Galerie des modes et costumes français m’aident, autant que les planches précédentes, à « visualiser » et à comprendre l’évolution des modes vestimentaires et de la composition des habits féminins.