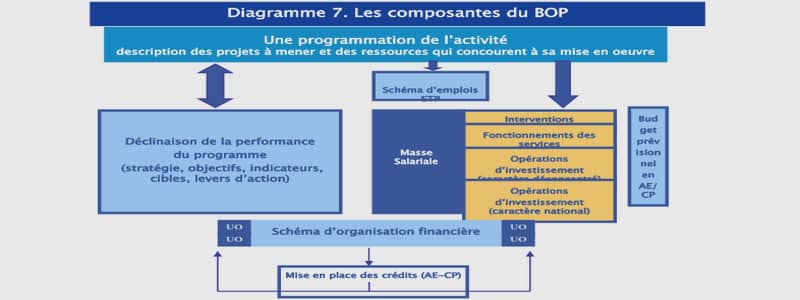Allongement compensatoire
Dans le procédé morphologique de suffixation des marqueurs d’accusatif et de topique on observe des changements phonologiques affectant les segments, mais laissant intact le nombre de mores. Par exemple, les mots nissant par /Ci/ subissent un allongement de leur voyelle nale quand ils sont au cas accusatif, qui apparaît comme un marqueur /u/ après la plupart des noms (tab. 3.13).
La syllabe est un objet linguistique qui n’a cessé de poser problème aux pho-néticiens comme aux phonologues. S’il est difficile de trouver des preuves pho-nétiques de l’existence de syllabes, ce qui pousse certains phonéticiens à nier la validité de la syllabe (Ohala & Kawasaki-Fukumori 1997), il n’en reste pas moins que le recours à la syllabe dans la description phonologique des langues permet souvent de rendre compte d’une manière simple et uni ée de nombreux phéno-mènes.
Il a toutefois été proposé que certaines langues ne possédaient pas de syllabes phonologiques. C’est le cas par exemple du gokana (Hyman 1985), ou, plus récem-ment, du japonais (Labrune 2006). Il faut rappeler qu’il est impossible de démon-trer une inexistence, et qu’en fait les hypothèses citées se limitent à démontrer que dans ces langues la syllabe n’est pas une unité pertinente car l’ensemble des faits est explicable sans recourir à la syllabe, la more jouant le plus souvent le rôle d’unité pivot. La question de savoir si la syllabe est oui ou non une unité phonologique pertinente dans le dialecte d’Ōgami n’est donc pas anodine et mérite d’être posée. Les arguments classiques (Hyman 1990 : 176, cité par Blevins 1995 : 233) pour poser l’existence de syllabes dans une langue concernent l’existence de :
i. règles d’assignation de traits prosodiques à des syllabes ;
ii. contraintes de distribution des segments en vertu de la structure syllabique ;
iii. règles phonologiques conditionnées par la structure syllabique ;
iv. règles morphologiques conditionnées par la structure syllabique ;
v. règles phonologiques ou morphologiques comptant les syllabes. L’absence d’un système tonal ou accentuel (cf. § 3.2.4) nous contraint d’emblée abandonner le premier critère, mais il est possible de trouver d’autres arguments pour démontrer la validité de la syllabe comme unité phonologique.
Unités suprasegmentales
Distribution des segments dans la syllabe : certaines restrictions distribution-nelles ne font sens que si l’on recourt à la syllabe. En effet, les momentanées ont une distribution restreinte qui ne se laisse décrire qu’en termes de structure syl-labique : elles ne peuvent se trouver qu’en position d’attaque, jamais en position de coda, ni de noyau.
Règles phonologiques : la variation observée en n de mot entre /s/ et /ɯ/ (§ 3.4, p. 111) est limitée aux cas où /s/ est en position de noyau syllabique et est précédé d’une attaque, une condition qui ne peut s’énoncer qu’en termes de structure syllabique.
Règles morphophonologiques : la forme des marqueurs d’accusatif et de to-pique dépend de la structure syllabique de la base à laquelle ceux-ci se cliticisent, et une attaque /i/ épenthétique est insérée après un noyau syllabique complexe comportant plusieurs voyelles, mais pas après un noyau vocalique simple ou une suite de voyelles hétérosyllabiques. Un traitement plus détaillé de ce phénomène sera donné en § 3.2.2.1.
Règles comptant les syllabes : il existe une règle optionnelle d’insertion d’un vocoïde voisé après une consonne sourde nale devant une pause (§ 3.2.3.4, p. 105), or cette règle est obligatoire dans le cas de mots comme /ksks/ « mois, écou-ter » , mais pas dans le cas de mots tels que /kss/ « sein, hameçon » , alors qu’ils sont tous les deux bimoriques. Il est possible d’attribuer cette différence de com-portement au nombre de syllabes : /ksks/ est dissyllabique tandis que /kss/ est monosyllabique. On peut formuler ainsi la contrainte suivante : un mot se termi-nant par une suite de syllabes dont le noyau est une fricative sourde subit toujours l’insertion d’un vocoïde devant une pause.
Suites de voyelles
Les suites de deux voyelles suivantes attestées sont données dans la table 3.14.⁹
Le statut de /ia/ et /iu/ est, comme on l’a vu, particulier (3.1.3.1), et on peut se poser la question suivante : dans les séquences /iɑ/ et /iu/, quel est le statut de /i/ ? Il est possible d’apporter plusieurs arguments qui montrent qu’il ne s’agit pas d’un noyau complexe ou de deux noyaux, mais que /i/ occupe une position d’attaque.
En effet, alors que les autres suites de voyelles peuvent apparaître précédées d’une consonne, une suite /iɑ/ ou /iu/ ne peut jamais suivre une consonne :
Le statut d’attaque de /i/ dans ces suites implique qu’il ne porte pas de more. Ceci explique l’absence de mots de forme ✗/iu/ ou ✗/iɑ/ : une suite /iu/ ou /iɑ/ est constituée d’une seule more, et ne suffit pas à satisfaire la contrainte de mini-malité (3.2.1.1).
Toutes les suites de voyelles n’ont pas la même structure, puisque, selon la nale du radical, le marqueur de topique apparaît comme /ɑ/, qui peut fusionner avec la voyelle du radical, ou bien comme /iɑ/ (tab. 3.15).
Il y a donc clairement deux groupes : les brèves, /ɯu/ et /ɯɑ/ d’un côté, les longues, /ɑi/, /ɑu/ et /ui/ de l’autre. Les nales de type /Vɯ/ n’ont pas été prises en compte car une séquence ✗/ɯi/ est de toute façon impossible, et aucune diffé-rence ne peut se manifester. La différence de comportement constatée peut s’ex-pliquer par une différence de structure syllabique : les voyelles longues et les sé-quences /ɑi/ et /ɑu/ sont tautosyllabiques et constituent des noyaux complexes, tandis que /ɯu/ et /ɯɑ/ forment des noyaux de deux syllabes différentes.
Problèmes de syllabation
Certaines suites de voyelles et de consonnes posent des problèmes de syllaba-tion : Il est peu probable que l’on doive voir là des syllabes hyper-lourdes composées de quatre ou cinq mores. Ces suites embarassantes doivent certainement être ré-parties en plusieurs syllabes, mais il n’y a aucun indice permettant de déterminer la syllabation.
Un autre problème concerne le statut des fricatives sourdes. Il n’existe en effet aucun argument phonologique indiquant si une fricative sourde placée après une voyelle en n de mot ou devant une consonne occupe une position de coda ou bien forme le noyau d’une syllabe indépendante. Les deux interprétations sont en effet compatibles avec le statut morique de ces fricatives.