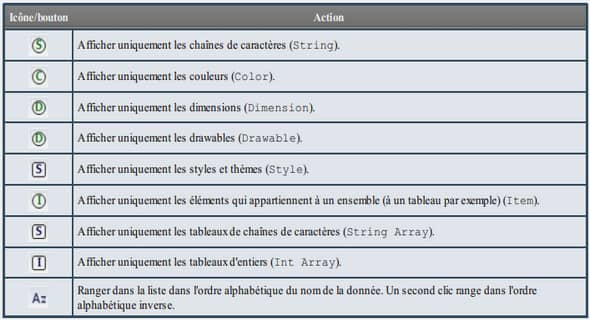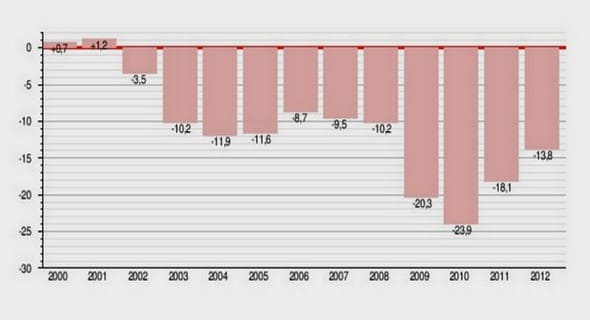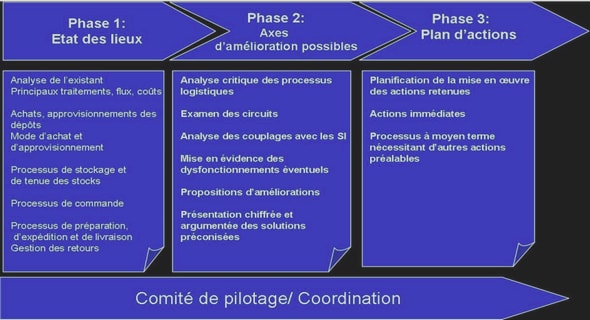Transformations : l’urbanisme du jeu
Concentrés sur les quartiers du ZAPE et du NAPE6, situés au Sud-est de la péninsule, les casinos et complexes hôteliers forcent davantage leur entrée dans la ville, qui cède alors au développement de nouvelles formes architectoniques. Ici, la cohabitation de casinos anciens et nouveaux révèle l’enchevêtrement des différentes phases qu’a connues le secteur du jeu. Aménagée autour de bâtiments résidentiels, d’espaces de travail, d’endroits qui hébergent des pratiques de la vie quotidienne, la topographie des casinos signale aussi l’ordre matériel et symbolique dans lequel s’inscrit l’imaginaire, la mémoire, l’identification, et le vécu urbain des résidants. Ensuite, le nouvel essor de l’activité gagne d’autres terrains, à travers le développement de projets qui progressent maintenant, inspirés du modèle du côté américain du Pacifique. À l’écart de la vie et de l’espace de vie quotidien des résidants, le Cotai Strip, bâti sur une bande de terre de 5,8 Km2 qui unit Coloane et Taipa7, est une zone exclusivement consacrée à l’activité, éloignée de toute vie citadine, dans un endroit jusqu’alors inhabité. Si les casinos situés sur la péninsule apparaissent comme des villes dans la ville, le Cotai Strip constitue, lui, une île du jeu dans les îles.
Pour mes informateurs, l’univers du jeu est intrinsèque à l’identité de Macau. Légalisée depuis 1849 par l’administration portugaise8, l’activité traverse et résiste à la succession des périodes économiques et politiques. Omniprésente, elle s’inscrit dans la mémoire des générations, en même temps qu’elle participe de l’expérience contemporaine des résidants, non seulement à travers l’urbanisme du jeu, mais aussi à travers la politique économique du jeu. D’une part, l’impact des casinos est ressenti plus fortement sur les centres d’activité, là où la densité humaine est la plus importante, c’est-à-dire la péninsule. L’éclairage, le trafic, le flux continu de personnes, l’insécurité, sont autant de problématiques auxquelles les résidants du ZAPE sont quotidiennement confrontés. En même temps, dans l’Ouest de la ville, où le jeu ne s’est pas implanté avec autant de force, le paysage et l’atmosphère renvoient plutôt à une Macau impassible à l’ébullition du secteur. De l’autre, l’impact indirect de la politique de libéralisation se répercute plus largement, s’étendant à d’autres arrondissements de la ville. Ainsi, au Nord, dans la zone de l’ancien « bazar chinois », où il subsiste encore des commerces et des services traditionnels, des quartiers densément peuplés témoignent de l’effet des nouvelles migrations, et des pressions exercées par la politique du jeu.
En introduisant à certains aspects de la « topographie » de la ville à travers le jeu, je souhaite ici souligner l’omnipotence d’un phénomène qui est devenu prégnant dans la vie de la ville et de ses résidants. Je défends ainsi l’idée qu’afin de mieux saisir Macau dans sa totalité et sa complexité, il est important de comprendre la morphologie de cet espace. Il est donc question de visualiser, de procurer la possibilité d’imaginer l’endroit étudié. Tel que l’argumente Henri Lefebvre, saisir la ville dans sa totalité requiert un effort d’abstraction du concret9. Par ailleurs, cela nous permet d’envisager l’étude de la vie, de la société urbaine, c’est-à-dire de l’aspect « urbain », qui ne peut donc pas « se passer d’une base pratico-sensible, d’une morphologie », renvoyant, ici, à une réalité
présente, immédiate,… architecturale »10, mais aussi territoriale. Chemin faisant, il sera question d’évoluer vers l’étude d’une autre morphologie de la ville, à savoir celle de la réalité sociale et de la diversité, susceptible de révéler le locus des échanges, des rapports et disjonctions interethniques.
Personnes
Parmi ceux qui passent, il n’y en a qui restent. C’est là un des intérêts de cette thèse. Les migrations, les mouvements et la mobilité11 font l’objet de questionnements dans cette étude tout comme leurs impacts, qui trouvent, ici, à se manifester dans l’installation de personnes à Macau, la résidence dans la ville. « Cities are hence as much spaces of flows as they are spaces of place »12. Qui sont donc les résidants de Macau ? Il y a deux manières, à la fois distinctes et complémentaires, de répondre à cette question. Si l’on opte pour la première acception, on mobilise une perspective historique13 qui consiste, d’abord, à situer la reproduction de deux populations centrales dans la trajectoire de Macau : les Portugais et les Chinois. Ensuite, elle retrace la production d’une troisième population, eurasienne, dont l’apparition, plus tardive, n’en fut pas moins déterminante dans la formation de l’identité de la ville : les Macanais14, catégorie ethnique moderne, représentée à partir de l’installation de l’administration portugaise, au XIXème siècle. Quant à la seconde acception, contemporaine, de la catégorie de résidants, elle est définie grâce, et en opposition à l’existence d’autres, acteurs et populations, « étrangers » à la ville, qui comprennent en particulier les nouveaux immigrés, toutes origines et nationalités confondues.
Si, ici, je souligne le choix qui est le mien d’adopter la notion de catégorie, et non celle de groupe, c’est pour prévenir toute « substantialisation » des phénomènes sociaux et culturels observés15, étant donné qu’ils émergent et se reproduisent dans la relation, les échanges, et les processus. Ainsi, les résidants, en tant que catégorie, s’édifient-ils à travers la combinaison de critères qui se rassemblent, globalement, dans deux sphères : l’une matérielle, celle de droit, l’autre subjective, celle de volonté de droit. Dans la première, on regroupe des critères objectifs, tels l’origine et la naissance, et la possession de documents d’identification spécifiques à Macau : le BIR, le statut de résidant permanent et non-permanent de la RAS, le passeport de la RAS, etc. Dans la deuxième, les critères sont moins précis, marqués par le ressenti et l’expérience collective, qui se négocient entre l’auto-identification et la reconnaissance de l’autre. De fait, l’identification et l’appartenance à Macau renvoient aussi bien aux critères de la résidence qu’à celui de l’origine. Des zones grises, des nuances, abondent, cependant et d’abord, à travers l’éventail des documents délivrés par la RAS de Macau, ainsi que par le Portugal et par la RPC. Ces zones sont, ensuite, autant de réponses aux fluctuations ‘identitaires’ qui se manifestent en fonction de l’origine ethnique. Elles se réfèrent, enfin, au fait que la majorité de la population de Macau est née à l’étranger. Qu’est-ce que, pourtant, que le résidant de la grande ville, sinon un étranger lui-même16 ?
Ce sont des étrangers parmi des étrangers qui font marcher la vie urbaine », écrivait déjà ,Zygmunt Bauman17.
Des difficultés à rapporter les « résidants » à une catégorie univoque, nous conduisent, par conséquent, à employer différents termes, entre autres, celui de résidant lui-même, et celui d’habitant. Le résidant de Macau peut donc être Chinois, Portugais ou Macanais. Je souligne ainsi mon choix de privilégier l’emploi de ces termes, au lieu de celui d’autochtone, afin de marquer le caractère quelque peu relatif, impermanent, de l’appartenance à Macau. Néanmoins, on veille à ce que leur emploi soit en mesure de signaler les différences que l’on vient précisément de rappeler. De surcroît, dans aucun des cas envisagés, les « résidants » ne sont pas de ou dans la ville, mais sont toujours des acteurs qui éprouvent des degrés divers d’appartenance et d’identification à Macau. En somme, il s’agit de personnes, rencontrées et interrogées pendant l’enquête, qui entretiennent des liens spécifiques, affectifs, temporels, matériels ou pas, avec l’endroit habité, et qui évoquent l’identification et l’élection de cet endroit comme lieu de vie.