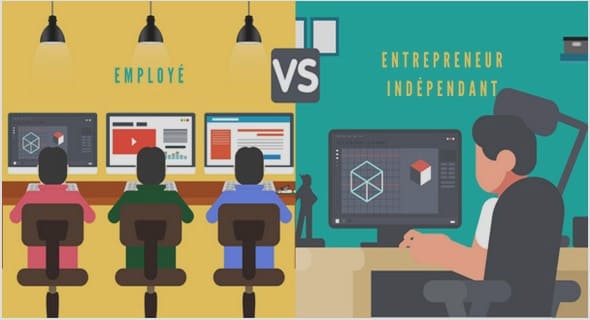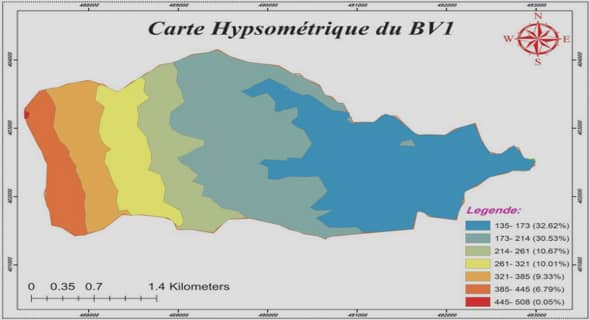Un statut incertain et une légitimité fragile
Donner aux jeunes gens qui se destinent au commerce avant leur entrée dans la pratique des affaires, l’ensemble des connaissances indispensables à tout commerçant se livrant à des opérations d’une certaine étendue, et contribuer ainsi à former des employés, des négociants et administrateurs capables, non seulement de bien diriger le commerce national, mais encore de développer les relations de leur pays avec les pays étrangers » 1. C’est ainsi qu’en 1874 le directeur de l’École supérieure de commerce de Bordeaux définit le but des écoles supérieures de commerce qui se multiplient alors sur le territoire français. Si les promoteurs de ce nouveau type d’établissements, essentiellement issu de la sphère économique, y voient une entreprise utile, ceux-ci ne rencontrent pourtant pas le succès escompté, tant l’idée que la pratique commerciale ne nécessite pas de formation spécifique est répandue. Au début des années 1890, ces écoles se font reconnaître par l’État, ce qui améliore leur légitimité scolaire et sociale. Néanmoins, la plupart connaissent des difficultés de recrutement persistantes, et leur positionnement dans le système scolaire demeure ambigu2.
Une naissance sous les auspices des négociants
Que ce soit dans les entretiens, dans des présentations publiques ou dans des ouvrages écrits par des historiens « maison », le roman des origines des écoles de commerce étudiées met toujours en évidence l’impulsion des milieux économiques lors de leur création, ce qui du même geste légitime leur existence comme réponse à une demande des entreprises, et dessine un lien organique de filiation avec ces dernières.
Le rôle des milieux économiques dans la création des écoles supérieures de commerce françaises est effectivement prépondérant et l’émergence de ces écoles est de toute évidence liée aux transformations que connaît alors l’économie française : essor de nouvelles industries, percée des grands magasins ou réorganisation du secteur bancaire ou encore l’avènement du libre-échange en matière de commerce international3. Néanmoins, d’autres facteurs sont à prendre en compte, comme le contexte géopolitique et l’action de quelques entrepreneurs éducatifs, désireux d’améliorer la puissance commerciale française grâce à ces nouvelles formations. En outre, il importe de distinguer le moment de la fondation et les années qui suivent au cours desquelles le décalage entre les idéaux des fondateurs et les attentes réelles des milieux négociants en matière de formation devient visible.
De fait, la question des usages sociaux de ces formations doit aussi être considérée.
Le roman des origines des ESC
La naissance sous les auspices des milieux économiques, en réponse à une demande de ces derniers, apparaît comme partie intégrante de la mythologie des écoles de commerce, et constitue un passage obligé dans la (re)présentation qu’elles donnent d’elles-mêmes, qu’il s’agisse de supports plus ou moins formalisés, comme des articles de presse ou des entretiens.
Ainsi, en 2011, à l’occasion des 140 ans de l’EM Normandie (ex-ESC Le Havre), un article paru dans le Journal des grandes écoles et présentant l’établissement rappelle que « l’école, créée en 1871, répondait à une demande des négociants du Havre en matière de formation au commerce international » 4 . Andrès Atenza, directeur de l’ESC Clermont déclare en 2006 au magazine Challenges : « nous sommes l’émanation des entreprises, puisqu’elles nous ont créées au travers des chambres de commerce et d’industrie »5. De la même façon, la naissance de l’ESC Dijon est présentée dans un ouvrage consacré à l’histoire de cette école et rédigé par un de ses enseignants comme une réponse « aux besoins du négoce en vins et de l’industrie locale »6 . Enfin, l’histoire glorieuse de la naissance de ces écoles m’a été répétée en guise de préambule, lors de nombreux entretiens, comme par cet ancien directeur d’une école parisienne : « Ces écoles ne sont pas nées par hasard, c’était l’époque où tous les grands magasins se faisaient dans Paris, la Société générale, le Crédit Lyonnais… Il fallait former des gens pour intégrer ce nouveau développement de l’économie. Il n’y a pas de création d’école qui soit le fruit du hasard. C’était pour répondre à une demande qui n’était pas satisfaite » (adir E11).
On pourrait multiplier les exemples de ce genre, qui témoignent d’une volonté d’affirmer l’utilité de ces écoles pour les milieux économiques et de valoriser les liens « organiques » qui les uniraient à ces derniers.
Dans sa thèse consacrée aux origines de l’enseignement commercial en France, l’historien Philippe Maffre7 fait remonter au lendemain de la Révolution française les premières formations au commerce, dont il associe la naissance au développement d’une bourgeoise industrielle et commerçante. Auparavant, l’éducation des enfants de négociants destinés à reprendre les affaires familiales était essentiellement assurée dans des pensionnats ou des collèges privés, dans lesquels ils pouvaient apprendre à bien écrire, savoir l’arithmétique et les langues mais aussi s’initier à des activités telles que la musique et le dessin pour devenir des « hommes du monde accomplis », tout en évitant de s’encombrer d’une formation aux humanités classiques, jugées au mieux inutiles, au pire « nuisibles »8.
La plupart des cours et des écoles portant spécifiquement sur le commerce créés à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle n’ont néanmoins qu’une durée de vie éphémère, ce qui montre que les évolutions économiques et sociales ne se traduisent pas mécaniquement dans une transformation du système éducatif. De fait, si les professions associées au commerce se développent et si la bourgeoisie d’affaire devient de plus en plus importante, la plupart de ses membres considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’acquérir un enseignement spécifique pour envisager une carrière commerciale9.
Une seule école ouverte au début du XIXe siècle perdure : l’École spéciale de commerce et d’industrie, créée à Paris en 1819 et qui deviendra l’École supérieure de commerce de Paris (ESCP). Comme la plupart des écoles de commerce créées par la suite, cet établissement est né d’une initiative privée, celle de deux négociants, A. Brodart et M. Legret, avec l’aide de V. Roux, négociant et juriste lyonnais, membre de la Chambre de commerce de Paris qui avait en 1800 publié un ouvrage préconisant la création de « gymnases de commerce » pour former les commis de maison de négoce10. Les débuts de l’école parisienne sont difficiles et en dépit d’une embellie dans les années 1840-1850 et de sa reconnaissance par l’État en 1852, elle éprouve des difficultés à recruter et à équilibrer son budget. La Chambre de commerce de Paris en fait finalement l’acquisition en 186911. L’enseignement commercial supérieur français se dessine donc sous un double parrainage, consulaire et étatique12.
L’enseignement commercial connaît ensuite une première vague de développement dans les années 1870. Celle-ci n’est pas tant liée à des transformations économiques qu’à la défaite de la France face à l’ancienne Prusse, qui suscite chez certaines élites politiques et économiques tout un discours sur le retard français en matière d’enseignement, et notamment d’enseignement technique13. Cependant, plus que l’ESCP, c’est une école située à Mulhouse14 qui va alors servir de modèle aux écoles de commerce qui se créent : l’École supérieure de commerce de Mulhouse, fondée en 1866 sous l’impulsion de Jacques et Jules Siegfried, deux frères membres de la bourgeoisie alsacienne et protestante (cf. encadré 1.2). La défaite de 1870 conduisant à sa fermeture, des enseignants de cette école vont être recrutés dans les écoles supérieures de commerce qui se créent à Rouen en 1871, Lyon et Marseille en 1872, bordeaux en 187415, contribuant ainsi à diffuser un même modèle d’enseignement commercial, fondé avant tout sur la pratique. Notons que si les chambres de commerce offrent généralement leur patronage à ces nouveaux établissements, le rôle des municipalités et des élites locales est également central16.
Les frères Siegfried, « pères fondateurs » de l’enseignement commercial en France
Jacques (1840-1909) et Jules (1837-1922) Siegfried ne furent pas seulement parmi les individus les plus actifs dans la promotion des d’écoles supérieures de commerce en France, ils en incarnent aussi un certain idéal-type, cumulant toute une série de traits que l’on retrouve chez d’autres entrepreneurs de l’enseignement commercial : libéralisme, protestantisme, défense d’une culture pratique, investissement dans la sphère économique.
Nés à Mulhouse, ils appartiennent à une « fraction montante de la bourgeoisie commerciale »17. Leur père, d’abord commissionnaire en coton, devient représentant d’une maison de négoce. Jules interrompt tôt ses études pour assister son père, et lorsque Jacques termine ses études secondaires, ils fondent en 1861 une société spécialisée dans le commerce du coton. Jacques Siegfried entreprend alors de nombreux voyages et ouvre un comptoir à Bombay. Le succès de leur entreprise leur assure très tôt une importante fortune.
Les deux frères vont jouer un rôle extrêmement important dans le développement des écoles supérieures de commerce en France. En 1866, ils ouvrent l’École supérieure de commerce de Mulhouse. Soucieux d’offrir un enseignement « aussi pratique que possible »18, à des jeunes gens de tous milieux, ils critiquent les cours trop théoriques de l’ESCP et préfèrent s’inspirer de l’école d’Anvers. En effet, cette dernière a mis en place un système de « bureau commercial », qui met les élèves dans la situation réelle d’échanges internationaux : ils doivent réaliser des calculs de change, tenir des livres de compte, le tout en anglais. Le système est repris à Mulhouse, où la formation sur deux années comprend également des cours en géographie commerciale, en droit et en économie politique19.
Mais l’influence des deux frères va bien au-delà de Mulhouse, puisque leur ambition est de favoriser le développement de l’enseignement commercial sur l’ensemble du territoire. Comme l’écrit en 1870 Jacques Siegfried dans un ouvrage destiné à promouvoir cette idée : « Pour maintenir notre patrie au rang qui lui est dû, la première chose à faire, et la plus importante, me paraît sinon une réforme complète, du moins des changements considérables dans notre enseignement. (…) Nous ne formons pas assez de gens pratiques20. (…) On dirait que chez nous on en est encore à penser que le commerce est si peu de chose qu’il n’est besoin d’y préparer personne et qu’il suffira toujours des fruits secs des autres professions. L’expérience des dernières années et le rang qu’ont pris dans le monde les nations où il est le plus en honneur, devraient cependant finir par modifier ces idées d’autrefois et par faire comprendre qu’au contraire c’est surtout dans les affaires que les hommes instruits et capables trouvent aujourd’hui l’emploi le plus fécond de leurs facultés ».21
Les nombreux voyages de Jacques Siegfried l’ont convaincu de la faiblesse de la position commerciale de la France à l’étranger, et de la nécessité de donner une formation internationale aux jeunes gens. En outre, il a pu visiter des écoles en Belgique, en Allemagne mais aussi en Italie et aux
États-Unis. Il en appelle ainsi à créer : « dans [les] villes principales des Écoles supérieures de commerce » 22.
La fermeture de l’école de Mulhouse en 1872 et la dispersion de ses enseignants sur l’ensemble du territoire français contribuent à l’essor de l’enseignement commercial souhaité par Jacques Siegfried. De plus, son frère Jules qui s’est lancé dans une carrière politique est élu maire du Havre en 1871. Cette même année, sous le patronage de la Chambre de commerce de la ville, les deux frères y ouvrent alors une École supérieure de commerce23. Elu député de la Seine inférieure en 1886, Jules Siegfried jouera également un rôle important au cours des discussions sur la loi de 1889, obtenant pour les diplômés des écoles supérieures de commerce les mêmes avantages que ceux des diplômés des écoles de l’État24.
En parallèle, Jacques Siegfried poursuit son œuvre dans le domaine éducatif. Il contribue à la création de l’École libre des sciences politiques en 1872, auprès d’Emile Boutmy, école dont les deux frères Siegfried seront actionnaires25. Membre du Conseil supérieur de l’Enseignement technique, Jacques Siegfried participe également à des commissions sur l’enseignement commercial et la Chambre de commerce de Paris recourt à ses services pour le projet de création d’HEC26.
En 1892, Jacques Siegfried décide de créer l’Union des associations d’anciens élèves des écoles supérieures de commerce, un groupement formé de délégués de ces associations, pour s’occuper de leurs intérêts communs. Il le présidera jusqu’à sa mort. Ce groupement va constituer une force très importante pour la défense des ESC, en prenant part à tous les travaux et réunions destinés au développement de l’enseignement commercial. Ainsi en 1900, l’Union participe à l’organisation du premier congrès des associations d’anciens élèves des écoles supérieures de commerce à Paris. Elle assiste également à des congrès internationaux sur l’enseignement technique, à Liège en 1905, Milan en 1906 et Vienne en 191027. En 1913, l’Union regroupe plus de 7000 membres.