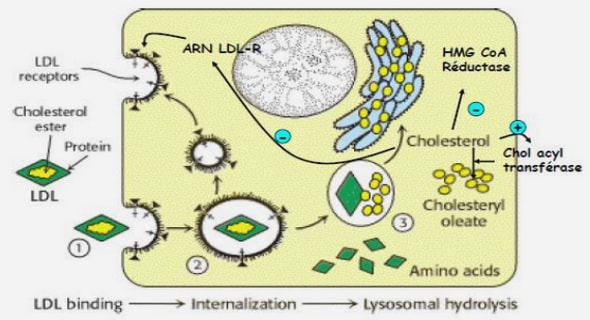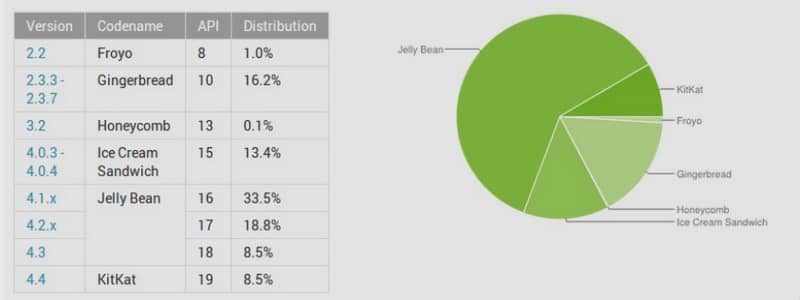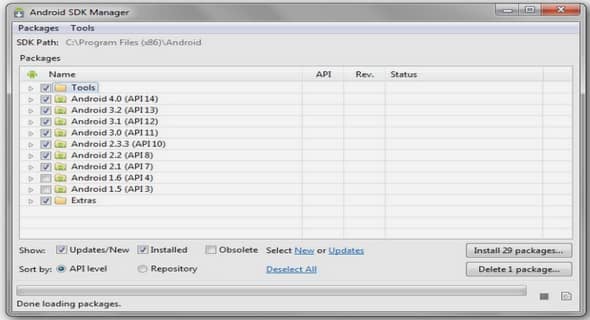Rappels sur les fosses nasales et les sinus paranasaux
Embryologie : Vers le 30ème jour de la vie intra utérine, des bourgeons mandibulaire et du maxillaire supérieur vont s’individualiser à partir d’une dépression ectoblastique de l’extrémité craniale de l’embryon : le stomedeum. Ensuite aux environs de 35ème jour, l’ectoblaste s’accole à un prolongement de la vésicule encéphale juste au dessous du stomedeum et de chaque coté de la ligne médiane pour former les placodes se développent les bourgeons nasaux externe et interne qui se fusionnent pour donner naissance aux cavités nasales.
Les fosses nasales
Les fosses nasales sont deux cavités symétriques séparées par le septum, ses orifices sont les orifices narinaire antérieurs qui sont des structures cartilagineuses délimitées par les cartilages alaires de part et d’autre et soutenues par les sous cloisons. Les choanes qui sont des orifices postérieurs des fosses nasales qui sont délimitées par les corps des sphénoïdes en haut, les lames horizontales de l’os palatin en bas, les ailes de la ptérygoïde en externe et les vomers en interne. Les fosses nasales sont des conduits avec des couloirs para-sagittaux qui sont plus hauts que large et plus longs dans leurs parties inferieurs. Le volume moyen de ces cavités est d’environ 20cm3 et la surface est d’environ170cm².
Elles se divisent d’avant en arrière en 3 parties : La partie vestibulaire qui démarre à l’origine de l’orifice narinaire et se termine au niveau de l’ostium internum.
La partie respiratoire qui occupe une grande partie des fosses nasales et qui grâce aux cornets constitue le deuxième niveau de régulation du débit aérien.
La partie olfactive située au plafond des fosses nasales, c’est une zone très petite ou se concentrent les fibres nerveuses qui donneront le nerf olfactif.
Histologie de la muqueuse naso-sinusienne
Les cavités naso-sinusiennes constituent la partie initiale des voies aériennes supérieures. L’air y pénètre par les narines tapissées de peau comportant des poils courts et épais appelés vibrisses et un épithélium malpighien non kératinisé.
La muqueuse nasale comprend : Une muqueuse olfactive (faite d’un épithélium pseudostratifié contenant des neurones sensoriels responsables de la sensibilité olfactive).
Une muqueuse respiratoire qui comprend un épithélium de surface composé d’une assise unistratifiée de cellules prismatiques ciliées de types respiratoires. En plus de ces cellules, on observe des cellules caliciformes mucipares, des cellules de remplacement, profondes, donnant un aspect pluristratifié.
Physiologie des fosses nasales et des sinus
Les fosses nasales : Elles sont différenciées en deux secteurs distincts : la partie supérieure assure l’olfaction et la partie inférieure constitue l’étage respiratoire ;
La physiologie respiratoire nasale assure trois fonctions : Le passage de l’air lors de l’inspiration ; Le conditionnement de l’air en l’humidifiant par l’évaporation de l’eau du mucus et en le réchauffant par les turbulences de l’air et la richesse du système vasculaire pituitaire. Et la filtration de l’air, participant ainsi à l’épuration et au mécanisme de défense anti-infectieux.
Les sinus : Les sinus de la face sont des expansions diverticulaires des voies respiratoires supérieures communiquant avec les fosses nasales par des ostiums.
On leur distingue au plan physiologique des fonctions extrinsèques et intrinsèques. Les fonctions extrinsèques exercent dans le complexe cranio-facial découlent des études d’anatomie comparée. Elles jouent sur plusieurs rôles : Allégement de l’ossature du crane ; Protection mécanique des structures nerveuses ; Résonateur ; Conditionnement thermo-hygrométrique de l’air inhalé. Les fonctions intrinsèques de ventilation et de drainage sont essentielles et tributaires de la perméabilité des ostiums et des caractéristiques du revêtement muqueux endosinusien.
Les types histologiques
Selon les classifications anatomopathologiques des carcinomes naso-sinusiens, on distingue : Le Carcinome épidermoïde : C’est la forme la plus commune de cancer de la cavité nasale et des sinus. Il constitue plus de 80% de tous les cancers qui surviennent dans la cavité nasale et des sinus para nasaux.
Environ 70% se produit dans le sinus maxillaire, 12% dans la cavité nasale, et le reste dans les vestibules nasals et des sinus restants.
Adénocarcinome : C’est la tumeur qui débute à partir des cellules glandulaire. L’adénocarcinome de la cavité nasale et des sinus para nasaux est historiquement importante et est associée à des facteurs de risque spécifiques, y compris l’exposition aux poussières de bois, et d’autres composés organiques.
Mélanome malin : C’est une tumeur maligne en découlant de cellules appelées mélanocytes. Le mélanome malin est une maladie rare de la cavité nasale et des sinus para nasaux. Il représente moins de 1% de tous les mélanomes malins et moins de 4% des cancers du nez.
Esthesioneuroblastoma (ENB) : Ceux qui sont associés à des nerfs qui contrôlent le sens de l’odorat. Elle est souvent appelé neuroblastome olfactif, qui est une tumeur rare, mais souvent étudiée. Elle constitue 3% de toutes les tumeurs endonasale. Sa présentation est similaire à d’autres tumeurs malignes du nez et des sinus.
Lymphome : Il s’agit d’une tumeur qui provient de la lymphe des tissus au sein de la muqueuse de la cavité nasale est des SNP. Sarcome : C’est une tumeur maligne qui commence dans les muscles, tissus conjonctif ou des os.
Carcinome indifférencié : C’est une tumeur rare de la région du nez et des sinus. Le nom est dérivé de l’absence de claire distinction des caractéristiques histologiques des cette lésion.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE
I.1.Rappels des fosses nasales et des sinus para-nasaux
I.1.1.Rappels embryologiques
I.1.2. Rappels anatomiques
I.1.3.Rappel histologique de la muqueuse naso-sinusienne
I.1.4.Rappel physiologique
I.2.Etude des carcinomes naso-sinusiens
I.2.1.Généralités
I.2.2.Les différents aspects anatomopathologiques
I.2.3.Epidémiologie
I.2.4. La classification TNM des carcinomes naso-sinusiens
I.2.5.Facteurs de risques
I.2.6.Etude clinique
I.3.Traitements
I.4.Evolution
DEUXIEME PARTIE : ETUDE PROPREMENT DITE
II.1.Matériel et méthodologie de l’étude
II.2.Les résultats
II.2.1.Etude descriptive
II.2.2.Etude analytique
TROISIEME PARTIE : DISCUSSION ET COMMENTAIRE
SUGGESTIONS
CONCLUSION
ANNEXES
REFERENCES