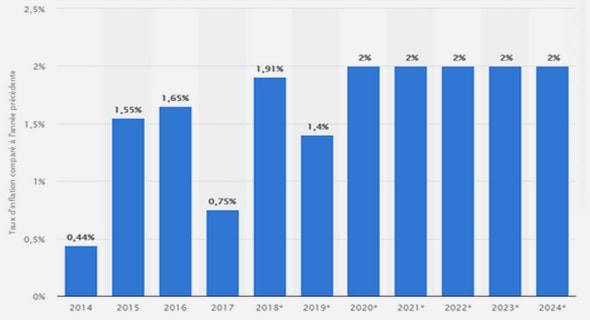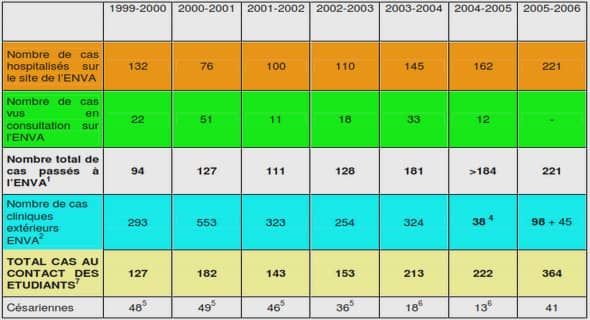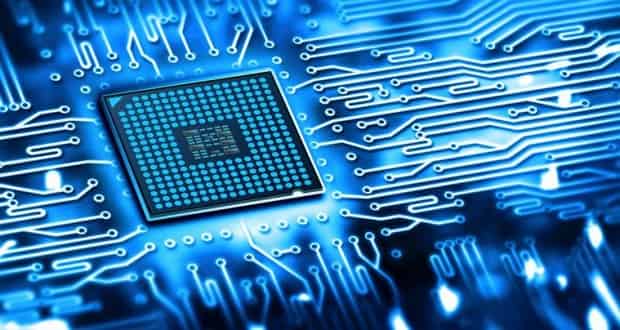Pour une ethnographie des vies académiques à l’ère actuelle
Cette recherche part du constat que malgré l’existence d’une littérature significative sur la circulation des chercheurs et des idées entre l’Inde et l’Europe, on ne serait pas en mesure de trouver un travail ethnographique consacré aux chercheurs indiens en sciences sociales en Europe. Le champ d’études est vaste et comporte un grand nombre d’ouvrages de référence qui peuvent être présentés selon leurs thématiques diverses et ancrage chronologique : l’histoire de l’Indologie, de l’Orientalisme et des études l’Inde en Europe et aux États-Unis (Inde, 1990 ; Trautmann, 1997, Lardinois, 2007), l’histoire de la coproduction des sciences entre l’Europe et l’Inde (Raj, 2007), l’histoire intellectuelle des élites indiennes envisagées du point de vue d’une histoire de la caste (Bayly, 1999), l’anthropologie historique des sciences, de la culture et de la politique (Cohn, 1996), l’histoire des rapports savants et diplomatiques entre Inde et Europe (Subrahmanyam, 2013), l’histoire des sciences sociales en Inde et leurs connexions avec l’Europe et la colonisation (Patel, 2011 ; Chaudhuri, 2010 ; Atal, 2003 ; Oommen, 2007 ; Madan, 1994, 2013 ; Uberoi, Sundar et Deshpande, 2007), les études sur l’ainsi-dite hi-skill migration qui touchent à la question des circulations intellectuelles (Chatterji et Washbrook, 2013), l’histoire de l’éducation des élites indiennes « occidentalisées » (Srivastava, 1998, MacDougall, 1999), l’histoire des area studies dans le contexte anglophone contemporain (Bénéï, 2005 ; Assayag et Bénéï, 2005), les récits-de-soi produits par des chercheurs travaillant à l’étranger (Assayag et Bénéï, 2004 ; Subrahmanyam, 2015), et les analyses théoriques informées par les expériences diasporiques de ces chercheurs (Bhabha, 1994).
On pourrait citer également un grand nombre d’articles et essais parus dans les trente dernières années, relevant d’un ton beaucoup plus dénonciateur, voire agressif, envers ces chercheurs indiens travaillant en Europe ou aux États-Unis. Jackie Assayag et Véronique Bénéï (2000) présentent un répertoire illustratif, mais loin d’être exhaustif, de ces discours hostiles qui peuvent être aussi virulents que créatifs dans leur manière d’aborder la question : une tentation élitiste de s’aménager une niche transdisciplinaire dans le système académique anglophone (Ahmad 1995 ; Robbins 1993 : chap. 5 et 6) ; une bourgeoisie compradora de style et de formation occidentaux, d’un groupe d’intellectuels qui fait la « médiation dans le commerce des marchandises culturelles du capitalisme mondial pour la périphérie » (Appiah 1992 : 149) ; une légitimation de penseurs mondialisés dans le théâtre universitaire de la « globalisation » (Friedman 1999, et infra, pp.187-206) ; un moyen de spécifier un malaise et un conflit en termes politiques quand ce n’est pas une façon de servir de caution morale à l’impérialisme américain (Dirlik 1997, chap. 3) ; une entreprise obscurantiste qui sert d’« encadrement psychique aux contre-révolutions » (Chomsky 1998) ; une revendication d’émigrés nantis prétendant parler pour les victimes sans voix attachés à la localité (Bauman 1998, chap. 4) ; une réponse à la honte éprouvée par l’élite indienne d’avoir collaboré avec le colonisateur britannique (McKim Marriott), un néo-traditionalisme antimoderne s’alimentant à une vague nostalgie pour les communautés authentiques (Sarkar 1997) ; bref, une dérive culturaliste, théoriciste, identitaire et différentialiste dans le champ des sciences sociales. (Assayag et Bénéï, 2000, p. 22-23)
De ce fait, ce travail propose une étude proprement anthropologique sur ces dynamiques contemporaines de circulation qui ont fait jusqu’à présent l’objet, dans les meilleurs cas, d’analyses historiques conséquentes comme celles mentionnées ci-dessus, et dans les cas plus anecdotiques d’accusations morales, mais jamais d’analyses anthropologiques systématiques. C’est à partir de ces constats que je propose une enquête sur les mouvements récents d’installation de chercheurs indiens en Europe. Plus précisément, il m’intéresse de raisonner sur les formes de vie de ces personnes, c’est-à-dire les récits et les vécus liés à leur choix de bâtir une vie en Europe, en mettant un accent important sur les processus plus amples (historiques, institutionnels et épistémologiques) qui à la fois produisent et sont produits par ces mobilités.
Il serait pourtant injuste de ne pas faire référence à un nombre limité de travaux qui, dans une certaine mesure, vont dans le même sens de cette thèse. Je pense notamment à l’enquête que Susan Bayly (2007) a menée à Hanoi auprès de chercheurs vietnamiens de plusieurs domaines de la science. Son livre m’a été de grande importance pour deux raisons. Tout d’abord, pour ses stratégies méthodologiques et manières possibles d’analyser anthropologiquement un milieu savant, soit à partir de récits, soit à partir de pratiques partagées. Deuxièmement, parce que son analyse sur le Vietnam est nourrie autant de son travail en histoire de l’Inde que de sa large expérience en tant que chercheuse familiarisée avec l’univers des classes éduquées indiennes. Troisièmement, ses considérations sur le rôle des « intellectuels » dans les sociétés postcoloniales relativement influencées par les valeurs socialistes ont nourri mes propres réflexions. Bien que mes approches théorique, méthodologique et mes intérêts sur le terrain soient assez différents de ceux de Bayly, je souligne que son travail a apporté une contribution importante à cette thèse.
Parmi les dissimilitudes entre nos approches, il y en a deux principales. Premièrement, le fait que je me focalise sur les sciences sociales alors que Bayly parle de l’« intelligentsia » dans plusieurs disciplines, y compris les sciences dures. Par ailleurs, sa méthode d’enquête s’appuie de manière beaucoup plus systématique sur les souvenirs familiaux – toujours en relation avec une ethnographie des appropriations contemporaines d’espaces et situations significatives à ce qu’elle appelle l’espace historique de la socialist ecumene. De mon côté, une telle anthropologie historique est moins présente dans la mesure où les souvenirs sont plus dilués comme une manière parmi d’autres de comprendre des dynamiques éminemment contemporaines de transformation des institutions, des conditions historiques et des subjectivités à l’heure actuelle.
Par ailleurs, plus qu’une enquête anthropologique des circulations académiques, le présent travail se veut une ethnographie de l’académie elle-même, ou de la vie académique. Le choix du mot vie pour évoquer la vie académique, plutôt que carrière académique, insiste sur le statut plus important que je lui attribue et souligne la démarche éminemment anthropologique de ma réflexion, qui associe au parcours professionnel des dimensions les plus constitutives de ces personnes. Je me réfère bien ici à des dimensions telles que les subjectivités, les émotions, la conjugalité, le corps, la sexualité, les conditions matérielles d’existence, les conditions institutionnelles de réalisation de ces projets et les sentiments d’appartenance. Cette enquête est fondée sur le principe selon lequel nous ne pouvons comprendre anthropologiquement ces vies académiques, si l’on omet de s’interroger sur les relations entretenues entre un contexte socio-historique, des pratiques institutionnelles et la production de subjectivités.
En ce qui concerne l’usage du terme vie comme concept anthropologique, je m’inspire en partie des travaux récents de Didier Fassin sur la vie comme objet de réflexion pour les sciences sociales, qu’il a développés dans son séminaire à l’EHESS en 2017 intitulé La vie : un objet pour les sciences sociales et qu’il a récemment publiés dans un livre intitulé La vie. Mode d’emploi critique (2018). Comme il le soutient, le mot vie est devenu une catégorie abondamment employée par les sciences sociales en même temps qu’elle a été très peu scrutée par notre discipline, à la différence de la philosophie et de la biologie. Qu’est-ce que, d’un point de vue ethnographique, la vie ? Alors qu’il est essentiel d’essayer d’interpréter à nouveaux frais ce concept, il faut également reconnaître l’impossibilité d’une définition anthropologique totale. Il ne s’agit pas non plus de prétendre à une anthropologie de la vie (comme nous pouvons penser à une anthropologie du contemporain, de la modernité ou de la religion). Il serait possible, en revanche, d’aborder la vie en tant que signifiant à travers lesquels les gens produisent du sens à leurs action et récits : par exemple, combien vaut sa propre vie quand on est impliqué dans un conflit armé, ou combien vaut la vie de l’autrui quand il est un réfugié qui risque sa vie pour rentrer en Europe ? C’est-à-dire que nous pouvons réfléchir, depuis le ponte de vue d’une anthropologie des moralités, aux discours quotidiens sur la valeur de la vie face aux crises humanitaires, les violences et les conflits armées. En termes méthodologiques, ceci implique de penser les expériences des gens comme les pièces d’un puzzle (métaphore qu’ouvre le livre quasi-homonyme de Georges Perec, La Vie mode d’emploi [1978], et dont s’inspire Fassin). La question devient alors d’utiliser les récits des vécus comme matériau pour faire émerger une conception sur les formes de vie propres au monde contemporain (formule que, à l’instar de Veena Das [2007], il reprend de Wittgenstein). De ma part, je lance les bases d’un projet plus ample de recherche sur la précarité comme l’un de ces formes de vie contemporaines. Bien que le mot vie apparaisse tout au long du texte, c’est dans le chapitre 8, consacré à la précarité académique, qu’un tel usage du mot vie gagne en force herméneutique : la précarité apparaî= t comme une forme prégnante de construction et signification de sa vie. C’est pour cette raison qu’il m’a paru important de rédiger cette précision sur l’usage que je fais du concept.
Et ceci est d’autant plus important que je m’intéresse à la vie académique – ces vies construites autour d’un projet académique – dans ses aspects ordinaires, dans ses ressentis et stratégies, mais toujours en relation avec ses aspects les plus sacralisés, comme « la théorie » et « le prestige ». Et quand je parle de l’« ordinaire », je pense surtout aux travaux de Veena Das (2007) sur les récits des femmes qui ont vécu la Partition de l’Inde à la fin des années 1940, et à sa manière d’envisager la capacité d’agir comme quelque chose qui réside dans les aspects plus quotidiens de la vie. Pour ce faire, j’oscille entre l’analyse, d’un côté, d’aspects très concrets comme la race, le genre, le corps et la caste dans la production de ce milieu et, de l’autre, des débats théoriques et épistémiques sur la postcolonialité, la diaspora et la littérature. Cela implique une « descente à l’ordinaire » où l’abstraction propre à la théorie est un élément aussi constitutif de la vie (par le biais des publications, des articles et des conférences propres au métier de chercheur) que bien d’autres.
Toutefois, les intellectuels ne vivent pas seulement d’imaginaires, de tournants épistémologiques, de politiques culturelles et de rapports historiques. Il faut relever aussi un autre aspect, beaucoup plus pragmatique, cette fois-ci cristallisé à l’intérieur des frontières indiennes.
Comme le montre le rapport coordonné par Partha Chatterjee (2002), les années 1990 sont largement considérées comme une période de déclin et de crise des sciences sociales en Inde en raison de la précarisation des conditions d’enseignement et de recherche à l’université8. Ce rapport porte sur les principales disciplines en sciences sociales dans cinq pays sud-asiatiques (Inde, Pakistan, Sri Lanka, Népal et Bangladesh), en les scrutant en termes des transformations concrètes de recherche au fil des dernières deux décennies du XXe siècle. Le constat est celui d’une diminution de ressources publiques destinées à l’enseignement et la recherche en sciences sociales, poussant les institutions à chercher des financements privés, surtout auprès des organisations et fondations transnationales, ou à développer des projets liés à l’application de politiques publiques d’intérêt de l’État.
En somme, pour la plupart des institutions et départements en sciences sociales, une période de précarité s’en est suivie, couplée avec un rétrécissement des corpus enseignants à cause de la réduction du nombre de postes durant les années 1990. Le résultat de ces politiques d’austérité au sein du système académique indien a été une diminution drastique du nombre d’étudiants intéressés par la carrière universitaire, dans la mesure où les « meilleurs étudiants » préfèrent travailler dans le secteur privé, ou même les ONGs, qui offrent des meilleurs salaires et conditions de travail. Le nombre d’étudiants en doctorat a drastiquement reculé dans cette période, même dans les plus prestigieuses institutions indiennes : entre 1990 et 2002, seuls 6 diplômes de doctorat ont été accordés au sein de la Delhi School of Economics, qui figure parmi les plus prestigieuses institutions indiennes en sciences sociales.
Un récit très répandu parmi les chercheurs consultés pour la rédaction de ce rapport est celui évoquant la perte d’étudiants et de chercheurs seniors pour les États-Unis et l’Europe. D’une part, les étudiants les plus prometteurs partent de plus en plus vers l’Europe et les États-Unis pour leur doctorat – ce qui, d’ailleurs, selon le rapport, peut-être lu comme une pratique encouragée par les départements indiens eux-mêmes, dans la mesure où leurs enseignants ont souvent un doctorat « occidental » et donc le message envoyé était qu’il vaudrait mieux partir. D’autre part, depuis lors, le nombre de professeurs qui partent pour s’installer dans des établissements européens et étatsuniens est croissant.
Le rapport pose encore une série de questions extrêmement importantes pour comprendre l’ainsi-dite fuite de doctorants et chercheurs – on pourrait citer les données sur les publications pour analyser les rapports entretenus entre ces deux régions du monde – qu’on ne pourra pas, faute d’espace, aborder ici. Toutefois, je voudrais souligner que ce rapport nous habilite à comprendre une face très concrète de ces mouvements récents, dans un contexte de précarisation de l’enseignement supérieur qui a affecté un grand nombre de pays, surtout sous-développés, qui ont subi les essais néo-libéraux de l’époque9. Rappelons-nous, cela a eu lieu au même moment d’attraction de cerveaux en occident, où le modèle de financement privé par le biais des fondations a vu son essor. Plutôt qu’anecdotique, est capitale pour cette recherche la réflexion sur les articulations économiques et politiques au niveau transnational qui produisent les conditions ou les supposés besoins de circulation de personnes. La mondialisation des sciences sociales, avec leurs théories et théoriciens, ne se produit pas dans un vide politique, idéologique et économique.
C’est à partir de ces constats que je me suis posé les questions qui susciteront la rédaction de cette thèse, à savoir : quels changements institutionnels, en Inde et en Europe, ont engendré l’ouverture du système académique anglais et allemand à des enseignants indiens, et quel rapport entre ces dynamiques et l’apparition de nouveaux centres de recherche où une grande partie de ces chercheurs se sont installés ? Quels rapports entre les projets personnels et institutionnels dans leurs différents niveaux – université, fondations de financement et État (Empire et Commonwealth, discours de développement et diversité culturelle, mondialisation et politiques culturelles) ? Et comment ces projets, de portée transnationale, s’articulent-ils avec la construction de projets professionnels individuels ? La présente recherche se propose donc d’étudier d’un point de vue ethnographique les trajectoires de chercheurs indiens faisant carrière en Europe, toujours articulant leur trajectoire personnelle à des transformations institutionnelle, politique et économique plus larges qui, à la fois, déterminent et sont produites par ces conditions historiques.
Annonce du plan
Cette thèse se divise en trois parties. La première, intitulée Anciennes et nouvelles formes de vies académiques : réseaux, lieux de formation et expériences vécues, se concentre sur les évolutions récentes de ces circulations, surtout en termes de représentations et du profil des personnes qui y sont impliquées – ainsi que du rapport entre ces deux. Comment constituer des réseaux, comment se comporter et les stratégies adoptées pour se faire une place sont abordées ethnographiquement et historiquement. Cependant, à la différence de nombreux travaux qui adoptent une perspective romantisée ou qui naturalisent certaines dynamiques propres à ce travail de tissage d’une carrière, j’explore le rôle joué par la race, le genre, la caste et la classe dans ces processus. Ces nouveaux-arrivants de la vie académique ont ici une place importante dans un exercice de compréhension de ce milieu dans son ensemble.
Le chapitre 1, intitulé Espaces de circulations postcoloniales : restitutions ethnographiques et historiques, a été conçu en deux parties complémentaires. Dans la première, je restitue ethnographiquement deux colloques qui ont eu lieu à Delhi et Londres. D’une part, je cherche à rendre compte de l’étendue des réseaux qui constituent mon terrain, ainsi qu’à accorder certaine concrétude à son aspect multi-site. Je mets ainsi en relation deux situations ethnographiques géographiquement éloignées de manière à explorer leurs connections. D’autre part, ce chapitre ouvre la thèse en soulevant de manière articulée, à l’aide de la description de deux moments de sociabilité, une série de questions qui seront développées davantage tout au long de ce travail. L’idée est aussi d’accorder de la spatialité et de la chair à des questions comme la classe, la langue, la précarité, le genre, les hiérarchies académiques, entre autres qui seront approfondies au long des chapitres. La seconde partie du chapitre 1 est constituée d’une brève histoire des circulations académiques entre l’Inde et l’Europe. Ce faisant, je n’ai pas l’intention de me livrer à l’écriture d’une histoire englobante de ces relations, sinon d’offrir un certain nombre de repères que je juge fondamentaux à la lecture des chapitres suivants. Ne pas inclure un chapitre historique a été un choix motivé par l’entendement que la production historique à ce sujet est vaste, et que si le présent travail peut y apporter une contribution, celle-ci réside dans sa totalité. Il m’a semblé ainsi plus judicieux de revenir sur des questions historiques précises qui créent les fondements pour une démonstration plus étendue sur des évolutions en cours.
Les chapitres 2, intitulé Tisser les réseaux : les héritiers et les « hustlers », et 3, intitulé Nouveaux sujets, nouvelles représentations : la contestation des « élites », étant organiquement liés, ont vocation à être présentés ensemble. Ensemble, ils portent sur les conditions matérielles et symboliques de production de réseaux de nos jours. Je fais dialoguer entretiens et observation participante de la vie académique afin de restituer un espace social de production de chercheurs. En naviguant entre les trajectoires académiques hégémoniques bien connues des classes moyennes et aisées, traditionnellement éduquées (dans le chapitre 2), et celles qui émergent aujourd’hui, représentées par les peu nombreux parcours d’ascension sociale que j’ai pu trouver (dans le chapitre 3), je vise à comprendre les transformations en cours d’un champ académique tendu et ambivalent. La notion même d’« intellectuel indien est critiquement et progressivement interrogée partir de récits et de situations ethnographiques qui font émerger les tensions qui résultent de l’évolution historique de ces circulations. Il s’agit ici de comprendre qui sont les anciens et nouveaux sujets qui construisent ces réseaux.
Dans la seconde partie, intitulée Les mots, les émotions, les corps, il est question d’une réflexion méthodologique et épistémologique sur la place de ces trois dimensions dans l’enquête ethnographique. Le chapitre 3, intitulé Un terrain incarné : considérations méthodologiques, propose une discussion sur le non-dit dans le milieu académique, ses effets sur mon terrain, ainsi que ses implications dans la reproduction de relations de pouvoir asymétriques. À partir d’une micro-situation ethnographique, à savoir un échange de regards entre moi et une interlocutrice, j’engage une réflexion sur les manières possibles de restituer par le texte ces moments de silence et pourtant si significatifs ethnographiquement. Méthode et théorie se confondent dans la tentative d’accorder droit de cité au corps et aux expériences viscérales dans la recherche anthropologique.
Dans le chapitre 5, Une académie incarnée : restitutions ethnographiques je me propose de mettre en place une analyse du rôle joué par les mots et le silence sur mon terrain à partir de deux récits précis. En analysant les entretiens avec deux femmes racialisées dans un milieu encore assez masculin et de hautes castes, les questions de classe, genre et caste émergent de manières diverses : parfois comme des accusations ouvertes mais complexes, et parfois sous la forme de non-dits ou de stratégies rhétoriques par lesquelles on parle longuement de ces problématiques mais sans effectivement énoncer certaines considérations sous-jacentes. Des stratégies de résistance et de refus sont aussi explorées afin d’aller au-delà de perspectives déterministes sur la constitution de ces champs relativement hermétiques.
Dans la troisième partie, Construire une vie académique aujourd’hui : sentiments d’appartenance, engagements politiques et précarité, je me concentre sur les formes contemporaines de la vie académique. Bien que la portée historique y reste centrale, je m’intéresse davantage à ce qui caractérise la vie académique de ces personnes dans un contexte social, politique et économique contemporain. Ce qui est en question ici n’est pas une division binaire entre l’historique et le contemporain, mais plutôt de focaliser sur les évolutions plus récentes concernant la manière dont une vie et des subjectivités peuvent être construites à ce jour. Les notions de diaspora, subjectivités politiques et précarité composent ainsi, à travers ces trois chapitres, les pièces d’un kaléidoscope qu’on tourne à chaque chapitre afin d’envisager la problématique de la production de subjectivités de points de vue différents mais imbriqués les uns avec les autres.
Ainsi, le chapitre 6, intitulé Habiter le postcolonial : théorie, littérature et trajectoires, pose les bases pour penser la production de subjectivités en contexte de mobilité académique par le biais de la théorie, mais pas uniquement. Je pars de la notion de « retourner en Asie du Sud par la théorie » pour entamer une discussion sur la production d’un espace de récits historiques et sociologiques que certains de mes interlocuteurs habitent, pour ainsi dire, et dans lesquels ils inscrivent leurs propres trajectoires. Pour ce faire, je mène un débat sur les sens des termes diaspora et postcolonial pour comprendre comment, dans un contexte épistémique, institutionnel et historique précis, « la théorie » devient un espace d’élaboration de subjectivités. Je réalise une incursion par la littérature de fiction, qui apparaît ici comme matériau ethnographique de signification de ces trajectoires et de mise en contexte de débats dans lesquels ces personnes se positionnent.
Le chapitre 7 donne suite à cette discussion en lui donnant un peu plus de chair. Intitulé Engagements politiques avec la politique transnationale : subjectivités politiques en contexte de mobilité il place la notion d’engagement politique au cœur de la réflexion. J’y examine les formes d’engagement politique, autant par la théorie que par les activités publiques, autant en Europe qu’en Inde. Je démontre comment le travail académique, et la vie en Europe, ne se dissocie pas d’un engagement politique actif envers l’Inde qui est à la fois propre à un contexte politique et à des formes de subjectivités contemporaines. L’aspect multi-site de mon terrain est mobilisé par la mise en relation de situations ethnographiques en Angleterre et en Inde où, dans les deux cas, vie académique et politique s’amalgament. Les notions de cosmopolitisme, citoyen du monde et transnationalisme sont mobilisés comme outils heuristiques de trajectoires, récits et projets de vie. Futurs mouvants : précarité et mobilité académique est le titre du chapitre 8, qui clôt la thèse par un regard critique sur l’enjeu qui caractérise de façon singulière les circulations académiques contemporaines : la précarité. Je me livre dans ce chapitre à une lecture critique de la notion même de circulations de manière à comprendre comment ce terme (et d’autres qui y sont associés, comme cosmopolite, transnational, global, etc.) sont récupérés dans la justification de la précarisation de la vie académique. La question de la vie en tant qu’objet de réflexion anthropologique, soulevée plus tôt dans cette introduction, apparaît ici de manière plus puissante puisque la question qu’on se pose est précisément celle de savoir quelle est la forme de vie possible dans un contexte de précarité certes professionnelle, mais aussi économique, affective et subjective. Ce chapitre synthétise en quelque sorte les questions abordées tout au long de la thèse dans la mesure où il agglutine, dans les récits et situations ethnographiques décrites, les contradictions et stratégies adoptées en termes de réseaux, de théories, d’émotions et d’engagements politiques pour continuer d’avancer quand le futur est lui-même mouvant. Il synthétise aussi les questions de classe et caste (et en moindre mesure de genre) dans ses contradictions actuelles quand la précarité est à la fois une réaffirmation des privilèges des quelques qui « réussissent » et un fait englobant qui affecte aussi ceux qui ont toujours été privilégiés.
En somme, ce qui relie ces chapitres est l’interrogation des conditions de construction d’une vie académique en trois dimensions : (a) les contextes historiques (qui sont liés par des concepts comme postcolonialité, indépendance, globalisation et néolibéralisme), (b) les politiques scientifiques et pratiques institutionnelles (qui représentent les sites au travers desquels ces transformations se réalisent), et (c) subjectives (les projets, imaginaires partagés, les émotions et le corps). Le fil rouge qui traverse les chapitres consiste en une interrogation sur comment des vies peuvent être vécues dans un contexte social et subjectif marqué par les transformations décrites dans cette thèse.
Finalement, une note sur les postfaces des chapitres 5 et 8. Ces textes sont une ouverture à des réflexions plus ou moins personnelles, mais en lien direct avec la thèse. Celle du chapitre 5, intitulé La Préfecture de Police de Paris : notes sur les démarches migratoires d’un doctorant, est un récit personnel de la bureaucratie migratoire à la Préfecture de Police et au Consulat de la France à São Paulo. En vue de la thématique de la thèse, il m’a semblé pertinent d’apporter un récit incarné de ces expériences bureaucratiques plus ou moins communes à tout étudiant étranger (en France, en Europe, mais aussi ailleurs). Et ceci d’autant plus que ces dimensions ne sont pas traitées dans la thèse, aussi en raison de la moindre importance de ces procédures dans la vie de chercheurs que dans celle des étudiants. Au travers de notes prises au long de plusieurs rendez-vous et de situations plus ou moins insolites, j’ai construit un texte qui rend compte des particularités et des vicissitudes inhérentes à ces démarches. La postface du chapitre 8, à son tour, est consacrée à des considérations sur ce qui a été nommé #HAUTalk. Alors que l’éditeur d’une prestigieuse revue académique d’anthropologie, la HAU Journal, est amplement accusé d’une série d’abus moraux, physiques et financiers, à l’appui de témoignages qui se multiplient, quelle est la réaction de la communauté anthropologique, que ce soit celle qui est directement concernée, ou celle qui l’est indirectement ? En somme, il s’agit d’un exercice circonscrit et embryonnaire d’interrogation de l’économie morale propre au champ académique.