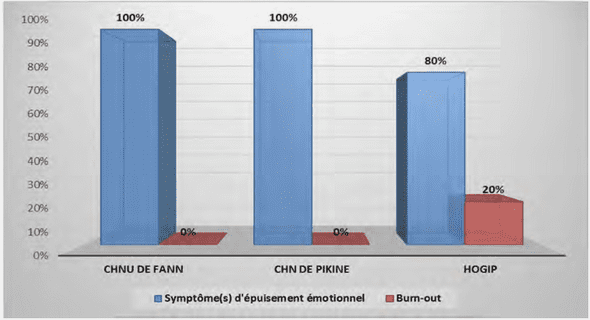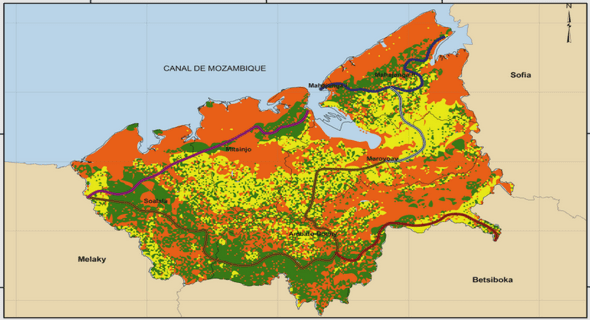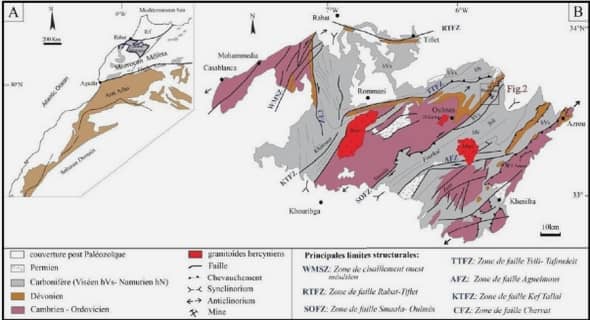Faire de la recherche avec des jeunes : des questionnements deontologiques et ethiques
Travailler avec de jeunes enqu^etes souleve des questions a la fois ethiques et methodologiques. Ces questions ont et traitees par de nombreux auteurs (Oppencha m, 2011 ; Sime, 2008). Comme le rappelle Beatrice Collignon, le questionnement ethique est rest jusqu’a une date tres recente mal percu dans le domaine des sciences sociales francaises (Collignon, 2010). Ce sujet conna^t cependant en France un inter^et nouveau depuis une dizaine d’annees, no-tamment en geographie (Dubreuil, 2020). Le questionnement ethique, de ni comme une demarche re exive sur les valeurs et les nalites de la recherche scienti que (Coutellec, 2019), est important dans le cadre de ma recherche. Comment recueillir et utiliser pour un travail academique des informations sur les pratiques, les discours et les representations des lyceens en s’assu-rant que ces derniers comprennent ce qu’implique leur participation a la recherche ? Ils ne sont pas des objets mais des sujets, sont mineurs, et je leur prends du temps. Ils ne sont par ailleurs pas retribues (Perronet, 2015).
Ma re exion porte sur deux questions ethiques a ce jour centrales en geographie. La premiere concerne l’articulation des valeurs morales avec la pratique de la geographie. La seconde concerne l’utilite du savoir geographique produit par la recherche dans une perspective ethique, a savoir comment les geographes peuvent parvenir a s’engager et a reussir a mettre leurs savoirs au service des participants a l’enqu^ete. Je rejoins ici les interrogations posees par William Bunge lors de ses travaux a Detroit (Bunge, 1969), qui portent sur la pratique du chercheur en lien avec sa responsabilit a l’egard de l’objet etudi (Collignon, op.cit.).
Dans ce sillage, je vais developper deux aspects : la question du consen-tement eclaire pour la participation a la recherche et la question du don/ contre-don.
La question du consentement eclair en sciences sociales
La recherche avec de jeunes enqu^etes souleve des considerations ethiques, notamment en ce qui concerne ce que l’on nomme le consentement eclaire a participer a la recherche. Lorsque la mise en contact du chercheur avec les enqu^etes se fait par l’intermediaire de l’institution scolaire, il peut exister une confusion aux yeux de ces derniers entre la recherche et leurs activites scolaires habituelles. Je redoutais des refus, pour ces raisons, avant d’aller sur mes terrains.
La question de consentement eclair a laquelle je me suis interessee au cours de mon travail de these ne concerne pas uniquement les enqu^etes mi-neurs. Elle se pose de plus en plus en sciences sociales, comme en temoigne le developpement des comites d’ethique, des guides de bonne conduite et des codes de deontologie (Vassy et Keller, 2008). Ces structures ou les textes qui encadrent la recherche imposent souvent l’obtention du consentement des interroges, qui doit ^etre recueilli avant le debut de la recherche, sous forme ecrite ou orale, et dont le chercheur peut garder la trace.
Le consentement eclair est l’acceptation de la participation a une re-cherche de maniere libre et non contrainte. Cette participation doit ^etre precedee d’une information. A n que les lyceennes et les lyceens n’associent pas mon travail a une quelconque t^ache institutionnelle, je les rassurais des ma premiere rencontre en classe avec eux. J’expliquais que les enjeux de mes recherches n’etaient pas scolaires : Je vous rassure, c’est pas un truc sco-laire, c’est juste une interview ; c’est pas note, c’est juste pour moi pour mon travail a moi. Il n’y a pas d’enjeu .
Les enqu^etes doivent aussi ^etre clairement informes qu’ils peuvent inter-rompre leur participation a la recherche quand ils le souhaitent. Or, il n’est pas toujours facile d’obtenir ce consentement de maniere formalisee, et ce particulierement sous forme ecrite. Je me suis aussi pose la question de sa-voir qui doit fournir le consentement de participation a l’enqu^ete : l’enqu^et mineur ? Ses parents ? L’institution par laquelle le chercheur est entr en contact avec l’enqu^et ?
Les principales institutions de contr^ole ethique apportent sur ce point des reponses di erentes. Pour les comites d’ethique, le recueil du consentement des tuteurs adultes semble primer sur celui des enqu^etes mineurs (Genard, Roca I Escoda, 2019). Cependant, les exigences de ces comites peuvent en-traver, voire emp^echer la conduite d’enqu^etes aupres d’enqu^etes mineurs.
Les exigences des comites d’ethique sont avant tout motivees par la vo-lonte des universites et des instituts de recherche de se proteger juridique-ment (Skelton, 2008), mais ces comites sont composes d’adultes qui n’ont pas l’habitude de travailler avec des mineurs. La meconnaissance du public enqu^et les conduit a formuler des exigences qui ne peuvent fonctionner avec les speci cites de nos enqu^etes. Ainsi, lorsque la recherche est menee au sein d’institutions scolaires, comme c’est le cas de mon travail, demander la si-gnature des parents peut rompre la relation de con ance entre le chercheur et l’adolescent en rappelant a celui-ci le cadre de l’institution. Comme le souligne Nicolas Oppencha m dans sa these de doctorat, et comme je le pres-sentais du fait de mon experience d’enseignante, la probabilite d’un refus des parents est d’autant plus elevee que la demande du chercheur est formulee sous forme ecrite, notamment dans les milieux dits populaires (Oppencha m, 2011). Les parents moins familiers des procedures ecrites et du jargon insti-tutionnel peuvent avoir une forme de de ance a l’egard de l’institution et de ce qui y a trait. Ces exigences peuvent ainsi bloquer des enqu^etes auxquelles les jeunes auraient envie de participer et qui leur permettraient d’exprimer leur point de vue. L’adresse aux parents peut ainsi susciter de la me ance, le risque etant de voir certains jeunes refuser de participer a l’entretien, alors qu’un accord tacite avec le chercheur existait auparavant. Pour ma part, j’ai choisi de ne jamais demander l’autorisation des parents. Tout au plus, ces der-niers etaient-ils informes via les moyens de communication de l’etablissement de la presence d’une chercheuse au sein du lycee pendant quelques mois.
Mon choix s’appuie sur la conviction que faire primer le consentement des adultes sur celui des mineurs sous-entendrait que ces derniers ne sont pas consideres comme aptes a accepter ou a refuser d’eux-m^emes de participer a une enqu^ete. Or, cette vision est en opposition avec la Convention de 1989 de l’Organisation des Nations Unies sur les droits de l’enfant, convention qui concerne tous les mineurs, donc les adolescents aussi. Les articles 12 et 13 de cette convention declarent en e et que toutes et tous ont non seulement un droit de regard sur ce qui les concerne, mais qu’ils ont egalement le droit d’exprimer leur point de vue s’ils le desirent.
En outre, je m’appuie sur les preconisations scienti ques que j’ai consultees, notamment la charte de l’Association Francaise de Sociologie qui mentionne seulement l’exigence de ne pas abuser de la situation d’enqu^etes vulnerables, du fait de leur situation sociale, de leur age^ ou de leur sante mentale ou physique. Aux Etats-Unis en revanche, les sociologues doivent obtenir le consentement des enfants, dans la mesure ou ils sont capables de le don-ner et s’assurer que le caractere volontaire de la recherche est bien compris et que le consentement n’est pas obtenu par la contrainte , ils doivent egalement obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur legal. Neanmoins, ces codes nationaux reconnaissent que le consentement des pa-rents n’est pas un principe absolu et que les chercheurs peuvent renoncer a ce consentement quand la recherche implique un risque minimal pour les parti-cipants, ou quand la recherche pourrait ne pas ^etre menee a bien en raison de l’exigence de consentement ou quand le consente-ment d’un parent ou d’un tuteur n’est pas une mesure raison-nable de protection de l’enfant (par exemple, quand les enfants sont negliges ou maltraites). (Groupe en ethique de la recherche, 2018).
En parallele de ces preconisations, des principes de bonne conduite ont et developpes dans les guides ethiques des universites comme celle de Warwick et sont exposes dans des articles de la revue Children’s Geography ou dans des livres portant speci quement sur la deontologie du chercheur travaillant avec des enfants (Danic et al., 2006). Les chercheurs qui s’inscrivent dans cette demarche postulent que les mineurs possedent les competences pour com-prendre les objectifs d’une recherche et peuvent donc d’eux-m^emes accepter ou refuser d’y prendre part. Le chercheur doit s’assurer qu’ils comprennent les tenants et les aboutissants de cette participation mais c’est leur choix qui prime.
Sur mes terrains d’enqu^ete, tous les entretiens se sont donc e ectues sur la base du volontariat apres une seance de presentation aux lyceens – en classe – des tenants et aboutissants de ma recherche. Avec l’accord des proviseurs des di erents etablissements constituant mes terrains, qui se portaient de fait ga-rants de la legitimit de mon travail, le protocole a et le suivant : annonce par lettre aux parents ou sur le site de l’etablissement de la presence d’une chercheuse en sciences sociales dans l’etablissement (avec precision du nom de l’Universite), rappel lors de la seance de presentation en groupe classe que les questions ne portent pas sur des themes ayant trait a l’intime ou a des questionnements personnels, rappel de l’anonymat des donnees, rap-pel qu’une partie des discours et des pratiques exposees, m^eme anonymisee, risque d’^etre publiee.
De maniere a ne pas ^etre rattachee a un ordre institutionnel trop rigide, je n’ai pas non plus fait signer aux eleves d’engagement ecrit de consentement a la participation. Ils s’inscrivaient de maniere manuscrite sur une feuille circulant en classe tandis que chaque entretien enregistre, ce fait etant signale aux lyceens volontaires, debutait ainsi par le rappel du prenom de l’eleve et de sa classe ainsi que par mes remerciements pour avoir accept de participer a cette enqu^ete a l’issue de la presentation des enjeux de ma recherche , ce qui con rmait le consentement de participation a mon travail.
Le don/contre-don et les nalites de la recherche
Les lyceens m’ont demand systematiquement pourquoi je voulais les in-terroger. Cette question portait sur deux points :
| pourquoi je menais un travail de recherche (interrogation sur l’inscrip-tion de ce travail dans mon cursus), a quoi le travail men allait servir (interrogation sur les nalites de ce travail par-dela la promotion individuelle).
L’utilite du don Lors de la seance de presentation, les lyceens ont souvent pose la question : A quoi ca sert ? (Lina, eleve de seconde, lycee Porte Oceane), Pourquoi ca vous interesse ce qu’on pense ? (Vince, eleve de seconde, lycee Pasteur) : ces questions sont revenues dans chacune des classes dans lesquelles je suis passee pour presenter mon projet ainsi que dans un tiers des discussions informelles de n d’entretien. Une certaine curiosite, en particulier sur les nalites de mes recherches, est a mettre en parallele avec un questionnement utilitariste sur la legitimit de l’ecole en general. Elle fait echo aux questions deja entendues dans le cadre de ma pratique profession-nelle : Et ca va servir a quoi ce qu’on apprend la ? . J’ai tout d’abord expliqu ce qu’etait un doctorat dans le systeme universitaire. En ce qui concerne l’utilite de mes analyses, j’ai expliqu que cette recherche ne produi-rait pas de changement immediat, ni pour eux ni pour la science geographique de maniere generale. J’ai cependant expliqu que je cherchais a mieux com-prendre a travers leurs voix leurs centres d’inter^et et leurs pratiques en dehors de l’institution scolaire alors qu’en general les adultes s’interessent principa-lement a leurs comportements et a leurs resultats scolaires. J’ai aussi mobilise l’argument de politiques institutionnelles menees, ce qui m’a valu quelques reactions amusees : Ca veut dire que les gens qui font les programmes vont lire ce que vous allez ecrire ? . L’utilite de mon travail pour celles et ceux qui viendraient a ma rencontre Les eleves m’ont aussi demand : Et nous, ca nous rapporte quoi ? . Se pose ici la question du contre-don . J’observe une correlation entre le niveau de performance scolaire et le fait que les eleves concernes par la reussite scolaire semblent avoir interioris que toute experience ou savoir sont bons a prendre . J’ai ainsi entendu la question Et nous, ca nous rapporte quoi ? dans la moitie des classes du lycee Porte Oceane et dans un quart des classes du lycee Jean XXIII et du lycee Pasteur (dans tous ces lycees majoritairement en classe de seconde) ; jamais en revanche au lycee Louis-le-Grand. Me demander ce que je dois aux enqu^etes en tant que chercheuse recoupe en realit des questions di erentes : d’une part, le droit de regard des enqu^etes sur la maniere dont j’ai analyse leurs propos ; d’autre part, l’in uence que peut avoir la recherche sur la vie des enqu^etes et du groupe social auquel ils appartiennent ; en n, ce que cette experience peut leur apporter dans la mesure ou en France, elle ne fait pas l’objet d’une contrepartie nanciere.
La restitution des resultats aux enqu^etes constitue a mes yeux une exigence deontologique. Cette exigence s’imposait deja a moi en amont de la recherche mais elle m’est apparue d’autant plus importante du fait des ques-tionnements des jeunes.
La di cile restitution des resultats La restitution des resultats repond a un double objectif : prouver aux enqu^etes que j’ai bel et bien respect leur anonymat et leur rendre un savoir qu’ils ont contribue a produire en me livrant leur parole. Les lyceens auront quitte l’etablissement au moment de ma publication. Je leur ai cependant signale un calendrier indicatif et le fait que mes travaux seront transmis a leur etablissement avec une future possible consultation. Certains auteurs retranscrivent et analysent ainsi dans un chapitre conclusif les reactions suscitees par la lecture de leur manuscrit par les enqu^etes (Duneier, 1999 cite par Oppencha m, op.cit.). Sans inscrire un tel chapitre dans mon travail de these, je tenterai tout de m^eme, si cela est possible, de mener ce genre d’experience comme prolongement a mes interrogations deontologiques.
Comme je l’ai rappel aux lyceens lors de mes seances de presentation, la nalite d’une recherche est la production de connaissances sur un univers ou sur des phenomenes sociaux. Ces connaissances sont d’abord produites a destination de mes pairs, et donc de ma communaute scienti que, puis seront eventuellement partagees a un public plus large. Je me suis d’ailleurs moi-m^eme posee la question de l’utilite de mon travail pour le groupe que j’ai etudi . Il est communement admis que les connaissances produites permet-tront de faire entendre des voix d’habitude inaudibles du public, de modi er le regard porte sur ce groupe social et d’orienter la politique menee a leur egard (Oppenchaim, ibid). La recherche pourra donc avoir des consequences positives sur les futurs lyceens puisque la plupart de mes informateurs seront quant a eux deja etudiants au moment ou je soutiendrai cette these.
Inter^et personnel et don sans contrepartie En n, et c’est un autre element de reponse que j’ai apporte aux eleves, les enqu^etes peuvent retirer di erents bene ces d’une participation active a la recherche, notamment une re exivit sur leurs pratiques. Je leur ai aussi rappel qu’ils pouvaient m^eme, s’ils le souhaitaient, noti er leur participation a un travail de recherches uni-versitaires de l’Universit Paris 1 la Sorbonne sur leur curriculum vitae, le nom de l’Universit etant pour la plupart associe a un certain prestige. D’un point de vue pratique, je leur ai egalement rappel qu’eux-m^emes pourraient rapidement avoir a aire a ce type de pratiques de recherche a l’echelle de leur TPE (travaux personnels encadres, epreuve de recherche qui comptait jus-qu’en 2018 pour le baccalaureat de classe de 1ere) et qu’observer mon travail en y participant pouvait constituer un entra^nement. En n, je leur ai precis que, m^eme s’ils n’en tiraient a priori aucun bene ce, ils pouvaient aussi venir a ma rencontre parce que j’avais besoin d’eux et que ce serait sympathique de leur part , au-dela toute perspective utilitariste.