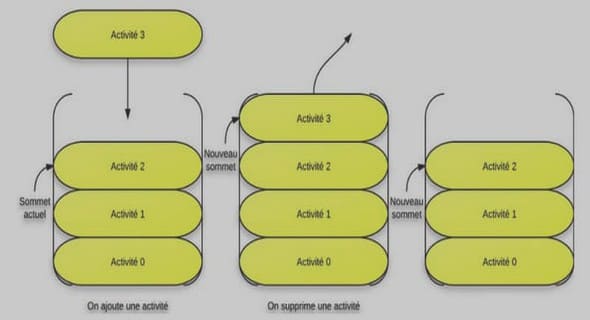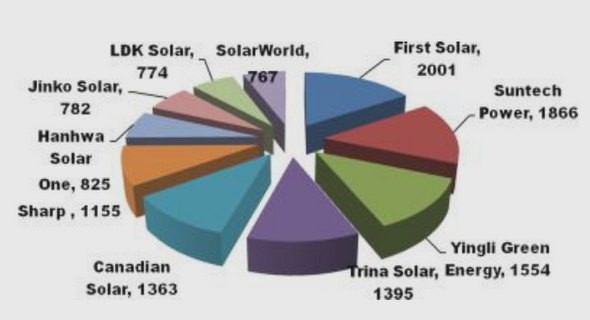Les inégalités territoriales de santé (ITS)
L’approche géographique des questions de santé a permis de montrer que les ITS sont importantes. Même si les unes et les autres se recouvrent partiellement du fait de la distribution spatiale des classes sociales, les ITS ne sont pas réductibles aux ISS car s’y ajoute l’effet de la distance, géographique comme dans les zones rurales ou sociale comme dans les banlieues des grandes villes142.
Au niveau mondial, de fortes inégalités existent en termes d’espérance de vie entre pays (47 ans au Malawi contre 83 ans au Japon en 2009143) mais également entre régions d’un même pays (20 années d’espérance de vie d’écart entre les comtés les plus extrêmes aux Etats-Unis en 2014144). Autre indicateur de l’état de santé de la population, la mortalité cardiovasculaire en 2011 varie du simple au double entre l’état d’Alabama et le Minnesota145 ; quant au taux de mortalité par AVC dans le monde, il varie de 27 cas pour 100 000 personnes-années en France à 264 cas pour 100 000 personnes-années en Afghanistan en 2010146.
En France, les ITS sont marquées et se sont accentuées au fil du temps. Si l’on regarde la mortalité prématurée (avant 65 ans), on retrouve une zone de surmortalité de la Bretagne au Grand Est en passant par les Hauts-de-France. A l’inverse, la sous-mortalité est affirmée en Ile-de-France et dans la partie méridionale du pays (Rhône-Alpes et Occitanie). Entre les périodes 1991-1997 et 2001-2007, la mortalité prématurée a globalement baissé (de 2,66‰ à 2,15‰) mais plus de 60 % des cantons, regroupant plus de la moitié de la population métropolitaine ont connu une évolution moins favorable que la moyenne du pays147. L’analyse de données plus récentes de mortalité entre 2012 et 2016 montre qu’à âge, sexe, niveau de vie et catégorie sociale fixés, la probabilité de décéder est la plus forte dans les Hauts-de-France, la Normandie et le Grand Est tandis qu’elle est plus faible en Occitanie139.
La réduction des inégalités de santé est aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique qui nécessite de bien comprendre la relation complexe entre l’état de santé d’un individu et les caractéristiques de l’environnement (social, économique, géographique) dans lequel il évolue ainsi que les mécanismes à l’origine des inégalités de santé afin de déterminer des modèles d’action efficaces. Mais par-delà la santé publique, il s’agit aussi d’une responsabilité collective à engager pour respecter les principes fondamentaux d’égalité et de justice sociale. Ainsi le principe d’universalisme proportionné formulée par Marmot, qui vise à « offrir des interventions universelles destinées à l’ensemble des personnes mais avec des modalités ou une intensité qui varient selon les besoins »148 pourrait permettre d’atteindre l’équité en santé, c’est-à-dire l’absence de différences injustes ou évitables en santé parmi les groupes sociaux149.
Comment expliquer les inégalités de santé ?
Au-delà des causes génétiques et physiologiques déterminantes de l’état de santé d’une population, les facteurs socioéconomiques, individuels ou à l’échelle communautaire, ont été identifiés comme des déterminants sociaux structurels des inégalités de santé dans le rapport de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé (CDSS) de l’OMS149, encore appelés « causes fondamentales » ou « causes des causes »150–152. Dans cette approche éco-sociale153 qui s’inspire des travaux de Diderichsen154, les déterminants structurels, qui génèrent ou renforcent la stratification sociale définissant la position socioéconomique individuelle au sein des hiérarchies de pouvoir, de prestige et d’accès aux ressources, opèrent à travers plusieurs déterminants intermédiaires (circonstances matérielles, circonstances psychosociales, facteurs comportementaux et biologiques, système de santé) pour définir l’état de santé des individus155. Tous ces facteurs ne sont pas indépendants les uns des autres mais forment de véritables chaînes de causalité, depuis les causes les plus fondamentales jusqu’aux causes les plus proximales, comme l’illustre la Figure 8.
Les caractéristiques socioéconomiques individuelles comme le niveau d’éducation peuvent jouer sur le niveau de compréhension des messages de prévention et des recommandations de santé publique, le niveau de maîtrise de sa vie et de ses comportements de santé dans un environnement contraint, le niveau d’utilisation du système de soins primaires (consultations), l’utilisation et la compréhension du système de soins préventifs et cliniques (dépistage, hospitalisations), mais également sur l’observance thérapeutique156,157. Les ressources financières, en partie corrélées au niveau d’éducation, conditionnent l’accès aux biens et aux services dont de nombreux ont une implication sur la santé (alimentation, logement, loisirs, accès à l’information et aux médias, biens et services de santé tels que la complémentaire santé par exemple). La profession peut être directement liée à la santé par les expositions professionnelles (physiques, chimiques ou psychosociales) ou indirectement par les ressources financières ou sociales (cohésion sociale) qu’elle procure157,158.
Le contexte socioéconomique d’une zone géographique intervient également en jouant de manière complexe sur la répartition des équipements et des services de soins sur le territoire ainsi que sur l’exposition aux nuisances environnementales des résidents. Ces déterminants socioéconomiques contextuels peuvent également moduler les comportements individuels (le régime alimentaire via la disponibilité relative de structures de restauration rapide par exemple), le mode de vie des individus (sédentarité) et les risques psychosociaux (violences, criminalité) : autant de facteurs socialement distribués et reconnus à risque pour la santé.
Si aucun de ces facteurs socioéconomiques individuels et contextuels (ni individuellement, ni pris ensemble) ne semble déterminer complètement un comportement de santé, ni a fortiori une maladie ou un événement de santé, chacun d’entre eux peut avoir des effets propres mais peut aussi interagir avec d’autres facteurs dès les premiers âges et se cumuler tout au long de la vie157,159,160, ce qu’illustre le concept d’ « approche vie entière » ou lifecourse approach161. En effet, une action synergique de ces facteurs socioéconomiques semble au cœur du constat des ISS, et plusieurs études ont permis de démontrer l’importance de la prise en compte du statut socioéconomique (SSE) tout au long de la vie c’est-à-dire l’influence de l’enchaînement et de l’accumulation des facteurs mais également le rôle des trajectoires socioprofessionnelles dans les ISS162–164.
La prise en compte de ces déterminants est un enjeu nécessaire pour la mise en place d’interventions efficaces de santé publique visant à réduire les inégalités de santé. Le paragraphe suivant s’intéresse à la mesure des inégalités de santé et aux principaux indicateurs utilisés en épidémiologie pour caractériser le SSE des individus et des zones géographiques.
Mesurer la situation sociale
Le SSE d’un individu est un concept multidimensionnel et il n’en existe pas de définition officielle. Les différentes mesures du SSE tentent de classer les individus dans des groupes de statut, prestige, connaissances, pouvoir ou ressources similaires165. Cependant, bien qu’en partie corrélés entre eux, les indicateurs ne sont pas interchangeables et chaque indicateur reflète une des dimensions du SSE. C’est pourquoi l’utilisation de différents indicateurs est nécessaire pour caractériser le SSE avec plus de précision166. Le SSE est également une notion dynamique, même si elle ne peut être caractérisée qu’à des moments donnés.
La partie suivante dresse un panorama des indicateurs individuels et contextuels les plus utilisés157,167. En pratique, les indicateurs socioéconomiques individuels sont majoritairement recueillis par questionnaire. Les indicateurs contextuels sont quant à eux souvent issus des bases de données administratives.
Statut socioéconomique individuel
De nombreux indicateurs socioéconomiques individuels ont été explorés dans la littérature157,167,168. Parmi eux, trois sont classiquement utilisés : le niveau de revenu, le niveau d’éducation et la profession. Un quatrième est aussi largement utilisé dans les pays anglo-saxons : le niveau de richesse.
Le niveau de revenu est certainement l’indicateur socioéconomique individuel le plus utilisé167. Il peut être considéré comme une mesure des conditions matérielles d’un individu, telles que l’accès à un logement, aux biens de consommation, aux transports, aux services ou encore l’accès aux soins. C’est une dimension très importante de la situation socioéconomique. Cependant, cet indicateur présente des limites. En effet, c’est une donnée sensible largement sujette au biais de déclaration, notamment en France où les informations d’ordre financier restent taboues. Les revenus peuvent également fluctuer considérablement au fil des années et sont fortement associés à l’âge : les plus jeunes qui entrent dans le monde du travail ont en moyenne des salaires moins élevés. Enfin, le niveau de revenu est sujet à a causalité inverse, l’état de santé lui-même pouvant affecter le revenu.
Tandis que les revenus représentent un flux de ressources matérielles, la richesse (wealth) représente un stock de ressources matérielles, c’est-à-dire l’ensemble des biens d’un individu, souvent accumulés au cours de la vie. Très utilisé dans les pays anglo-saxons, cet indicateur reste cependant peu utilisé en France. En théorie, c’est un excellent indicateur car il permet de capturer l’ensemble des ressources financières accumulées tout au long de la vie d’un individu mais en pratique c’est un indicateur complexe à mesurer et à utiliser dans la mesure où il est marqué par des effets de seuil (par exemple disposer d’un logement) et où il dépend largement du contexte géographique.
Le niveau d’éducation est un autre indicateur largement utilisé comme une approximation et un reflet des ressources cognitives et intellectuelles d’un individu, de sa capacité à penser de façon abstraite, à prendre des décisions et à interagir avec son réseau social. Au niveau populationnel, c’est un bon prédicteur de morbidité et mortalité. S’intéresser au niveau d’éducation présente plusieurs avantages : d’abord il est, dans la grande majorité des cas, fixé dès l’âge de 25 ans et reste bien souvent constant au cours de la vie. C’est un indicateur facile à recueillir et qui souffre peu du biais de déclaration contrairement aux revenus par exemple. De plus, il ne dépend pas de la situation actuelle sur le marché du travail et permet donc d’apprécier le statut socioéconomique des personnes inactives. Il n’est en outre pas affecté pas l’état de santé ultérieur et il est assez facilement comparable dans les études internationales. Toutefois, les bénéfices liés au niveau d’éducation ne sont pas les mêmes selon le sexe et la race à niveau d’éducation égal, les hommes et les individus d’origine caucasienne bénéficiant plus d’un niveau plus élevé d’éducation que les femmes et les individus d’autres origines ethniques167. D’autre part, l’effet cohorte peut être important et ainsi le bénéfice lié au niveau d’éducation peut ne pas être équivalent pour toutes les générations, ce qui peut rendre les résultats d’études transversales difficiles à interpréter.
Enfin, la profession ou la CSP reflète la position sociale qu’occupe un individu dans la société à un moment donné. En France, la classification de référence est, depuis 1982, celle des « professions et catégories sociales » de l’INSEE (Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques). Bien que fortement corrélée aux revenus, la CSP peut également être un indicateur du capital social d’un individu (réseaux sociaux et relations au travail). Facilement disponible dans les données de recensement ou les certificats de décès, cet indicateur n’est cependant utilisable que pour les personnes en emploi ou les retraités – à qui on peut attribuer leur ancienne CSP ou celle la plus longtemps occupée – mais exclut les étudiants et les personnes sans emploi. Pour pallier ce problème, un autre indicateur parfois utilisé en complément de la CSP est la situation vis-à-vis de l’emploi. De plus, les groupes sociaux classés selon leur CSP sont très hétérogènes. Enfin, la CSP est un indicateur dépendant du contexte géographique et de l’époque, ce qui peut limiter son utilisation dans des études comparatives.
D’autres indicateurs existent, tels que le patrimoine, les conditions et la qualité de l’habitat ou les indicateurs subjectifs de SSE, mais sont moins fréquemment utilisés dans la littérature.
Statut socioéconomique contextuel
La prise en compte de l’espace en épidémiologie permet d’intégrer les contextes de vie des individus dans leurs dimensions sociales, économiques et culturelles169.
Les déterminants socioéconomiques contextuels ont d’abord été utilisés dans les études écologiques pour approximer le SSE des individus grâce aux caractéristiques socioéconomiques de leur zone géographique de résidence, comme par exemple le revenu moyen ou le pourcentage de chômeurs. Dans les années 80, des indicateurs composites de désavantage social (deprivation index en anglais) ont été développés, en combinant plusieurs indicateurs unidimensionnels mesurés à une échelle géographique donnée166,170,171. Ces indicateurs sont souvent eux-mêmes corrélés à d’autres indicateurs non mesurés et présente l’avantage d’affecter l’ensemble des individus de l’unité géographique indépendamment du niveau socioéconomique individuel. L’inclusion de ces déterminants dans des analyses multiniveaux a ainsi permis de distinguer dans les disparités des états de santé, les éléments propres à la situation socioéconomique de l’individu d’une part et à celle de son environnement collectif d’autre part.
Le concept de désavantage social a été initialement défini par Townsend en 1987 comme un « état observable et démontrable de désavantage relatif face à la communauté locale ou à l’ensemble de la société à laquelle appartient l’individu, la famille ou le groupe ». Plusieurs indices de désavantage social ont été développés et diffèrent par le type et le nombre de variables combinées et par la méthodologie employée. Les plus anciens, comme l’indice de Townsend172 et l’indice de Carstairs173 utilisent un petit nombre de variables et un modèle additif tandis que les indices plus récents incluent plus de variables et ont recours à des méthodes basées sur l’analyse en composante principale.
En France, trois indicateurs composites d’indicateurs individuels sont majoritairement utilisés. L’indice FDep (French Deprivation) a été développé dans le contexte français174. Construit à partir des données du recensement de la population de l’INSEE et des déclarations d’impôts, le FDep est défini comme la première composante d’une analyse en composantes principales de quatre variables : le revenu fiscal médian par unité de consommation, le pourcentage de bacheliers dans la population de plus de 15 ans, le pourcentage d’ouvriers et le taux de chômage dans la population active (15-64 ans). L’indicateur de FDep a été calculé à l’échelle communale. Le plus récent utilise les données de 2009. Il peut être catégorisé classiquement en quantiles.
Un indicateur à visée européenne, l’EDI ou European Deprivation Index, a été proposé en 2012175. Construit à partir de données de l’enquête EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), il prend en compte une combinaison de variables disponibles à la fois au niveau individuel et au niveau géographique et associées aux indicateurs de pauvreté individuelle objective et subjective. La méthodologie utilisée pour construire l’EDI est reproductible dans les 26 pays européens concernés par l’enquête EU-SILC. L’EDI est disponible pour l’ensemble des IRIS, à partir des données INSEE de 2007.
Enfin l’indice « métropoles », inspiré d’un autre indice développé dans la métropole de Strasbourg176, a été proposé en 2013 pour trois métropoles régionales (Lille, Lyon et Marseille) à partir des données du recensement et des revenus fiscaux177. Il représente la combinaison linéaire des variables sélectionnées par analyse en composantes principales. La catégorisation de cet indicateur en quantiles n’est pas toujours appropriée et le recours à une classification hiérarchique est recommandé pour obtenir des classes les plus homogènes possibles.
Les principales limites des indicateurs de désavantage social utilisés aujourd’hui sont le biais écologique qui persiste même à une échelle géographique fine, l’absence de prise en compte du contexte du milieu de vie (rural ou urbain par exemple) et de l’évolution des caractéristiques des territoires au cours du temps (l’indicateur est calculé à un moment donné). De plus, la pertinence de la zone de résidence comme zone géographique est remise en question du fait de la mobilité accrue des individus dans les sociétés d’aujourd’hui. Enfin, l’unité géographique peut varier d’un pays à l’autre ou d’une étude à l’autre et ainsi limiter la validité des comparaisons.
D’une autre nature, les indicateurs mesurés directement à l’échelle du territoire et caractéristiques de l’environnement de vie peuvent également être utilisés pour mesurer la situation socioéconomique contextuelle. Parmi eux, on peut citer des marqueurs de l’environnement physique comme la densité des espaces verts, la densité du bâti ou la présence d’équipements (sportifs, récréatifs, voies piétonnes, transports), mais également des marqueurs de l’environnement social tels que le niveau d’insécurité, de violence ou encore la cohésion sociale.
Inégalités sociales et territoriales dans l’hypertension artérielle
Les inégalités touchent tous les domaines de la santé, et en particulier le domaine cardiovasculaire. Cette section présente un état de l’art sur la question des inégalités sociales et territoriales dans l’HTA dans le contexte mondial et plus spécifiquement français. Elle décrit également les différents mécanismes étiologiques qui ont été proposés dans la littérature.
Etat de l’art
Inégalités sociales et HTA
Au cours des dernières années, plusieurs revues de la littérature sur la relation entre SSE à l’échelle individuelle et HTA ont été publiées118,178,179. Les associations observées dans une récente méta-analyse de 51 études118 tendent à confirmer l’augmentation du risque d’HTA chez les individus ayant un faible SSE pour les trois indicateurs classiques que sont le niveau de revenu (Odds-ratio (OR) poolé 1,19 [IC-95% 0,96–1,48]), la CSP (OR poolé 1,31 [IC-95% 1,04–1,64]) et le niveau d’éducation pour lequel l’association est la plus forte (OR poolé 2,02 [IC-95% 1,55–2,63]). Ces associations sont significatives dans les pays à haut niveau de revenu tels que les Etats-Unis, le Canada et les pays européens. D’autre part, les gradients socioéconomiques semblent plus marqués chez les femmes. Cependant, les auteurs soulignent l’hétérogénéité des résultats entre les études (I²=96,6% pour les revenus, 86,7% pour la CSP, 98,1% pour l’éducation). Toutefois, ces résultats ont été corroborés par d’autres études publiées depuis 2015, notamment dans les pays à haut niveau de revenu137,180,181. Dans les pays à niveau de revenu faible ou modéré, les effets décrits sont plus hétérogènes182–184.
Les études d’incidence de l’HTA sont beaucoup plus rares et à ce jour, très peu se sont intéressées à l’association entre SSE et incidence de l’HTA. Parmi elles, certaines ont montré qu’un plus haut niveau socioéconomique était associé à une plus forte incidence de l’HTA74,185–189. D’autres ont montré l’existence d’une association avec seulement certains marqueurs du SSE190–192 ou seulement chez les femmes84,193,194 et d’autres encore, une absence d’association entre SSE et incidence de l’HTA195–198. Les conclusions sont donc hétérogènes, d’autant plus que la variété des indicateurs et des pays concernés – et donc des contextes socioéconomiques – est importante.