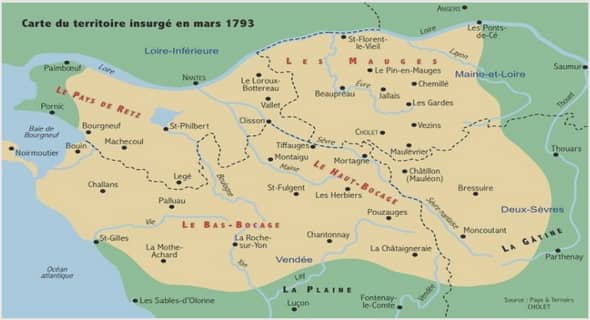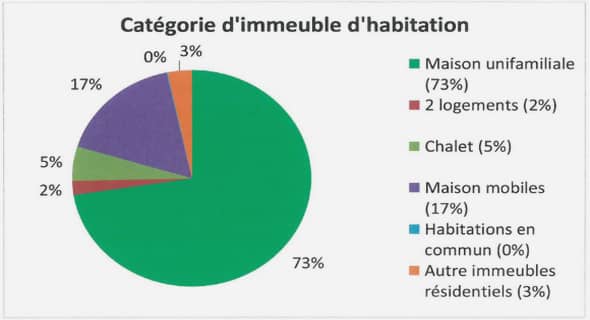Espace conflictuel de Bourdieu et dimension symbolique de l’ordre social
Analyser la société en termes d’espace social conflictuel conduit Bourdieu à considérer la position sociale différentielle des groupes sociaux dans la vie sociale. La position sociale, pour d’autres auteurs, désigne la place du groupe social dans l’ordre social. Elle est appréhendée dans la relation de pouvoir, économique, symbolique, accès aux ressources, la domination d’un champ. Un champ social est « le principe fondamental qui pose que le réel social est relationnel (…) au sens de structures invisibles ».
L’élaboration du concept de champ permet de comprendre les structures invisibles c’est-à-dire des paramètres d’actions auxquelles les agents sociaux ne pensent pas toujours pour produire une action pragmatique, mais qui la conditionnent en permanence. À cette position sociale, Bourdieu associe le concept de « sens de la place » : « chaque agent a une connaissance pratique, corporelle, de sa position dans l’espace social (…) converti en un sens de placement qui commande son expérience de la place occupée, définie absolument et surtout relationnellement, comme rang, et les conduites à tenir pour le tenir (tenir son rang), et s’y tenir (rester à sa place) ». Ce concept permet de comprendre la formulation de l’action pragmatique en tenant compte du sens de la place. La difficulté de la promotion de la femme se tient à cette reconnaissance par les individus de leur sens de la place, qui les amènent à adopter des conduites socialement admises et attendues d’eux.
La construction sociale du genre
Quiconque entreprend une étude sur le genre, le rapport homme/femme, la position sociale de la femme ne manque pas de retenir la formule devenue célèbre de S. de Beauvoir : « on ne naît pas femme, on le devient ». L’auteur veut insister sur le fait que le genre est une construction sociale et non une donnée naturelle. Cette affirmation présuppose la différence entre le sexe qui pose le « mâle et la femelle humains) et le genre (femme et homme), qui fonde le rapport social de deux sexes.
Le « rapport social de sexe » repose sur des différences de force physique. Le physique de l’homme est associé à la force, la femme à la beauté, à la faiblesse (fanaka malemy). C’est sur ce rapport que s’édifie le rapport social du genre. Car il renvoie à l’organisation sociale et sous-entend les fonctions sociales de ce rapport, rôles respectifs des hommes et des femmes dans le fonctionnement de la société. Ce rapport se légitime par la production des stéréotypes, des idéaux, la culture, la religion qui fixent les positions sociales des hommes et des femmes.
L’analyse de ces diverses formes de légitimité de la domination masculine vise à faire ressortir la position sociale des agents sociaux (femmes, hommes, classes sociales) dans le champ de la promotion du genre et à mettre l’accent sur l’espace social des femmes. En effet, l’appartenance à une classe sociale conditionne le positionnement dans ce champ de lutte. La dotation en capital culturel en jeu détermine l’engagement de l’agent social dans la voie de la promotion du genre ou un désintéressement. La question de l’égalité homme/femme que la politique de la promotion du genre se pose comme objectif à atteindre ne relève pas de la culture identitaire des sociétés malgaches.
Le rituel de la catégorisation
L’explication à cette problématique réside dans la situation originelle de l’homme. La nature et la société s’imposent à l’homme qu’il doit construire. D’une part, l’activité constructive du monde et de la société consiste à son appropriation, en lui accordant un sens à la fois objectif et subjectif. Le développement des connaissances résulte de cette activité de signification du monde et de la société. Le monde, la société, les phénomènes ne sont plus un en-soi, mais un pour-soi. Les signes, les codes, les symboles, les rites viennent du rapport d’appropriation du monde.
Cette représentation du monde structure le rapport à ce monde : toutes les activités que l’homme entretient avec la nature ou la société tiennent à cette activité d’appropriation.
L’homme ne peut agir que dans un monde qu’il conçoit comme sien et dans lequel il a su développer un certain nombre de savoirs, savoir-faire et de savoir être. Finalement, c’est cette activité d’appropriation qui crée les catégories des choses. D’autre part, la catégorisation sociale est le produit de l’histoire sociale, de la lutte de classe. Les individus acquièrent leurs connaissances grâce à l’appartenance à une classe sociale, la socialisation. En effet, on constate un double mouvement : d’une part, la catégorisation de soi-même et d’autre part la catégorisation de l’autre. Ces activités structurent les actions et les rapports sociaux. Elles sont différentes selon les classes sociales, les groupes sociaux.
La théorie de l’historicité de Touraine
Pour Touraine, la société se définit par les mouvements sociaux, un rapport de classes, des luttes historiques. « Le mouvement social est la conduite collective organisée d’un acteur de classe luttant contre son adversaire de classe pour la direction sociale de l’historicité dans une collectivité concrète ». Trois conditions définissent un mouvement social : un acteur de classe, une lutte pour la direction sociale de l’historicité, une collectivité concrète.
L’historicisme est une théorie proche de l’évolutionnisme, mais qui s’en différencie néanmoins. L’évolutionnisme « pense dégager des tendances générales de l’évolution sociale ». L’axe central de cette approche est constitué par la considération de la voie univoque du changement social. Tandis que l’historicisme « insiste sur la particularité du parcours de chaque acteur collectif, guidé par une volonté et orienté par une culture et par une histoire ».
La promotion de genre est alors un mouvement social. La lutte engage les hommes et les femmes d’une part, mais il est essentiel de retenir qu’en fonction de la classe sociale, l’investissement dans cette lutte diffère toutefois. L’enjeu de la lutte est alors la production d’une idéologie nouvelle qui permet à son producteur de maitriser l’historicité. Il est alors possible d’analyser la promotion du genre comme un champ de lutte symbolique entre les hommes et les femmes, d’autre part comme un champ de lutte de classes dans la mesure où la production d’une nouvelle représentation du rapport homme/femme est un enjeu d’historicité. Selon l’appartenance à une classe, les modalités d’actions varient.
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1.Généralités
2.Motif du choix du thème et du terrain
3.Problématique
4.Objectifs de l’étude
4.1.Objectif global
4.2.Objectifs spécifiques
5.Hypothèses
6.Méthodologie de recherches
6.1.Structuralisme constructivisme
6.2.Techniques
a.Échantillonnage
b.La préenquête
c.La documentation
d.L’enquête de terrain
i.L’observation en situation
7.Problèmes rencontrés et limites de la recherche
8.Structuration du document
PARTIE 1. SOCIALISATION, CATEGORISATION SOCIALE ET ROLES DANS LE FOKONTANY D’AMBOHIPO
CHAPITRE 1. APPROCHE CONCEPTUELLE DE L’ORGANISATION SOCIALE ET DIMENSION DU GENRE
1.1. Approches sociologiques de l’organisation sociale
1.2. Du sexe au genre ou la construction sociale
CHAPITRE 2. PRÉSENTATION DU TERRAIN
2.1. Cadre historique
2.2. Données de géographie spatiale
2.3. Données démographiques
2.4. Les infrastructures existantes
2.5. Données sur les activités socio-économiques de la population
2.6. Structure de l’emploi selon le sexe
PARTIE 2.MOUVEMENT SOCIAL POUR LA PROMOTION DU GENRE
CHAPITRE 3. LE GENRE DANS LA SOCIÉTÉ MALGACHE
3.1. Les modes de production précapitalistes et la définition du genre
3.2. Mode de production capitaliste et le statut de la femme
3.3. Considérations synthétiques
CHAPITRE 4. MONDIALISATION, PROMOTION DU GENRE ET DÉVELOPPEMENT
4.1. Dynamique de la mondialisation
4.2. Rapports sociaux à la promotion de genre
4.3. Travail de la femme et rapports sociaux du genre
4.4. Les failles sociologiques à la promotion du genre
PARTIE 3.POLITIQUE DE LA PROMOTION DU GENRE A MADAGASCAR
CHAPITRE 5. COMPRENDRE LA REALITE DE L’INEGALITE POUR ASSURER L’EMANCIPATION DES FEMMES
5.1. Montrer la réalité de l’inégalité
5.2. Déconstruire les stéréotypes
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE