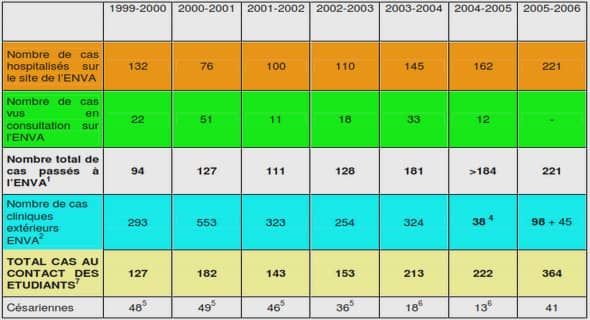Naissance de la profession d’ingénieur au XIXe siècle
Aux Etats-Unis, la formation des ingénieurs est moins ancienne qu’en France et remonte au XIXe siècle. Il semble que l’orientation classique, religieuse et élitiste des universités bloqua considérablement le développement de l’enseignement technique. Ainsi, les écoles d’ingénieurs se créèrent sur l’initiative d’hommes d’affaire. Jusqu’en 1816, aux Etats-Unis, le nombre d’ingénieurs ne dépassait en moyenne pas deux par Etat et il fallut attendre 1823 pour voir naître une école consacrée à la formation technique : Rensselaer, du nom du gentleman farmer qui donna l’argent nécessaire pour créer une école destinée à l’origine à dispenser une formation spécialisée en agriculture ou dans les arts mécaniques. Réorganisée en 1849 sur le modèle de l’Ecole centrale des arts et manufactures, (créée en France en 1829) suite à un voyage en France de son directeur, cette école devint véritablement la première formation d’ingénieurs aux Etats-Unis sous le nom de Rensselaer Polytechnic Institute7. A la même époque, la Military Academy de West Point, qui avait été créée en 1802 sur le modèle des formations militaires françaises, commençait également à former des ingénieurs civils. Malgré la pression forte d’ingénieurs de l’industrie et l’apport de fonds par un riche donateur de la Nouvelle Angleterre, Harvard ne se décida pas à former des ingénieurs avant 1854 : en 1892, seuls 155 étudiants y avaient été formés comme ingénieurs. Les résistances de la célèbre université à développer la formation des ingénieurs que l’industrie réclamait ont largement contribué, selon l’historien David F. Noble, à la création du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1861. L’université de Yale fut un peu moins réticente que Harvard et proposa des enseignements techniques spécialisés à partir de 1846, mais la formation des ingénieurs n’obtint pas de soutien officiel avant 1860.
Dans un article publié dans le Bulletin de la Société pour la philosophie de la technique, Carl Mitcham associe l’émergence de l’engineering ethics aux Etats-Unis au développement de la professionnalisation des ingénieurs de la fin du XIXe siècle8. Selon lui, la meilleure analyse de ce mouvement est l’ouvrage de l’historien Edwin T. Layton, Revolt of the Engineers Profession. Social Responsibility and the American Engineering Profession. Dans la préface de l’édition de 1986, Edwin Layton affirme que « alors que la technologie a apporté de grands bienfaits, elle a aussi produit des effets nuisibles, qui menacent à la fois la société et l’environnement naturel. Ces conséquences négatives des technologies ont conduit à des critiques de plus en plus nombreuses dès le début du XXe siècle, pendant la grande dépression des années 30 et plus récemment dans les années 1970 et 1980. Les ingénieurs furent profondément affectés par ces critiques de leur travail. Quelques-uns défendirent un statu quo. D’autres cherchèrent des moyens par lesquels l’ingénierie deviendrait une force positive, servant le bien de l’humanité. Les ingénieurs prirent deux chemins parallèles. Ils tentèrent de renforcer et unifier leur profession en insistant sur sa mission morale fondamentale. Ils firent aussi des efforts pour réunir la profession afin d’en faire une force active en politique, le meilleur moyen de traiter des effets des technologies sur la société »9. L’analyse de l’émergence de l’engineering ethics qui suit, va reprendre pas à pas l’histoire de la professionnalisation des ingénieurs des Etats-Unis ou plutôt l’histoire des associations professionnelles d’ingénieurs, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Le fait d’analyser le développement d’une profession à partir de la mise en place de formations et de la création d’organisations professionnelles, qui est une approche typique des historiens et sociologues fonctionnalistes des professions aux Etats-Unis, est souvent réductrice parce qu’elle s’appuie sur une définition a priori du groupe professionnel. Luc Boltanski a bien montré la possibilité pour un groupe socio-professionnel (les cadres en l’occurrence) d’émerger loin des définitions a priori10. Pour en revenir aux Etats-Unis, Pap Ndiaye a montré justement en analysant l’identité professionnelle des ingénieurs chimistes comment celle-ci a été le produit d’une construction, d’un processus social, professionnel et chronologique et d’une définition11. Il a en effet fallu attendre les années 1940 pour voir l’American Institute of Chemical Engineers (AIChE créé en 1908) reconnu par les groupements nationaux d’associations d’ingénieurs, et la catégorie « ingénieur-chimiste » proposée comme profession dans les questionnaires du recensement de la population. Pourtant, comme l’explique Pap Ndiaye, chez Du Pont de Nemours, la profession d’ingénieur-chimiste existait bien avant la création de la première école et de la première association professionnelle. Des savoir-faire très pointus, des sagesses pratiques, se transmettaient, en particulier par les logbooks, ces carnets de suivi du travail remplis au jour le jour par les ingénieurs, intermédiaires entre une codification stricte et la transmission orale.
Il faut donc garder à l’esprit qu’en retraçant la dynamique de la profession d’ingénieur et la formalisation d’une éthique professionnelle à partir de l’histoire des formations et des associations professionnelles, tout un pan de l’histoire échappe à l’analyse : celui d’individus se reconnaissant comme ingénieurs, indépendamment des définitions établies par ceux à qui on a donné (ou qui se sont donné) le pouvoir de les formuler. Mais il fallait bien partir des associations si on voulait faire l’histoire de la formulation d’une éthique collective.
La création des premières associations d’ingénieurs aux Etats-Unis
La quête d’un statut social et d’une déontologie propre à la profession d’ingénieur date aux Etats-Unis de la fin du XIXe. L’American Society of Civil Engineers (ASCE) créée en 1852, est considérée par beaucoup d’historiens comme la première association professionnelle d’ingénieurs12. A l’origine cette organisation rassemblait des civilians engineers (c’est-à-dire non militaires) de tout secteur. Selon David F. Noble, « presque immédiatement, ils commencèrent à être confrontés aux contradictions inhérentes à la professionnalisation : se battre pour obtenir une autonomie professionnelle et définir des codes d’éthique et de responsabilité sociale dans le contexte d’une pratique professionnelle qui exige la soumission aux dirigeants des entreprises»13. L’ASCE cessa bien vite d’être la seule organisation d’ingénieurs : les nouveaux métiers d’ingénieurs qui se développèrent à cette époque donnèrent naissance à de nouvelles associations : on peut répertorier plusieurs centaines de créations à des échelles différentes (au niveau local, d’un état ou du pays). Les premières furent l’American Institute of Mining and Metallurgical Engineers (AIMME) qui s’était déjà séparé de l’ASCE en 1871 ; l’American Society of Mechanical Engineers (ASME) qui fut créé en 1880 et dont l’American Institute of Electrical Engineers (AIEE) se sépara en 1884. Le début du XXe siècle vit la création de l’American Institute of Chemical Engineers (AIChE) qui fut fondé en 1908 en réponse à la demande des entreprises qui avaient besoin, pour accompagner l’industrie chimique en plein développement, d’hommes formés non seulement aux sciences, mais aussi au management et à l’organisation.
Selon David Noble, la profession d’ingénieur mécanicien est née d’une distinction, arbitraire » selon lui, entre les « mécaniciens » et les « ingénieurs mécaniciens ». Cette distinction était basée davantage sur l’exercice d’une autorité significative que sur la possession de savoirs techniques. Il décrit l’ASME à sa création comme un « club dirigé par et pour une oligarchie auto-reproductive d’une élite issue de la culture marchande et passée à la tête d’entreprises »14. Pour ses membres, la vraie marque du professionnalisme résidait dans la réussite commerciale, dans une carrière qui conduisait aux plus hauts niveaux de la hiérarchie des entreprises. L’émergence d’un nouveau type de professionnalisme, valorisant davantage les références académiques, la formation scientifique et la promotion à l’intérieur même des entreprises, est probablement liée à l’insuffisance des opportunités de carrière offertes aux jeunes ingénieurs formés aux nouveaux métiers d’ingénieurs apparus à la fin du XIXe siècle. Comme par ailleurs il n’existait pas chez les électriciens et les chimistes de traditions fortes comparables à celles des ingénieurs civils et des mécaniciens, la position hiérarchique et la formation scientifique sont devenues les critères de distinction prédominants de ces métiers nouveaux. Ceci peut expliquer le départ des électriciens de l’ASME et la création en 1884 de l’AIEE.
Les premiers codes dans la dynamique de professionnalisation
William H. Wisely a présenté lors d’une conférence de l’ASCE en 1977, une étude portant sur les premières tentatives d’élaboration d’un code d’éthique commun à toutes les sociétés d’ingénieurs des Etats-Unis15. Il trouva, à cette occasion, les traces d’une vingtaine de projets importants de codes d’éthique entre 1893 et 1976. Le premier code de conduite professionnelle d’ingénieur n’est pas né aux Etas-Unis. Il a, en effet, été adopté le 22 février 1910 par la prestigieuse Institution of Civil Engineers (ICE), née en Grande-Bretagne en 181816. L’ICE qui fut la première organisation d’ingénieurs au monde, marque selon Carl Mitcham la naissance de l’ingénieur moderne17. Les premières législations professionnelles concernant les ingénieurs britanniques sont encore plus anciennes puisqu’elles ont été promulguées peu après la constitution de la première « Charte des Ingénieurs Civils » en 182818.
Le premier code publié aux Etats-Unis, fortement inspiré du texte de l’ICE, a été proposé le 23 juin 1911 par l’American Institute of Consulting Engineers (AICE)19. L’American Institute of Electrical Engineers (AIEE) avait déjà voté en 1906 le principe de rédiger un code : un premier projet avait été proposé en 1907, mais il fut finalement adopté en mars 1912. L’American Institute of Chemical Engineers (AIChE) se dota d’un code en 1912, quatre ans seulement après sa création. Quant à l’American Society of Civil Engineers (ASCE), elle n’adopta le sien que soixante deux ans après sa création, en 1914, en reprenant six des douze articles du code de l’AICE (consulting engineers), dont un seul de ceux empruntés » au code britannique. L’ASME (mechanical engineers) qui tenta de faire adopter en 1913 un code qui réunisse toute la profession, reprit finalement en 1914 celui de l’AIEE auquel il n’apporta que des modifications mineures20. Malgré leur diversité, ces premiers textes étaient assez proches : ils avaient surtout en commun le fait d’insister principalement sur la nécessaire loyauté de l’ingénieur à l’égard de son entreprise. Le code de l’AIEE, par exemple, précisait que l’ingénieur devait « considérer la protection des intérêts de son client ou de son employeur comme [sa] première obligation professionnelle et (…) éviter tout acte contraire à ce devoir »21. Celui de l’ASCE demandait à l’ingénieur d’agir simplement comme un agent ou un salarié digne de confiance ». Carl Mitcham note que paradoxalement, ces codes d’éthique qui avaient été rédigés d’abord en vue de promouvoir le développement et le prestige de la profession d’ingénieur, eurent comme effet de miner plutôt que valoriser l’autonomie professionnelle.
De 1900 à 1930, la profession s’organisa et les effectifs explosèrent. Les ingénieurs passèrent de 45 000 à 230 000 sans remise en question significative de leur statut : ils faisaient toujours partie de l’élite des Etats-Unis. Dans la période de l’entre-deux-guerres, la profession était composée d’hommes (une femme pour mille ingénieurs), issus pour les trois quarts d’entre eux des classes moyennes (fils de rentiers, de dirigeants d’entreprise ou de propriétaires terriens) et dotés d’une formation supérieure. Ils étaient, dans leur grande majorité des WASP, des Américains de naissance, blancs, anglo-saxons et protestants. A l’aube du XXe siècle, trois dynamiques de professionnalisation s’étaient développées parallèlement. Dans la première, la marque du professionnalisme demeurait l’accès aux postes dirigeants. La deuxième était davantage un mouvement de salariés proche du syndicalisme, où se trouvaient des ingénieurs nouvellement confrontés à des difficultés de carrière ou plus conscients de la banalisation de leur statut. La troisième s’appuyait sur la reconnaissance de compétences spécifiques et la connaissance d’un savoir ésotérique. Selon David Noble, les ingénieurs nord-américains construisirent leur identité professionnelle de façon conflictuelle, car ils se retrouvaient individuellement dans l’une ou l’autre dynamique de professionnalisation selon le métier qu’ils exerçaient, le lieu et le moment de leur parcours professionnel22.