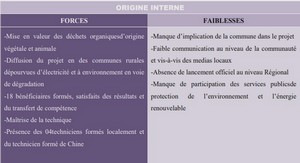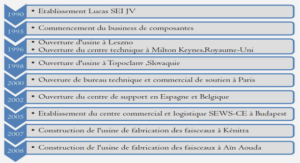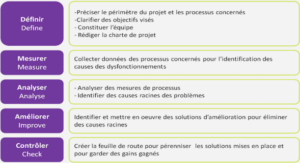De la guerre à l’amour
Mon Général, où est l’honneur?
Le dix sept février, Hassen Rabah se faisait capturer au cours d’une rafle surprise. Le commandement militaire lui arrachait par la souffrance des noms et des adresses. Remontant inexorablement les maillons de la chaîne, Massu extorquait des informations de toutes sortes : la réalité des pourparlers secrets entre le gouvernement et le FLN – dont il arrêtait les intermédiaires officieux scandalisés- les planques des plus hauts dirigeants de l’insurrection dont il manquait d’un fil l’arrestation, à l’exception Ben M’Hidi. C’était un des cinq chefs historiques, théoricien, tacticien de la révolution, idéaliste pragmatique , oranais, pour lequel Bigeard ressentit quelque affinité au cours des discussions professionnelles qu’ils eurent amicalement, avant qu’il ne donne l’ordre de le fusiller. Massu était arrivé à son but : la rébellion dans Alger était pratiquement matée. La population arabe, conditionnée, avait exprimé le plus gros de ses opposants. Il ne manquait à son tableau de chasse que Yacef Saadi, le renard de la Kasbah, qui se glissait de cache en cache et ne conservait de contacts qu’avec une poignée de fidèles. Yacef avait fait sortir de la souricière le plus gros de ses troupes les envoyant par petits groupes dans les Aurès prêter main fortement aux feddayin dans les opérations pour détourner l’attention d’Alger. Sauf Ben M’hidi le martyr, les quatre autres membres directeurs du Comité Exécutif s’étaient dispersés. Ces grands politiciens, à part Ben Bella maintenant emprisonné, se trouvaient à l’abri à l’étranger et disposaient des ressources considérables alimentées par les pays frères et par l’impôt révolutionnaire perçu par ses troupes. Yacef se retrouvait affaibli, isolé, sans moyen, avec un minimum d’hommes et de matériel. Mais il comprenait que s’il baissait les bras la victoire de Massu serait totale. Il décidait de continuer avec les débris de son armée, fractionnait ses effectifs dont deux jeunes filles intrépides et aguichantes expertes dans l’art de passer les barrages grâce à leur séduction.
C’est alors que déguisé en femme et escorté de ses derniers fidèles il tentait d’approvisionner en munitions son adjoint Ali la Pointe, qu’il tombait sur une patrouille des Zouaves de Costa. Elle capturait une des jeunes filles. Yacef tenta alors de la supprimer pour l’empêcher de parler. Il ouvrit le feu sur elle, la blessant grièvement. Lui parvenait à s’échapper dans le dédale des ruelles. Malgré le bouclage immédiat, Yacef disparaissait encore dans une de ses caches dissimulées dans les bas-fonds. Djemila, comprenant le geste impitoyable de Yacef, ne divulgua que des broutilles, malgré que par deux fois Yacef ait envoyé un tueur pour l’achever dans sa chambre d’hôpital.
Le FLN dans les montagnes de Kabylie, dans les Aurès, constituait à partir de la Tunisie de nouvelles troupes nombreuses et bien armées : plusieurs milliers d’hommes s’étaient infiltrés et menacèrent bientôt la sécurité du bled et des agriculteurs. Leurs embuscades retentissantes coûtaient la vie à une centaine d’appelés et à l’encadrement de métier – ainsi qu’à plusieurs centaines d’Algériens coopérants massacrés sur décision des politiques en exil. Bigeard et son 3° Régiment de Chasseurs Parachutistes repartirent dans les montagnes. Yacef à Alger sentit la pression faiblir. Aussitôt il passa à l’action : ses hommes assassinaient deux paras, affront suprême pour les troupes de choc, déclenchant la réaction escomptée : un massacre dans la population arabe. Une vague de réprobation contre l’armée s’enfla dans la métropole éloignée.
Le trois juin, trois lampadaires en fonte explosaient en plein cœur d’Alger aux arrêts d’autobus. Plusieurs dizaines de morts dont beaucoup d’enfants, une centaine d’estropiés avivaient la haine des Pieds-noirs.
Le dimanche suivant par une belle journée favorable aux déplacements et aux distractions dominicales, au Casino d’été, une énorme bombe était cachée par Ali la Pointe sous l’estrade où se produisait le grand orchestre de Lucky Starway, idole de la jeunesse algéroise. Il obtenait un résultat identique fauchant en majorité des adolescents des deux sexes ; le grand musicien était coupé en deux, une centaine de victimes étaient mutilées des jambes, quatorze furent amputées des deux membres.
La mesure n’était pas comble : à la douleur vinrent s’ajouter les outrages de la métropole. La population française, à l’abri et mal informée par les médias, condamnait l’emploi de la torture ainsi que la répression qui avaient permis de sauver des centaines de vies algéroises. Le gouvernement décidait d’envoyer Mendès France le liquidateur de l’Indochine pour censurer l’armée, rempart ultime entre la population et les tueurs. Les tractations sordides et souterraines entre le gouvernement en place et le FLN devenaient le secret de Polichinelle ; elles étaient menées par des politiciens parisiens ambitieux afin d’organiser le retrait bâclé de la France, et se faisaient dans le dos des principaux intéressés.
A Paris Ali Chekkal, la seule personnalité arabe luttant pour une osmose franco-algérienne, était assassiné sans égard par le FLN pour couper tous les ponts fraternels. Comble d’incompréhension le jour même de l’attentat horrible du Casino de la Corniche, René Coty président de la République signait par inadvertance la grâce de huit Algériens condamnés à mort pour faits de terrorisme sur la population française.
Les cercueils n’étaient pas fermés qu’une rage désespérée et inexorable montait dans le cœur des Petits-blancs prostrés. Leurs morts s’appelaient Perez ou Smadja ; ces communautés se trouvaient soudées dans la douleur des parents perdus ou mutilés, attisée par un sourd chagrin ressenti devant l’injustice méprisante ou tout au moins l’indifférence à leur sort démontrées par les journaux et la radio métropolitaine agités par le déplacement estival des centres médiatiques vers la Côte d’Azur. Le gouvernement impuissant avait tout juste assez d’énergie pour magouiller son maintien précaire alors que l’Algérie française se persuadait de plus en plus de son rejet réfléchi par la mère patrie, de son désir d’étouffer leur calvaire et même du souhait subconscient de leur mort libératrice que concrétisa plus tard, avec un grand courage, le Général de Gaulle prenant sur lui de trancher enfin ce nœud gordien.
ORAN 1958. Retour aux sources. 13 Mai 58
Comparée à Alger la ville d’Oran était un havre de paix; c’était un autre monde.
A son inverse les quartiers arabes se trouvaient en périphérie ; cela permettait aux communautés de conserver une certaine distance, une garde de sécurité. La circulation habituelle des Musulmans passait par l’extérieur de la cité limitant leur nombre dans le centre. Seuls la zone portuaire et le terminus des cars situé Place d’Armes entre la vieille ville et le centre actif, fourmillaient des travailleurs » indigènes « . Le centre ville resta d’ailleurs, jusqu’à l’exode, une zone presque réservée. Quelques particularités colorées disparurent les dernières années autant à cause des consignes du FLN pour plus de dignité que par crainte des ratonnades : les petits porteurs de couffins du marché de la Bastille, les jeunes cireurs de souliers batteurs et artistes de la brosse, leurs confrères adultes dont les véritables trônes siégeaient Place de la Bastille.
Les derniers à abandonner les traditions furent les vendeurs de journaux, messagers innocents des mauvaises nouvelles de Métropole : débats à l’ONU sur l’Algérie, reprises du projet de loi-cadre de Lacoste et du Collège Unique ( Algériens et Européens à égalité de vote), disgrâce de Salan qui avait trop bien réussi dans la maîtrise de la rébellion, malaises de l’Armée qui avait mal au cœur et ruait dans les brancards.
Gilbert retrouva avec plaisir sa ville natale, son ambiance bon enfant et hédoniste. C’était la veille de Noël. Au delà de toutes les turpitudes la population s’adonnait à son appétit de vivre et de consommer. Les magasins regorgeaient des produits métropolitains. Les vitrines illuminées et décorées étaient remplies des vêtements les plus élégants, des équipements de la maison les plus modernes et les plus sophistiqués. La souffrance d’Alger était égoïstement inhibée ; cela fit l’effet à Gilbert des ultimes réjouissances avant que le bateau sombre. Les gens n’étaient cependant pas dupes et dans une certaine classe, on se laissait aller à quelques confidences sur les petits voyages en France » pour visiter la famille « . Mais on revenait toujours, encore, les affaires étant merveilleusement prospères, l’argent circulait à une vitesse folle.
Armand, Clara et Henri avaient acheté un nouveau local commercial en plein cœur de la rue d’Arzew, la fameuse artère commerçante d’Oran qui fendait la ville comme on fend un gâteau. On l’avait rebaptisée rue du Général Leclerc, mais tout le monde continuait à l’appeler à l’oranaise, à l’ancienne « rue d’Arzeu ». Les « patos » (nouveaux Français arrivés), attirés par le boom économique et les investissements sociaux du gouvernement, prononçaient « Arzeuve » ou « Arzou » et cela faisait sourire ou s’esclaffer les Oranais, surtout au cinéma quand le publiciste d’Afric-Film, d’une voix mélodieuse et parisienne, mettait à côté du mille, en référence au Mineur qui lançait son pic dans la cible. Les cinémas ne désemplissaient pas, il fallait retenir ses places dès le jeudi pour le samedi soir et faire une longue queue, ou avoir ses relations. Aux entractes la foule agglutinée près du bar ou dans les cafés voisins paradait et comparait la valeur de ses oripeaux. Avant que les lumières ne s’éteignent, on avait le temps de se saluer, de se congratuler pour sa bonne mine de bourgeois enrichi; on se raccrochait encore au bonheur, quoi! sur le gouffre.
Le dimanche, les cloches de l’église Saint Esprit et de la Cathédrale rythmaient la farandole des voitures tourbillonnant dans un carrousel en sens unique rue d’Arzew, Place des Victoires, rue d’Alsace-Lorraine, Boulevard Clemenceau, pare-choc contre pare-choc, afin d’observer la promenade des piétons bigarrés, et réciproquement, et de lancer quelques compliments à l’espagnol aux fleurons féminins et ingambes faisant leur choix de cavaliers pour les sorties ou les danses de l’après-midi. On s’arrêtait en double file pour débiter son éloge, au grand dam des solitaires malchanceux et jaloux qui ne pouvaient encore se pavaner en compagnie des pimpantes oranaises fine fleur de l’émulsionnant cocktail algérien.
On allait retirer les boîtes de gâteaux réservés chez Hatton ou chez Cutillas à l’Épi d’Or spécialiste des meringues chantilly et des russes noisette-chocolat, le pain chez Dejoux ou Busquet. Les ménagères dont les maris n’avaient pas jugé nécessaire de les choyer dans un des innombrables restaurants de la ville ou de la corniche, tourbillonnaient au marché de la rue de la Bastille dans le choix des produits les plus fins et les plus frais, car on avait juste le temps de fignoler les arômes avant de mériter les compliments et les regards énamourés.
Ces petites saveurs, ces infimes morceaux du temps passé, ces bribes d’un présent ancien défunt, ces innocences impersonnelles et fugaces, ces sensations inconscientes qui remontèrent plus tard au cœur de Gilbert, furent les souvenirs qui le firent le plus pleurer quand il sût qu’elles étaient perdues à jamais. Plus que les immeubles abandonnés et les richesses du patrimoine spolié, plus tard ces réminiscences, invisibles sur le moment, insignifiantes ou même inexistantes pour certains, lui ravagèrent le cœur et le remplirent d’amertume. Jamais plus il ne retrouverait ces effluves naïves de sa jeunesse. Jamais plus il ne reverrait le décor de ses premiers émois, plus jamais il ne pourrait retrouver la coquille, l’écrin de son adolescence. Il se consolait en se disant qu’on en était tous là, les choses se transformaient, mais il ne pouvait s’empêcher de ressentir que sa ville natale, comme beaucoup de choses chères à sa mémoire, était morte, emportée à jamais dans le flot du temps et les destructions de l’histoire. Cela l’écorchait vif ajouté au reste plus tragique, comme une musique déchirante à laquelle il restait attaché volontairement et malgré lui.
Le nouveau magasin avait été baptisé « Reflets de la France ». Il était beaucoup plus grand et fonctionnel que celui des débuts épiques et aventureux de leur père. L’ancien magasin se trouvait Boulevard Clemenceau, dans l’autre artère commerciale de la ville, qui reliait le centre initial du début du siècle à l’agglomération moderne de sa seconde moitié. A une époque. elle avait été la percée par où étaient passés les premiers tramways remplaçant les omnibus à chevaux, et par où la cité, de 1920 à ces jours, avait germé et fleuri en rameaux vivaces, accaparant peu à peu tout le plateau, dans une explosion incoercible de constructions. L’on suivait la marche du temps comme dans une coupe de bois par les styles successifs des bâtiments qui rajeunissaient au fur et à mesure qu’ils s’éloignaient de la Place d’Armes (rebaptisée Place du Théâtre, puis Maréchal Foch) qui avait été le cœur primitif et ancestral des Pieds-noirs.