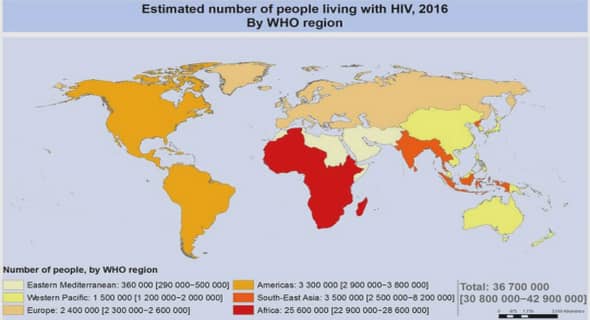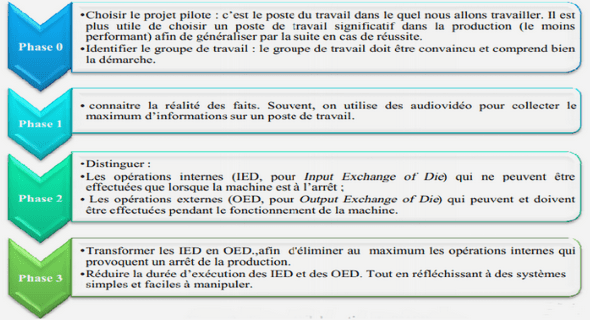L’apogée du mouvement environnementaliste
A la fin des années 1960, le mouvement environnementaliste, qui a commencé à se structurer dès la fin des années 1950, prend une ampleur tout à fait significative dans la société américaine. C’est d’abord sur les campus que germent des discours et des expérimentations en rupture avec la société de consommation ; puis la préoccupation environnementale gagne jusqu’aux sphères industrielle et gouvernementale, lesquelles se réapproprient les idées écologistes en les débarrassant de leur radicalité. Cette montée en puissance va culminer en avril 1970, avec le Jour de la Terre, avant que l’environnementalisme se scinde en plusieurs approches, témoignant de visions et d’intérêts distincts.
La poussée d’un « nouvel environnementalisme »
Dans la période qui nous intéresse, la poussée de l’environnementalisme en tant que mouvement social se traduit par une explosion des adhésions aux mouvements existants : en 1969 et 1970, le nombre de membres des cinq groupes conservationnistes les plus importants augmente de 16 à 18% par an. Celui des membres du Sierra Club triple entre 1966 et 19701. Cette période voit aussi la création de nouvelles organisations, à l’instar de l’Environmental Defense Fund (EDF), fondé en 1967 par les scientifiques du Laboratoire National de Brookhaven et l’avocat Victor Yannacone, dans les suites du procès de Long Island contre le DDT2, de Friends of the Earth, fondée en 1969 par David Brower, Directeur Exécutif du Sierra Club depuis 1952, ou de Greenpeace, fondée en 1972 à Vancouver autour d’un noyau de militants pacifistes et écologistes, mobilisés en 1971 contre les essais nucléaires en Alaska.
Ces nouvelles organisations rompent avec la veine préservationniste des anciennes structures pour promouvoir une écologie au service des intérêts sociaux (c’est suite au refus de la Société Nationale Audubon de soutenir leurs actions juridiques contre le DDT que les fondateurs de l’EDF décident de créer leur propre organisation1), appellent à une radicalité plus importante dans la défense de l’environnement (Brower accuse le Sierra Club de céder à une approche utilitariste de la nature, et de se compromettre avec le ministère de l’intérieur, les constructeurs de grands barrages et les compagnies électriques), et portent en elles les valeurs qui germent parallèlement dans la contre-culture : pacifisme, non-violence, critique du matérialisme et de la politique de profit promue par le gouvernement. A l’échelle locale, de nombreuses « éco-organisations » se développent sur les campus, qui contribueront au succès du Jour de la Terre en avril 1970.
Une enquête menée par le Wisconsin Survey Research Laboratory au début des années 1970 estime que le nombre de personnes engagées dans le mouvement environnementaliste, par le biais des divers groupes et associations, est de l’ordre de 5 à 10 millions (à l’époque, la population des États-Unis est de 200 millions environ)2. Les orateurs les plus fameux du mouvement, comme Ehrlich ou Commoner, se déplacent dans le pays pour donner des conférences à des assemblées pouvant compter jusqu’à 100 000 personnes3. Les expressions environnement » et « écologie » entrent dans la culture populaire, et ces thématiques connaissent un attrait grandissant. Entre la fin de la décennie 1950 et celle de la décennie 1960, le nombre d’articles qui portent sur des thématiques environnementales augmente de 300% 4, et en 1972 seulement, l’année de publication du rapport au Club de Rome, 300 ouvrages portant sur l’environnement, l’écologie et la pollution sont publiés aux États-Unis5.
L’environnementalisme germe dans le sillage du mouvement anti-guerre, qui se développe assez rapidement sur les campus, après l’envoi des premières troupes américaines au Vietnam en 19656, et qui, selon McCormick, révèle une population étudiante « informée, intelligente, idéaliste et sensible ». L’année universitaire 1967-68 voit ainsi 221 manifestations se tenir, sur 101 campus différents1. Pour McCormick, on assiste à la fin de la décennie 1960 à un transfert d’énergie des mouvements sociaux vers l’environnementalisme. Ce mouvement atteint alors son paroxysme chez des étudiants qui englobent derrière le concept d’écologie des valeurs plus larges et plus anciennes, qualifient d’ « anti-écologiques » des attitudes comme l’impérialisme et le racisme, condamnent l’industrialisme et questionnent la rationalité d’une société qui se sert de la science pour mener la guerre au Vietnam, contre la nature aussi bien que contre les humains : un huitième du pays est aspergé avec des défoliants chimiques. Des forêts et des rizières sont irrémédiablement détruites. On qualifie d’ « écocide » cette destruction systématique des écosystèmes, et on accuse la guerre et la crise environnementale de procéder de la même logique mortifère et technocratique.
Dans un mouvement environnementaliste qui n’est pas homogène, le discours des étudiants témoigne à la fois d’un élargissement des préoccupations et d’une radicalisation des approches. Le « nouvel environnementalisme » s’intéresse peu au concept de « wilderness » et accorde peu d’attrait à la nature en elle-même. Au contraire, il considère qu’il faut se soucier des problèmes écologiques parce qu’ils affectent les conditions de vie en société, et qu’ils découlent d’un système politico-économique nuisible, qui doit être combattu. Cette approche est marquée par l’écologisation de la « New Left », qui n’est pas uniforme, mais qui s’opère de manière significative à partir de 1965, incarnée par le personnage de Ralph Nader, lequel publie cette année-là un plaidoyer contre la voiture, dénonçant le « droit à polluer » que cautionne sa société : Unsafe at any speed2. A la fin de la décennie 1960, plusieurs théoriciens de la New Left rejoignent Nader pour attaquer les firmes polluantes, et la concentration du pouvoir dans le monde des affaires. On assiste à ce moment-là à une convergence des discours issus de la contre-culture hippie et de la New Left, sur la nécessité de ruptures profondes avec la société industrielle, pouvant passer par des actes radicaux (ruptures de pipelines, destructions d’usines chimiques…). Jusque là, les dissensions entre la contre-culture et la Nouvelle Gauche portaient principalement sur la question des leviers pour amorcer un changement de société. Tandis que les hippies appelaient à un « retour à la terre », l’expérimentation de la vie communautaire, et de manière générale à la transformation de soi, les représentants de la Nouvelle Gauche considéraient que le changement devait avant tout passer par la voie politique : changer la société avant de se changer soi-même3.
Cette convergence s’appuie sur des visions du monde partagées, qui imputent la détérioration environnementale au système capitaliste de maximisation du profit. Les « New Leftists » tout comme les représentants de la contre-culture font le lien entre les pressions à consommer plus, dans une « société de déchets » qu’ils condamnent, sous l’effet de ce que Marcuse appelle « la manipulation des besoins », et les dangers de la production. Plusieurs collectifs écologistes de la Nouvelle Gauche sont organisés à la fin de la décennie 1960 pour se focaliser sur la question des déchets, et contribuent fortement à la formation de centre de recyclage communautaires, qui deviennent ensuite des centres d’action environnementale. Cette « écologisation » ne touche pas la Nouvelle Gauche dans son ensemble, et certains groupes demeurent méfiants vis-à-vis de concepts écologistes anciens, comme celui de la wilderness », qui témoigne selon eux d’un élitisme anti-urbain. Il y a donc une tension entre l’approche écologiste de la New Left, qui incrimine les industriels dans la destruction de l’environnement, et d’autres approches moins différenciées, comme celle du Sierra Club dont le slogan « We have met the enemy, and he is us », témoignent d’une accusation indistincte de la population occidentale et de l’industrie dans la destruction écologique. Il y a par ailleurs une vive critique, au sein de la Nouvelle Gauche, pour les politiques démographiques promues par les fondations industrielles, qui sont conçues comme des obstacles au développement des pays pauvres1.
Un « nouvel environnementalisme » focalisé sur l’humanité
Ce qui est certain, c’est que l’influence de la Nouvelle Gauche et de la contre-culture sont décisives dans la formation d’un « nouvel environnementalisme », comme l’exprime Gottlieb : « représentant un interlude entre le vieux conservationnisme avec sa recherche d’une wilderness gérée ou protégée, et un environnementalisme urbain et industriel caché qui n’[a] pas encore complètement coalescé en un mouvement organisé, la contre culture, avec la Nouvelle Gauche, [sert] de transition vers une nouvelle politique environnementale dans laquelle la question de la Nature ne [peut] plus être séparée longtemps de la question de la société elle-même »2. Nouvelle Gauche et contre culture sont l’émanation d’une population cultivée, aisée, urbaine : le mouvement environnementaliste n’est pas dénué d’un certain élitisme » social. En témoignent un sondage Gallup de 1969, selon lequel le souci de l’environnement est davantage le fait des personnes ayant poursuivi des études supérieures (62%, contre 39% dans le reste de la population), et de personnes privilégiées économiquement (58% de la population gagnant plus de 10 000 $ par an se dit préoccupée par l’environnement, contre 41% de celle gagnant moins de 5 000 $ par an)1. Une autre enquête, menée au sein du Wisconsin Survey Research Laboratory, témoigne de la même tendance, et rapporte également une homogénéisation du souci de l’environnement dans la population états-unienne, entre 1968 et 1970 : cette brève période voit la préoccupation écologique croître dans toutes les catégories sociales, et particulièrement dans la classe des personnes ayant poursuivi les études les plus courtes, qui a tendance à rattraper les catégories les plus éduquées2. Le phénomène qui contribue le plus à la généralisation de la conscience écologique dans le monde anglo-saxon est vraisemblablement la multiplication de catastrophes, très médiatisées, dans la seconde moitié de la décennie 1960. En octobre 1966, un terril explose au Pays de Galles et cause la mort de 144 personnes. En mars 1967, le naufrage du Torrey Canyon, au large de l’Angleterre, déverse dans l’océan 119 000 tonnes de pétrole brut. L’usage de détergents non encore bien maîtrisés, pour nettoyer le pétrole sur les côtes, aggrave la situation. En 1969, l’explosion d’une plate-forme pétrolière au large de Santa Barbara fait la une des médias, qui diffusent les images de plages couvertes de pétrole. La très mauvaise condition du Lac Erié est aussi emblématique de la destruction des écosystèmes par l’industrie, et Commoner y consacre une partie importante de son ouvrage de 1971. Les empoisonnements au mercure qui continuent dans la baie de Minamata, au Japon, sont également portés par le mouvement écologiste comme des symptômes d’un système politico-industriel à condamner. Pour McCormick, si les catastrophes environnementales ne sont pas nouvelles, elles surviennent en tout cas à une période où la population états-unienne, déjà sensibilisée à l’environnement, s’en saisit comme des emblèmes d’une société qui dysfonctionne, et se mobilise en réaction à elles : « l’effet de ces désastres environnementaux a été d’attirer une attention publique plus large aux menaces sur l’environnement. Les gens étaient sensibilisés aux coûts potentiels d’un développement économique négligent, et ont alors prêté un soutien grandissant à toute une série de campagnes locales et nationales, auxquelles les médias donnaient souvent une large attention. Aux États-Unis, par exemple, il y avait débat à propos d’un projet d’aéroport à proximité du Parc National des Everglades, à propos du projet de pipeline trans-Alaska, du plomb dans le gasoil, et des phosphates dans les détergents »1.
L’intérêt universitaire pour la « crise environnementale »
A la fin de la décennie 1960, on assiste en Amérique du Nord, dans le milieu de la recherche, à une explosion d’intérêt pour l’écologie et de la crise de l’environnement. Dans les universités, en lien avec les fondations privées et les institutions gouvernementales, se multiplient les conférences et les symposiums sur le sujet. Ainsi, l’Université de Calgary organise en mai 1968 une conférence de deux jours sur « l’homme et son environnement », qui porte principalement sur la question de la pollution, et qui implique aussi bien des universitaires que des responsables politiques et des industriels2. En 1969, l’Institut des Sciences Environnementales du College d’État de San Jose, en Californie, organise une série annuelle de conférences qui porte exactement le même titre : « l’homme et son environnement », avec comme sous-titre « interaction et interdépendance »3. Au cours de l’année 1968-69 se tient à l’Ecole Forestière de Yale, avec le soutien de la Fondation Ford, une série de conférences sur le thème de « la crise environnementale »4. Ce titre est aussi celui d’un symposium qui a lieu en décembre 1969 à l’Université de Dakota du Nord, ainsi que de deux conférences, qui ont lieu en mars 1970 à Chicago5, et en 1971 au sein de la Société Américaine pour l’Administration Publique. A cette même période se mettent en place des cours et des formations sur les questions environnementales. A titre d’exemple, l’ACEE (Action Committee for Environmental Education) est formé dans le Dakota du Nord en 1968 avec comme objectif de diffuser l’éducation environnementale à toutes les écoles de l’État. Entre 1967 en 1970 se multiplient les programmes éducatifs sur l’environnement. A l’échelle des États-Unis, le sénateur démocrate Gaylord Nelson et le congressiste républicain Paul McCloskey mettent en place conjointement un « teach-in » national sur « la crise environnementale », dans la préparation du Jour de la Terre d’avril 1970.
Les conférences et les séminaires qui se tiennent au cours de la période sont en général organisés par des structures universitaires qui ont à voir avec l’écologie1, comme l’Ecole Forestière de Yale, ou bien l’Institut pour les Sciences Environnementales du College d’État de San Jose. Elles sont financées par des fondations, éventuellement industrielles, comme la Fondation Ford, ou bien par des organisations liées à la préservation de l’environnement, comme la Société Audubon ou le Sierra Club. Les intervenants proviennent le plus souvent du monde académique ; les biologistes et les écologues sont particulièrement représentés, mais également les spécialistes de sciences humaines et sociales (géographes, historiens, économistes). Des représentants des institutions administratives d’État et fédérales participent également.
Les présentations données en ces occasions sont parfois extrêmement spécialisées, la plupart du temps lorsqu’elles relèvent de l’écologie scientifique et s’attachent à décrire les différentes sources de pollution, leurs effets sur les écosystèmes et les moyens de les contrôler ; mais on observe également un grand nombre d’interventions qui adoptent une posture générale et alarmiste à propos de la « crise environnementale », en conformité avec le discours des « prophètes de la catastrophe ». L’introduction de l’ouvrage rapportant les diverses interventions faites au symposium de l’Ecole Forestière de Yale annonce clairement le positionnement de ses organisateurs : pour eux, des problèmes divers tels que la pollution, ou bien l’urbanisation sauvage, constituent la face visible d’une situation dramatiquement menaçante, nommément, « la destruction potentielle de tout le système naturel équilibré qui permet de maintenir la vie » sur Terre. Ce qui est en jeu, c’est « la qualité, et l’existence même de la vie ». Il s’agit là « du problème central de l’être humain moderne »2. Dans la même veine, l’intervention de G.A. Sherwood, au séminaire qui se tient au College Bismarck Jr., dans le Dakota du Nord, cherche à alerter sur l’extinction possible de l’espèce humaine3.
Si la perspective adoptée dans les séminaires et conférences de la période témoigne parfois d’une approche des problèmes écologiques en termes de solutions technologiques, comme c’est le cas à la Conférence co-organisée par l’Université de Calgary et l’Institut d’Ingénierie du Canada, on observe généralement une critique assez vive du système techno-industriel, et un appel à une refondation profonde des rapports entre l’être humain et son environnement. Ainsi, les organisateurs du symposium de Yale désignent comme responsable de la crise, conjointement avec la poussée démographique mondiale, « la technologie sans limites couplée à une attitude de domination et d’exploitation de [l’]environnement »1. Dans une intervention intitulée « The Plight » (« La situation désespérée »), le professeur d’architecture des paysages, Ian L. McHarg, dénonce les travers d’une société occidentale vouée aux lois de l’économie, où le chacun pour soi et le court terme constituent la règle2. Il condamne l’attitude « pré-copernicienne » qui est prégnante dans le rapport de cette société à la science, et qui implique un rapport de domination et de « vengeance » vis-à-vis des créatures non humaines de la Terre. Dans une intervention intitulée « Man against nature : an outmoded concept » (« L’être humain contre la nature : un concept démodé »), le géographe Clarence J. Glacken essaie de construire la généalogie du rapport moderne de l’être humain à la nature, ainsi que les résistances qui ont émaillé ce processus historique. Dans sa conclusion, il appelle à refonder ce rapport en considérant l’être humain comme partie intégrante de son écosystème.
A la série de conférences de San Jose, on décèle les mêmes accents, dans l’intervention du biologiste H. Thomas Harvey par exemple : « Le changement majeur doit être un changement d’attitude […]. Nous devons changer notre hypothèse selon laquelle nous avons affaire à une crise qui admet une solution technique »3. Werner A. Baum, Président de l’Université de Rhode Island, écrit quant à lui que « la détérioration de [l’]environnement physique est un résultat des avancées technologiques, qui sont accompagnées par un important développement économique »4. J.Y. Wang, Directeur de l’Institut des Sciences Environnementales, considère que « la technologie moderne a avancé jusqu’à un seuil si critique que l’espèce humaine va s’éteindre, soit quand elle aura épuisé les ressources naturelles […] soit quand elle aura détruit entièrement l’équilibre écologique »5. Dans sa présentation, il considère toutes les menaces sur l’espèce humaine comme causées par des déséquilibres, dans les écosystèmes et dans les systèmes sociaux.
En conséquence de cette condamnation d’un rapport au monde anthropocentré, qui menace la survie même de l’espèce humaine, les intervenants aux séminaires que nous mentionnons appellent à une refondation du système socio-économique sur des bases écologiques. C’est naturellement le cas de Kenneth Boulding, qui expose au séminaire de Yale son concept de « spaceship economy », mais aussi celui du juriste Joseph L. Sax, qui reprend cette expression. Au séminaire de San Jose, le biologiste H. Thomas Harvey et le Président d’Université Werner A. Baum soulignent la pertinence du concept. Enfin, l’écologue J.Y. Wang développe tout un projet de transformation sociale qui repose sur cette notion, et qui nous intéresse particulièrement dans la mesure où il repose sur un processus de modélisation : il s’agirait, dans un premier temps, de collecter et d’évaluer les données relatives à la situation écologique, afin de mettre en place une première série de modèles mathématiques. Dans un deuxième temps, il s’agirait de mettre en place une grande enquête de terrain sur l’environnement. Enfin, dans un troisième temps, « en utilisant les données de court terme de l’enquête de terrain et les données historiques de long terme, une série de modèles systémiques [seraient] conçus. […] Des projections des effets à long terme, pour une période de 5, 10 ou 20 ans ou plus, [devraient] être réalisées. Ces projections [serviraient] de feedback au modèle original, pour mettre en place des modifications », lesquelles auraient lieu jusqu’à ce que le système économique devienne « un système fermé »1, c’est-à-dire une économie en conformité avec le fonctionnement des écosystèmes, dont les processus seraient réversibles, au contraire des processus des industries modernes.
Dernière tendance qui émane des interventions des séminaires de l’époque, l’importance accordée au savoir et à la réflexion dans la transformation écologique de la société, et également, l’insistance généralisée sur le bien-fondé de l’interdisciplinarité, pour mener à bien cette transformation.
Au séminaire de Yale, les organisateurs mentionnent le rôle de l’Université pour apporter des éléments et stimuler la réflexion sur la crise écologique2 ; le congressiste Emilio Q. Daddario appelle à la mise en place d’une politique de recherche à l’échelle nationale qui considérerait la qualité environnementale comme très grande priorité pour le pays3 ; le géographe Clarence J. Glacken prône une refondation philosophique de la place de l’homme dans la nature, « un thème vénérable, qui doit être l’objet d’une nouvelle synthèse »4. Au séminaire de San José, le Président d’Université Werner A. Baum envisage les universités comme des lieux ouverts sur le monde extérieur, qui doivent contribuer à la formation des représentants politiques en matière d’environnement1.
Dans son intervention à Yale, LaMont Cole appelle à un effort coopératif des biologistes, des physiciens, des psychologues, des économistes et des politistes2 pour réfléchir à la crise environnementale. Au séminaire de San Jose, Baum condamne la spécialisation et la compartimentation de la recherche et de l’enseignement dans les universités, qui empêchent selon lui le développement d’une connaissance satisfaisante de l’environnement. L’écologue Wang considère quant à lui que « l’éducation supérieure actuellement disponible n’accorde pas assez d’importance à l’interaction entre les aires disciplinaires », et que « la division des cours dans les sciences naturelles […], et dans les sciences sociales […] sont artificielles3 plutôt que naturelles »4.
La rupture de 1970
Les élaborations intellectuelles et les expérimentations sociales que nous avons décrites concourent au développement d’un mouvement de masse qui culmine en avril 1970, avec le Jour de la Terre, la plus grande manifestation d’un jour de l’Histoire des États-Unis, avec 20 millions de participants. La couverture médiatique, énorme, annonce que l’environnementalisme est devenu l’enjeu majeur de l’époque. L’événement est centré sur les campus, avec l’organisation de « teach-in » dans 1500 « colleges » universitaires, dans lesquels s’investissent notamment Commoner et Ehrlich. Il implique aussi les écoles – 10 millions d’enfants bénéficient ce jour-là de programmes spécifiques -, et mobilise très fortement la population urbaine : dans la capitale, un rassemblement géant a lieu au Washington Monument, avec des concerts de musique folk et des discours à la gloire de la Terre. A New York, le trafic est coupé dans une grande partie de la ville, et en particulier dans la Cinquième Avenue, transformée en trottoir géant. Dans tout le pays, on se rassemble dans les parcs, devant les écoles, les bâtiments des entreprises et du gouvernement. On assiste à une multiplication d’actions symboliques : dans plusieurs universités, dont celle de Californie du Sud, on enterre des voitures. A Louisville, 1500 étudiants se rassemblent dans une manifestation censée illustrer les dangers de la surpopulation, où ils se compriment les uns contre les autres. On porte des fleurs ou des masques à gaz. A San Francisco, on déverse du pétrole dans la fontaine du Quartier Général de Standard Oil. A New York, on transporte des poissons morts pour symboliser la pollution du Hudson. A l’Université d’État de l’Iowa, où Ehrlich tient un discours devant 10 000 personnes, on organise un vaste lâcher de ballons qui portent l’inscription « stop at two ».
En apparence, l’événement est très consensuel. Selon le New York Times, « les Conservateurs étaient pour. Les Libéraux étaient pour. Les Démocrates, les Républicains, et les Indépendants étaient pour. De même pour […] les branches exécutive et législative du gouvernement »1. On observe que les initiatives proviennent aussi bien du monde industriel et de l’administration politique, que des associations et des campus. Du côté du gouvernement américain, on a pris conscience dans les mois précédents de la signification politique du mouvement environnementaliste, et de la nécessité de porter un discours satisfaisant les revendications populaires. C’est ainsi que dans son « Message sur l’État de l’Union », adressé en janvier 1970 (comme chaque année à la même période), Nixon a évoqué l’environnementalisme comme « le nouvel altruisme », et a proclamé la nécessité de « faire la paix avec la nature », en réparant les dommages faits à l’air, à l’eau et à la terre. Selon Gottlieb, si ce discours était dans les faits peu accompagné de mesures effectives et de financements adéquats, il avait pour fonction d’accommoder la « majorité silencieuse » du Président : « ces électeurs de la classe moyenne et de la classe ouvrière, qui tout en étant hostile aux mouvements anti-guerre, pour l’émancipation des Noirs, de la Nouvelle Gauche, et de la contre culture, étaient néanmoins préoccupés par l’environnement, comme les sondages de l’époque le montraient »2. C’est dans cette perspective que l’administration politique aussi bien que le monde des affaires soutiennent, dans leur discours, le Jour de la Terre3. Les industries de l’emballage, du papier, de la chimie, de l’automobile, et particulièrement les industries de l’électricité, profitent de l’occasion pour essayer de redorer leur blason, en s’engageant à mettre en place des dispositifs de dépollution, et en finançant certains événements du 22 avril. L’entreprise Monsanto assure ainsi qu’elle va devenir motrice en matière de dépollution.
Le Jour de la Terre témoigne donc d’une réappropriation-transformation du discours écologiste, par des acteurs politiques et industriels qui cherchent à le débarrasser de sa critique radicale du système capitaliste et technologique. Les médias, qui relaient massivement l’événement, renforcent cette conception de l’écologie : sous leur influence, l’environnementalisme est devenu un mouvement sans histoire, avec une base sociale amorphe […] L’interprétation du Jour de la Terre comme le jour numéro un du nouvel environnementalisme reflétait […] la conception ‘fix-it’1 des médias. Cette approche, même si elle devait s’avérer immense et coûteuse, permettrait finalement à tout le monde, qu’il s’agisse de l’industrie, du gouvernement, ou des citoyens, de participer à l’amélioration du système »2. Mais les militants écologistes, étudiants en particulier, ne sont pas dupes, et les orateurs du gouvernement et des entreprises subissent en plusieurs lieux des attaques et des manifestations spontanées. A l’Université de l’Alaska, le ministre de l’Intérieur, Walter Hickel, est évincé de la scène où il tient son discours, lorsqu’il mentionne le soutien de son administration à la pipeline trans-Alaska. A Denver, des militants antinucléaires décernent le Colorado Environmental Rapist of the Year award » à la Commission à l’Energie Atomique. En Floride, on dépose une pieuvre morte au quartier général de Florida Power&Light, la compagnie responsable de la pollution technique de Biscayne Bay. Par ailleurs, malgré les efforts de l’administration Nixon pour séparer les questions environnementales de celles liées au Vietnam et au racisme, certains discours débordent de ce cadre. A Washington, Hayes, l’organisateur du Jour de la Terre, qualifie ainsi la Guerre du Vietnam de « catastrophe écologique », et suggère que « les personnes politiques et du monde des affaires, qui sont en train de se ranger du bon côté sur la question environnementale, n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent. Ils parlent de filtres sur des cheminées d’usines tandis que nous défions l’irresponsabilité des industriels »3. Selon Egan, le Jour de la Terre constitue un feu de paille, qui n’est pas vraiment suivi d’effets durables. Il rapporte que huit jours après le 22 avril, Nixon annonce sa décision d’envoyer des troupes militaires au Cambodge, et qu’à partir de là, l’opinion publique se focalise sur d’autres problématiques que l’environnement4.
Il s’agit d’une approche qui prétend résoudre les problèmes écologiques sans remettre en question le système socio-technique qui les a produits, mais plutôt par le biais d’aménagements en marge de ce système.
Pour les historiens du mouvement environnementaliste, 1970 constitue un point de rupture. Sills rapporte des travaux sociologiques démontrant que cette date a constitué un pic du point du soutien de la population à l’écologie, et l’amorce d’un déclin1. Il mentionne l’effondrement rapide d’une demi-douzaine de magazines consacrés à l’environnement, nés dans la foulée du Jour de la Terre. Selon lui, cet apparent reflux du mouvement environnementaliste masque en réalité sa transformation en un dispositif plus institutionnel et moins radical politiquement.
C’est également l’analyse de Gottlieb, pour qui 1970 marque la cristallisation du mouvement en deux grands courants : un premier courant qualifié de « mainstream », qui témoigne à la fois d’une professionnalisation et d’une institutionnalisation du discours et de l’action environnementale, d’autre part un courant qualifié d’ « alternatif », qui émane « de la base » [grassroots], fondé sur l’action directe2. Le premier courant est à mettre en lien avec le développement d’un dispositif institutionnel et juridique, qui se structure à partir de 1970 avec le NEPA, et qui se renforce entre 1970 et 1974, avec un développement important de lois et de systèmes de régulation, sous l’effet des mouvements liés à la consommation, comme celui de Ralph Nader, ou de la pression militante d’avocats et de scientifiques. Ces nouveaux acteurs de l’environnementalisme ne se contentent pas de faire pression pour l’adoption de lois, ils militent également pour leur application. Le rapport au droit devient donc particulièrement crucial dans le développement de cet environnementalisme « mainstream », qui sollicite des juristes mais aussi des scientifiques pour mener des expertises. Cet environnementalisme n’est pas complètement indépendant des financements industriels. La Fondation Ford, notamment, apporte son soutien aux nouvelles organisations qui se forment, tout en exigeant de contrôler l’action des groupes qu’elle subventionne.
Pour Morrison, les environnementalistes évoluent vers 1970 d’une stratégie « de participation » qui consiste à miser sur l’éducation et la persuasion pour provoquer des changements de comportement au niveau individuel, vers une stratégie « de pouvoir », qui consiste à former des groupes de pression pour influer sur l’adoption et l’application de lois, mais aussi pour forcer les industriels à revoir leurs pratiques, par le biais de campagnes de lettres ou de boycott3.
Morrison comme Gottlieb évoquent l’émergence parallèle d’un mouvement environnementaliste plus radical, qui hérite de certaines conceptions et pratiques antérieures à 1970. Ce mouvement est plus local, participatif, fondé sur l’action, et critique les rôles de l’expertise et du lobbying pour définir un agenda environnemental. Il se fonde sur les idées d’ « empowerment », qu’on peut traduire par « autonomisation », des groupes et des individus, par rapport au système économique, mais aussi de justice environnementale, et de restructuration industrielle et urbaine. Pour les avocats de ce mouvement, qui sont influencés par la pensée de Ralph Nader et de Barry Commoner, il ne s’agit pas de réguler la pollution, mais de repenser les systèmes socio-techniques de production. Il s’agit également de promouvoir l’investissement citoyen dans les questions industrielles et politiques, ce dont témoignent les « PIRGs » (Public Interest Research Groups), un réseau fondé par Nader en 1970, qui mène des campagnes sur des thèmes très variés, et sollicitent le travail de chercheurs et de doctorants sur des thématiques scientifiques aux enjeux politiques déterminants.
La crise écologique dans les œuvres de fiction
Au tournant des années 1970, si la thématique de la guerre nucléaire reste omniprésente dans les œuvres de fiction apocalyptiques et post apocalyptiques, on voit pointer la thématique de la catastrophe écologique. Nous mentionnons ici deux films significatifs de cette période.
En 1973, le film de Richard Fleischer, Soylent Green (traduction française : Soleil Vert) témoigne de la préoccupation pour l’épuisement des ressources, et en particulier des ressources alimentaires. Il est fondé sur le roman Make room ! Make room ! de Harry Harrison, paru en 1967. L’intrigue se déroule sur une Terre ravagée par les générations d’humains qui s’y sont succédé. La vie animale et végétale y a pratiquement disparu. A New York, les derniers arbres, qui poussent sous une serre, sont accessibles seulement à quelques privilégiés. Les personnages se souviennent avec nostalgie de la nourriture d’antan, et s’alimentent avec les pastilles vertes qu’ils peuvent obtenir, dans des quantités jamais satisfaisantes, en faisant la queue de longues heures sur le marché : les « Soleil Vert », ou Soylent Green » en anglais, qui sont censées être fabriquées avec du plancton océanique. Le déroulement du film est sordide, mais sa chute assombrit encore le tableau : le protagoniste principal apprend en effet que les pastilles sont fabriquées en réalité avec la chair des personnes âgées qui décident de se faire euthanasier. Il n’y a plus de soja (« soy »), plus de lentilles (« lent ») ; l’océan a été vidé des éléments vivants qui le composaient. L’industrie s’est également effondrée, et ses vestiges sont devenus très rares : un livre, une montre…
Dans New York ne répond plus, un film post-apocalyptique réalisé en 1975 par Robert Clouse, l’intrigue laisse deviner que les êtres humains ont enfreint des lois écologiques et ont détérioré de manière irréversible les écosystèmes, mais le récit ne permet pas de savoir ce qui s’est passé exactement. Les personnages vivent dans un monde dévasté comme celui de Soleil Vert ; les maisons sont défoncées ; dans les rues subsistent des autobus écroulés, hors d’usage, tandis que les personnages se déplacent à pied et qu’aucune industrie ne persiste. Dans les tunnels du métro, devenus des voies secrètes de communication pour sortir de la ville, des wagons se tiennent, à l’abandon, les vitres cassées, couverts de toiles d’araignée. Les couloirs du métro, déserts, sont jonchés de morts portant des masques à gaz, et de pendus. Dans la terre, qui a été empoisonnée par des infections, on ne peut plus rien faire pousser. La nourriture est donc rationnée, ce qui est la cause de révoltes et d’affrontements violents.
Avant la publication du rapport des Limites, la critique du discours environnementaliste
La publication du rapport des Limites, en 1972, va susciter de nombreuses objections et oppositions, dont nous traiterons dans le Chapitre VII. Nous voulons montrer ici qu’un certain nombre des arguments qui seront alors développés sont déjà présents avant la publication du rapport, dans des critiques explicites de la pensée écologiste.
Les critiques du discours écologiste et, plus généralement, les critiques du discours qui affirme l’existence de limites au « développement » humain sur Terre, voient leur nombre exploser dans la foulée de la publication du rapport des Limites. Dans la période antérieure, ces critiques sont plus rares, mais certaines d’entre elles annoncent clairement les positions qui se structureront ensuite. C’est le cas de l’ouvrage de John Maddox, The Doomsday Syndrom, publié en 1972, mais qui n’accorde qu’une postface au rapport des Limites, l’ouvrage lui-même ayant été rédigé avant la publication de ce dernier. Son auteur, britannique, physicien et chimiste de formation et éditeur de Nature, s’attaque de manière systématique à tout un ensemble de discours qu’il qualifie de catastrophistes, et ses arguments anticipent en grande partie ceux des critiques des Limites. C’est également le cas de l’article Six propositions on the poor and pollution », de Martin Krieger, du Centre de Planification et de Développement et du Département d’Architecture des Paysages de Berkeley1, qui annonce la critique sociale de la thèse des « limites », et de deux articles du démographe Ansley Coale, qui anticipent la critique économiciste et techno-optimiste de cette thèse2. Ces quatre critiques étant de longueurs très inégales, il sera ici davantage question du premier que des trois autres.
Chez Maddox, l’argument omniprésent est que les écologistes catastrophistes3 exagèrent la gravité des problèmes qu’ils pointent. Pour lui, leur diagnostic sur l’état de la planète, mais de manière plus générale, la description qu’ils font du fonctionnement des écosystèmes, sont à remettre en question : il est selon lui exagéré d’invoquer la fragilité des interrelations entre les humains et leur environnement, ainsi que des lois systémiques selon lesquelles « le tout est plus que la somme des parties ». Il s’agit là, pour lui, d’une approche qui complique excessivement l’approche du monde. Si les baleines bleues disparaissent, écrit-il, cela n’affecte nullement l’avenir de l’existence humaine sur Terre. En réponse au discours sur la complexité des écosystèmes, Maddox met en avant la « résilience » de la planète Terre, sa capacité à « digérer » les événements perturbateurs pour restaurer son état d’équilibre. Il mentionne à plusieurs reprises le caractère négligeable des effets des activités humaines sur la planète, comparé à celui des activités naturelles : selon lui, « leur échelle est bien chétive comparée à celle de l’enveloppe de la Terre dans laquelle existent les êtres vivants »4. Pour lui, cette situation n’est pas près de changer, et la vie sur Terre ne disparaîtra qu’au moment où le rayonnement solaire changera de manière cruciale : « à cette échelle [celle de la planète], le potentiel auto-destructeur de la technologie terrestre va demeurer chétif encore longtemps »5.
En conséquence, Maddox considère que l’hypothèse d’un changement climatique (que bien peu de météorologues soutiendraient) induit par les activités anthropiques relève d’une tendance pathologique à la construction de scénarios d’horreur1. De même, l’idée que l’usage des pesticides pourrait remettre en question la persistance de la vie sur Terre est complètement exagérée, et Rachel Carson, si elle a raison de pointer certains dangers liés à leur utilisation, n’en joue pas moins un « tour littéraire » à ses lecteurs lorsqu’elle décrit au début de son ouvrage une campagne imaginaire dans laquelle tous les oiseaux ont disparu2. De même, l’hypothèse d’une détérioration de la couche d’ozone en lien avec les transports supersoniques est pour lui erronée, puisque si celle-ci peut se dégrader, elle peut également, de la même manière, se reconstituer. Pour Maddox, toutes ces projections catastrophistes, en grande partie exagérées, sont à mettre sur le compte – psychanalytique – des peurs suscitées dans la période de l’après-guerre par le développement de la bombe atomique : sans s’en rendre compte, les catastrophistes ont transposé des représentations associées au danger nucléaire aux pollutions en général. Ils perçoivent par exemple le DDT comme un poison secret et insidieux, qui menace l’existence de la vie sur Terre, et « il serait faux de penser qu’aucun des nouveaux produits chimiques n’est nocif, mais une grande part de l’anxiété qui les entoure émane d’une analogie complètement fausse avec la radioactivité »3. C’est ainsi qu’on a banni, aux États-Unis, des additifs alimentaires appelés « cyclamates », ainsi qu’un herbicide censé provoquer des malformations, le 2, 4, 5-T, sur la base de peurs largement infondées.