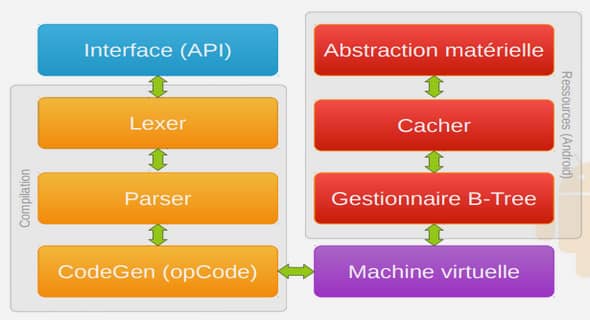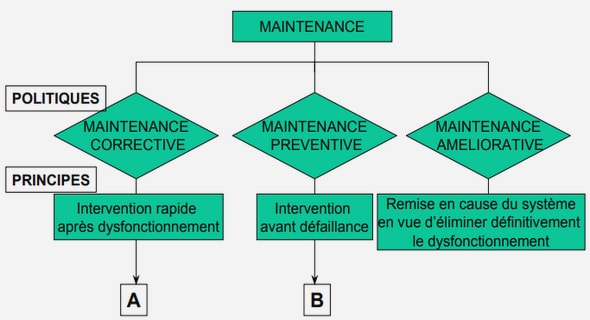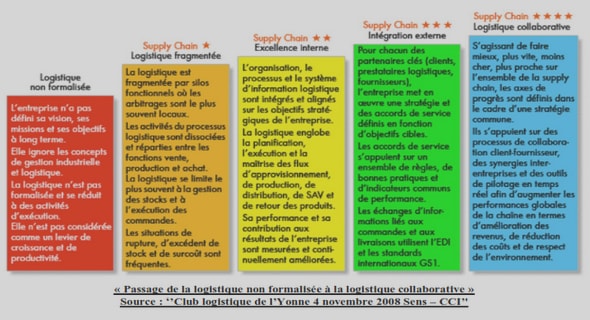Études antérieures
La consultation de SUDOC5 et de theses.fr nous a appris qu’il n’existe pas d’études ni de thèses produites en France sur Marika Stjernstedt. En Suède, la thèse de Sofi Qvarnström intitulée Motståndets Berättelser: Elin Wägner, Anna Lenah Elgström, Marika Stiernstedt och första världskriget (soutenue en 2009) présente des articles de journaux et brochures écrits par les femmes de lettres susnommées et publiés uniquement en Suède pendant la première guerre mondiale.
Elin Wägner mais ce n’est que pour affirmer « qu’elle n’est pas citée dans la presse française de [1870 à 1914]7» contrairement à ses compatriotes. Marika Stjernstedt est donc évoquée sans y être étudiée.
Dans le champ d’études suédois, l’ouvrage dirigé par Yvonne Leffler, Swedish women’s writing on export8, propose un aperçu de la réception de plusieurs écrivaines suédoises en Angleterre, en Allemagne et en France. Marika Stjernstedt y est également mise de côté au point d’en être totalement absente, au profit notamment de Selma Lagerlöf, Anne Charlotte Leffler ou Fredrika Bremer qui y sont très bien présentées ainsi que leur travail. À notre connaissance, il n’existe donc aucun travail scientifique9 traitant même partiellement de la réception de Marika Stjernstedt.
Notre mémoire fait l’inventaire et la présentation d’articles qui n’ont jamais été rassemblés ni examinés en tant qu’un tout. De ce fait, l’étude croisée de ces sources consacrées à Marika Stjernstedt devrait apporter de nouvelles informations et perspectives quant à la littérature féminine suédoise d’expression française et sa réception sur support presse en France.
Méthode
Pour obtenir toutes les coupures de presse dans les journaux et quotidiens de l’époque d’étude, nous avons fait une recherche dans la base de données de Gallica de la Bibliothèque nationale de France. À partir du prénom et du nom de l’auteur, nous avons obtenu 85 postes d’entrée. Ce corpus général ou premier corpus englobe les journaux, revues et annuaires. Nous précisons qu’il regroupe des périodicités de publications allant des quotidiens aux annuels.
Leur périodicité n’ayant pas constitué un critère de sélection, ils sont étudiés ensemble. Un corpus plus volumineux aurait été nécessaire pour qu’une distinction de cette nature soit pertinente et puisse pousser notre analyse plus avant. Par contre, les livres de Marika Stjernstedt n’en font pas partie et viennent en sus. Ils nous accompagnent dans ce travail car ils sont soit l’objet des articles du corpus ou bien permettent d’éclairer des points particuliers en fournissant des connaissances ou des explications complémentaires.
Les articles de la main de Marika Stjernstedt, qui sont au nombre de huit, ont été introduits dans le graphique suivant pour servir de point de comparaison mais ne sont pas inclus dans notre corpus. Les 85 sources sont l’œuvre d’auteurs, identifiés ou non, mais il peut aussi s’agir d’encarts publicitaires littéraires.
On peut s’étonner de retrouver des sources dont le nombre est loin d’être négligeable, mais qui n’ont pas pour autant été l’objet d’études, du moins jusqu’à maintenant. Ces sources, majoritairement journalistiques, induisaient la manipulation d’un support d’information fragile, ce qui n’est pas comparable avec les livres pourtant publiés à la même époque, robustes et facilement accessibles. La numérisation des journaux peut être vue comme un avantage – et en est un en partie – car beaucoup ont été numérisés en haute qualité, mais leur classement est loin d’être fiable avec des paginations et datations qui ne correspondent pas toujours à l’original.
De plus, certains passages sont illisibles10. Dans ce cas, les démarches pour voir l’original d’un document numérisé sont longues et souvent vouées à l’échec. Ce qui représente une difficulté supplémentaire à celles déjà explicitées.
Peu nombreux sont ceux qui, de prime abord, écrivent son nom de famille correctement. La liste des variations est longue et peut s’expliquer par une orthographe assez inhabituelle en France alors même qu’en Suède on trouve deux orthographes à son nom Stjernstedt ou Stiernstedt.
Corpus
Dans la Figure A ci-dessous, nous avons fait apparaître les résultats de notre recherche effectuée dans Gallica (cf. point méthode). Il s’agit du nombre d’articles de presse trouvés dans les revues ou quotidiens français entre 1914 et 1954. Au total, nous avons recensé quatre-vingt-cinq articles.
D’après la figure A, nous constatons que la critique s’est intéressée à Marika Stjernstedt pendant une période longue de trente-six ans. Nous pouvons dégager de ce graphique six phases : 1914-1920, 1921-1926, 1927-1929, 1930-1940, 1941-1947, 1948-1954 que nous allons commenter ci-dessous.
La première phase de la réception (1914-1920) correspond à une période où la critique s’est focalisée sur la première guerre mondiale. La courbe du graphique laisse apparaître que, si Stjernstedt n’est pas présente tous les ans dans la presse française de 1914 à 1920, elle l’est néanmoins très régulièrement. Notre corpus en témoigne : il fait état de six articles parus entre 1914 et 1920. Il faut signaler qu’au cours de cette période, Stjernstedt a écrit trois articles de sa main dont le contenu est aussi en lien avec la guerre de 1914. Durant ces sept premières années, les articles ont presque tous pour sujet la grande guerre, la traitant sous des angles et formes différentes.
La seconde phase que nous observons entre 1921 et 1926 correspond à une période où Marika Stjernstedt serait absente de la critique. Son nom disparaît presque totalement des journaux français si ce n’est une entrée pour l’année 1923. Ceci se matérialise sur notre graphique par deux éclipses de la courbe avant et après 1923.
La troisième phase correspond aux années 1927-1929 où Stjernstedt est célébrée dans la presse française. Son nom a été presque oublié de cette presse pendant six années pour mieux réapparaître à quinze reprises en 1927 et quatorze fois en 1928 ce qui constitue la période d’intérêt majeure de la critique française pour Stjernstedt. Ceci se traduit par l’apogée de la courbe du graphique. Cette présence en France correspond à la traduction française d’Ullabella publiée en 1926 et de Les Meules du Seigneur que Stjernstedt traduit elle-même en 1928. Ces deux parutions sont relayées durant la période qui nous concerne.
On note par ailleurs que les documents relatifs à la conférence donnée par Marika Stjernstedt à la Sorbonne en 1927 s’élèvent au nombre de onze, soit un tiers sur un total de trente-trois articles publiés pendant cette période. Ce qui montre le grand intérêt que cette conférence a suscité en France. Un texte reprend simplement le titre de la conférence. Deux ont été réduits au strict minimum de deux lignes et sont purement informatifs. Cinq autres peuvent être regroupés par leur taille (entre 9 et 29 lignes) sous le nom d’informations de publication. Ils complètent uniquement les indications données par le précédent groupe. Les trois derniers articles comportent entre 89 et 189 lignes et sont donc détaillés ; ils débordent le simple événement de la lecture de Marika Stjernstedt en Sorbonne, en présentant également sa personnalité, ses œuvres et ses différentes activités que nous allons commenter plus en détail dans la deuxième partie du mémoire.
L’année 1928 coïncide avec la sortie de son livre Les meules du Seigneur11. Seize documents y sont consacrés dans la presse française, ce qui correspond quasiment à la moitié de ce corpus. Ceux-ci se subdivisent en trois groupes selon un critère de longueur de texte. Le premier se scinde lui-même en deux. Il y a tout d’abord trois encarts publicitaires identiques. Suivent cinq références, ce sont les informations de publications qui comptent jusqu’à quatre lignes. Le second groupe est constitué de six textes comportant 12 à 35 lignes. Le troisième et dernier groupe compte deux textes qui, en plus des éléments communs à tous les articles, apportent par leur plus grande longueur (l’un de 54 lignes, l’autre de 305 lignes) des informations supplémentaires que nous développerons dans la partie d’analyse.
Ullabella apparaît dans huit articles subdivisés comme suit : d’abord trois informations de publications qui comptent au plus quatre lignes de texte. Le groupe suivant rassemble quatre textes de 21 à 54 lignes. Le dernier, lui, n’est constitué que d’un article de 305 lignes12.
Deux articles abordent des sujets différents : Un texte de onze lignes paru dans l’Excelsior du 22 mars ainsi qu’un article de douze lignes du Comœdia du 12 mars relatent sa présence à des diners littéraires.
En 1929 la courbe chute : la critique comprend trois textes de presse. Les deux premiers s’intéressant deux livres déjà évoqués : Les meules du Seigneur et Ullabella ainsi qu’à un troisième livre jusqu’ici absent des sources intitulé Chez grands et petits au Maroc13.
La quatrième phase (1930-1940) porte non plus sur la littérature mais sur les activités officielles de Stjernstedt. Entre 1930 et 1935, ce sont ses fonctions officielles qui prévalent. En mars 1931, elle est élue présidente de la société suédoise des gens de Lettres14 et en mai elle devient la vice-présidente de la fédération internationale des gens de Lettres, basée à Paris. C’est dans le cadre de ces fonctions que son nom apparaît dans les journaux lors des réunions, élections ou pour les actions qui sont liées à ces activités. Par exemple, en 1932
L’Afrique du nord illustrée15 ou la revue des Lectures16 nous informent de son opposition à la parution d’une revue, destinée à la jeunesse suédoise, publiant « des crimes de sang ». Cette présence dans la presse pour ses fonctions officielles se traduit dans la courbe par un nouveau pic en 1931/1932 avant celui (quinze entrées) de l’année 1935. Ce sommet sera le dernier pic marquant, après celui de 1928, jusqu’à la fin de la période étudiée. 1935 est l’année de la publication de son livre intitulé Les quatre bâtons du maréchal17, la sortie de cette œuvre donne lieu à six recensions dans la presse. L’année 1935 correspond également à l’année de l’enquête sur les littératures scandinaves de Lucien Maury dans les Nouvelles littéraires et artistiques18 et Marika Stjernstedt est au nombre des écrivains cités à partir de 1936 Stjernstedt est citée comme ambassadrice. Elle accueille des personnalités françaises Stockholm. Puis c’est en tant que journaliste qu’elle intervient, d’abord en 1935 puis à deux reprises en 1940. Elle écrit des articles, exprimant son opinion sur des questions politiques liées à la guerre. D’abord sur la personnalité du général Pilsudski, ensuite sur l’envahissement du territoire finlandais par Staline et au sujet d’une éventuelle intervention suédoise. Ces articles n’ont pas reçu d’écho dans la presse française. Deux pics (1937 et 1940) de moindre importance sont alors visibles sur le graphique.
La cinquième phase (1941-1947) signale de nouveau une absence de Marika Stjernstedt dans la critique. Alors que son dernier livre un attentat dans Paris est traduit en français en 1944, il ne suscite aucun article dans la presse.
La dernière phase (1948-1954) constitue l’ultime retour de Marika Stjernstedt dans la presse française et sa dernière apparition. De 1948 à 1954, elle ne sera nommée que trois fois dont deux à l’occasion d’articles consacrés à la littérature scandinave par Lucien Maury, et la dernière fois en tant que membre du comité des partisans de la paix, pour l’interdiction de l’arme atomique.
Analyse
Les journaux et les critiques
Parmi les cinquante et un titres de presse du corpus, les journaux dans lesquels le nom de Marika Stjernstedt est le plus souvent cité, et dans des articles d’importance, sont les Nouvelles littéraires (huit fois) et Mercure de France (sept fois). On trouve ensuite Comœdia (six fois) et Le Figaro (quatre fois).
Notre corpus général recense 85 articles publiés entre 1914 et 1954 dans la presse française. Quarante-six de ces articles sont anonymes soit presque la moitié de nos sources. Un autre groupe de six articles se distingue par le fait que leurs auteurs travaillent sous un pseudonyme. Constats qui permettent de poser un certain nombre de questions inhérentes à la notion d’anonymat. Ce phénomène qui est aussi très largement représenté dans le corpus était courant dans le monde du journalisme à cette époque. Masquer son identité offrait aux auteurs une liberté d’écriture. Cela offrait également aux journaux une certaine souplesse de gestion du travail, c’est-à-dire la possibilité de faire écrire, au besoin, plusieurs personnes sous la même identité ; assurant une rotation du personnel sans distinction de sexe et d’âge. Que l’article n’ait pas été signé ou qu’il le soit d’un nom d’emprunt revient en fait au même et ne donnait que l’illusion d’auteur au lecteur sans en être la garantie. Ces noms pouvaient aller d’une simple initiale, par exemple « Z. » jusqu’à un nombre « Les Dix », en passant par des patronymes fantasques comme « Le cri de Paris, le Glaneur » etc.
Dix-huit journalistes signent, eux, leurs articles de leur nom lesquels sont alors identifiables : quatorze hommes et quatre femmes que l’on peut relier aux textes les plus développés. L’identité de dix-sept d’entre eux a pu être vérifiée. Une seule, celle d’Havas, n’a pu l’être. S’agit-il d’un nom de famille ou d’un pseudonyme ? Cette question reste en suspens. Il n’a pas non plus été possible de procéder à l’identification de ceux ayant écrit sous pseudonyme ou de savoir s’il s’agit bien de six personnes réelles.
Il faut insister sur le fait qu’écrire à propos d’une femme écrivain journaliste suédoise ne semble pas constituer une activité seulement féminine car elle ne touche que quatre femmes (Mad H. Giraud, Gabrielle Reval, Isabelle Sandy et Elsa Thulin). Bien loin de là, puisque la majorité des journalistes intéressés sont des hommes. Si l’on met de côté les deux journalistes principaux, à savoir Lucien Maury et Edmond Jaloux, les autres journalistes ont en commun de n’avoir rédigé qu’un article alors que le nom de Lucien Maury revient à sept reprises et celui d’Edmond Jaloux deux fois. Une présentation de ces deux hommes s’impose ici. Edmond Jaloux est un romancier, critique littéraire, membre de l’Académie française à partir de 1936 ayant collaboré avec le journal du Temps. Ce sont effectivement dans les pages de ce dernier que les deux articles ont été publiés.