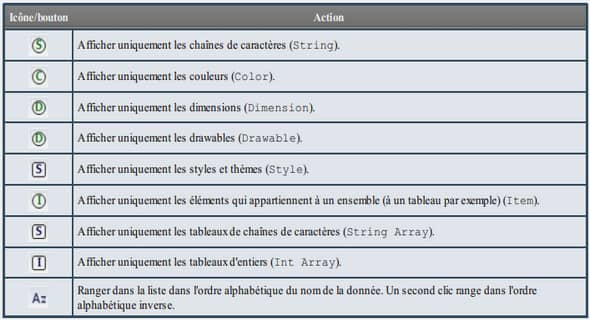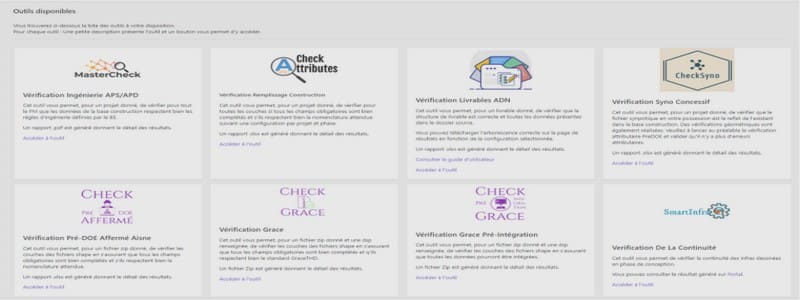Organisation du système de santé
Le Burkina Faso est un pays francophone de l’Afrique de l’Ouest, enclavé et situé entre le Mali au nord et à l’ouest, le Niger à l’est, le Bénin au sud-est, le Togo et le Ghana au sud et la côte d’Ivoire au sud-ouest. Cette situation géographique est illustrée sur la carte de l’Afrique qui suit : Le système de santé au Burkina Faso comprend plusieurs niveaux avec un lien hiérarchique entre les différents niveaux. La base est constituée des centres de santé et de promotion sociale (dispensaires) et des centres médicaux. Ils sont les plus nombreux et sont chargés de dispenser les soins de base. Au sommet, nous avons les centres hospitaliers universitaires qui sont des centres de référence en nombre très réduit. Entre ces deux existent les centres hospitaliers régionaux qui constituent le niveau intermédiaire. Ce qui donne une organisation en forme de pyramide. On distingue les structures de santé qui sont les services opérationnels et le service administratif chargé de la gestion de ces structures. Le service administratif est organisé en plusieurs niveaux.
Le Ministère de la santé comprend trois niveaux dans sa structuration administrative :
Le niveau central composé des structures centrales et rattachées organisées autour du cabinet du Ministre et du secrétariat général ;
Le niveau intermédiaire comprend les 13 directions régionales de la santé ;
Le niveau périphérique est constitué des districts sanitaires qui sont les entités opérationnelles les plus décentralisées du système national de santé.
En 2016, on dénombrait 70 districts sanitaires.
Etat de la protection sociale au Burkina Faso
Le Burkina Faso fait partie des pays les plus pauvres avec une partie importante de sa population qui évolue dans le secteur informel soit plus de 70% de la population active en milieu urbain (ONU, 1995). Cette situation rend difficile la collecte des cotisations sociales et des impôts pour mettre en place un bon système de protection sociale comme dans les pays développés. Il existe néanmoins des mécanismes de protection contre le risque maladie. Ces mécanismes sont variés.
Pour les acteurs du secteur formel il existe l’assurance maladie privée, les mutuelles professionnelles, la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la caisse des retraités fonctionnaires (CARFO). Pour le secteur informel non structuré, il s’agit essentiellement des mutuelles communautaires. Si les mécanismes mis en œuvre pour le secteur formel fonctionnent tant bien que mal, les mutuelles communautaires ont du mal à fonctionner du fait de la faible adhésion, de l’offre de soins insuffisante et de la difficulté pour les adhérents à cotiser. L’État a mis en œuvre une politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans depuis 2016. Ils sont exemptés de paiement des frais de consultation, des actes de soins, des médicaments ou des examens dans les structures publiques de santé.
Notons par ailleurs que depuis 2015, l’État s’est engagé dans la mise en œuvre d’un régime d’assurance maladie universelle dont le mécanisme sera basé sur les cotisations sociales obligatoires afin de permettre aux travailleurs et leurs ayant-droits de pouvoir bénéficier de soins dans les structures de santé conventionnées. Pour le moment il ‘n’est pas encore opérationnel.
Ces différents mécanismes sont synthétisés dans le tableau suivant :
Il existe la gratuité des soins ciblée pour des pathologies et des médicaments. À titre d’exemple, la gratuité pour la prise en charge du VIH/Sida ou la distribution gratuite des médicaments antituberculeux.
L’État propose également des subventions sous forme de réduction des frais de consultation ou de certains actes pour une certaine catégorie de la population (les retraités par exemple) dans les structures publiques de santé.
Particularité du Burkina Faso
Le Burkina Faso présente à quelques exceptions près une similitude sur le plan socio-économique et sanitaire avec les autres pays de l’Afrique de l’Ouest. L’insuffisance dans la couverture santé de la population et l’offre de soins insuffisante en quantité et en qualité constituent autant de difficultés qu’ils ont en commun (PNUD, 2022). La course vers la CSU représente un objectif commun à tous ces États. Ces derniers ne sont cependant pas au même niveau dans la mise en œuvre de la CSU. Le Burkina Faso n’a pas encore mis en œuvre une politique nationale de couverture contre le risque maladie. Par ailleurs, le pays a mis en œuvre le FBR. La création de la CNAMU en 2018 est survenue après la mise en œuvre du FBR. Le Burkina Faso constitue donc un terrain intéressant pour notre étude dans la mesure où la dynamique de mise en œuvre des différents programmes dans le temps nous permet d’observer s’il y’a une interaction entre le FBR et les autres programmes d’une part et d’analyser le type d’interaction, d’autre part. En plus, le FBR mis en œuvre au Burkina Faso était « impur » dans la mesure où les soignants des districts FBR sont toujours rémunérés sur le mode salariat et maintiennent les primes traditionnelles (primes de motivation, primes de rendement) existantes dans les centres de santé. Il comportait également une composante « équitée » et devait de ce fait jouer à la fois sur l’offre de soins et la demande en permettant aux populations vulnérables d’avoir accès aux soins. Le pays a également constitué un terrain d’expérimentation intéressant dans le sens où plusieurs types de FBR y ont été expérimentés (encadré n°1) bien que sa mise en œuvre ait été limitée à quinze districts à l’époque sur les soixante-trois. Le nombre de district sanitaire est passé plus tard à soixante-dix. Il a été mis en œuvre de 2011 à 2018. Le projet est donc terminé et nous pouvons évaluer ses effets à distance pour voir s’il a eu des effets et si ces effets perdurent dans le temps.
En outre, en tant que médecin formé au pays, nous avons une maîtrise du système de santé du Burkina Faso et disposons d’un réseau pour pouvoir conduire notre enquête de terrain. Enfin, pour des contraintes budgétaires nous nous sommes limités à un seul pays.
Le pays a mis en œuvre ces différents types de FBR pour pouvoir à la fin évaluer l’efficacité du FBR couplé aux mesures d’équité par rapport au FBR simple.
Problématique-Hypothèse
Il faut noter que notre sujet de thèse (la problématique aussi) a fait l’objet d’une évolution considérable entre le projet de recherche initial et les travaux que nous avons mené. Il s’agissait pour nous au départ de chercher à savoir si le modèle FBR marche ou non. De façon pratique, nous voulions à travers les données collectées par les enquêtes initiales sur le FBR chercher à évaluer son impact sur les indicateurs de santé. Au fil des lectures et des échanges, nous avons rapidement compris que le FBR malgré les difficultés qu’il a connu ne constituait pas un projet isolé mais une idéologie « nouvelle » appelée à se répandre dans le système de financement de la santé des pays du Sud sous diverses appellations dans un contexte dominé par la course à la mise en œuvre de la CSU. Au-delà de l’impact isolé du FBR sur les indicateurs de santé, nous avons donc décidé de chercher à comprendre les origines de ce mécanisme de financement, son mode de diffusion et sa capacité à apporter des résultats pour la mise en œuvre de la CSU.
Les années 80 ont été marquées en Afrique par l’introduction des programmes d’ajustement structurel avec pour conséquence la détérioration des services publics notamment dans le secteur de la santé. Les finances publiques destinées au secteur de la santé vont connaître une réduction ce qui va entrainer une détérioration du système de santé. Le contexte économique international et national défavorable contribuera à aggraver cette situation aboutissant en 1987 à la mise en œuvre de l’initiative de Bamako. Il s’agit de façon concrète de demander aux populations de contribuer financièrement à la prise en charge de leur santé. L’époque de la santé pour tous née à la suite de la conférence d’Alma Ata en 1978 va faire place à l’ère de la santé pour chacun.
Cette approche basée sur des idées néolibérales appliquées en plus dans un contexte de pauvreté va conduire à éloigner les populations les plus pauvres des centres de santé aggravant les inégalités en santé et dégradant du même coup les indicateurs de santé. L’une des solutions durables et efficaces pour y remédier était la mise en œuvre d’une couverture contre le risque maladie afin de protéger les populations contre le risque de dépenses catastrophiques en santé lors des épisodes de maladie. Dans ce contexte la CSU sera promue comme un moyen efficace et durable pour permettre l’accès à la santé pour tous à une frange importante de la population. Promu en 2013 et portée par la Banque mondiale et l’OMS, la CSU constitue un objectif majeur à atteindre dans le champ de la santé mondiale.
Dès lors, ces organisations internationales vont développer une série de mécanismes de financement « nouveaux » pour aider les pays à atteindre cet objectif qui s’insère dans le cadre des ODD (2030). C’est ainsi que nous allons assister à nouveau au développement des mécanismes issus de l’école néolibérale malgré l’échec relatif de l’initiative de Bamako tels que l’achat stratégique et le FBR dont les objectifs sont l’amélioration du système de santé afin de faciliter la mise en œuvre de la CSU.
Le financement de la santé comprend trois éléments importants à savoir la mobilisation des ressources, la mise en commun et l’achat des soins de qualité au profit des bénéficiaires. Nous allons nous intéresser au dernier volet. Il s’agit de la fonction d’achat qui se base sur des principes de contractualisation. Le payeur doit définir le mode d’adhésion, identifier des structures de santé partenaires, définir des critères et des normes de qualité de même que les modes de paiement et les échéances de paiement des structures de santé. Les modalités d’adhésion sont basées sur des cotisations obligatoires et l’Etat prend en charge les patients démunis.
Les bénéficiaires transfèrent à l’organisme payeur la possibilité de choisir pour eux les prestataires, les types de soins dont ils vont bénéficier et les modalités de remboursement de ces soins. Il faut donc une séparation des fonctions, une transparence mais surtout encourager la concurrence entre les prestataires. Comme nous le détaillerons dans le chapitre 2, le Burkina Faso a expérimenté plusieurs types de FBR. Le FBR type 3 qui comprend le paiement à la performance associé à la prise en charge gratuite des indigents constitue également un outil de protection des plus pauvres contre le risque maladie et de contractualisation entre les prestataires et le payeur avec définition d’une série de normes et paramètres à intégrer et à respecter. Le Burkina Faso ayant mis le FBR en œuvre de 2011 à 2018, s’est engagé à offrir à une proportion importante de la population une protection contre le risque maladie avec la mise en œuvre de la CNAMU en 2018.
Le pays possède donc l’expérience du FBR avec une ressource humaine qualifiée, de la documentation et un savoir-faire. Le FBR devait rendre le système de santé plus performant et faire le nid de la CSU.
Il s’agira pour nous de vérifier si le FBR a réellement servi à la mise en œuvre d’une CSU au Burkina Faso.
Pour ce faire nous allons interroger trois aspects du FBR. Le premier consistera à chercher à comprendre pourquoi le pays à un moment donné a décidé de s’orienter vers cette méthode de financement. Le deuxième point consistera à analyser le mécanisme adopté pour la mise en œuvre et la diffusion du FBR en identifiant les acteurs impliqués et le rapport entre ces acteurs. Le dernier point concernera l’apport pratique du FBR sur le système de santé. Il s’agira d’évaluer l’impact du FBR et son apport dans la perspective d’une couverture santé universelle.
En pratique, le FBR et la CSU mobilisent des acteurs différents et le leadership semble être porté par des ministères différents au niveau national (i). La conceptualisation du FBR comme outil de mise en œuvre de la CSU ne semble pas de ce fait une évidence pour les différents acteurs(ii) et le manuel de mise en œuvre du FBR ne fait pas explicitement cas du FBR comme une phase de transition ou un outil de mise en œuvre de la CSU (iii).
Nous émettons comme hypothèse que l’introduction du FBR au Burkina Faso est l’œuvre d’entrepreneurs institutionnels et que sa mise en œuvre n’a pas permis d’atteindre les resultats escomptés (les objectifs présentés n’ayant pas été atteint). En d’autres termes, le FBR tel que mis en œuvre au Burkina Faso n’a pas permis de mettre le pays sur les rails de la CSU. Les mesures entreprises depuis les indépendances dans le secteur de la santé n’ont pas permis d’améliorer considérablement les indicateurs de santé des populations. Comme détaillé dans le chapitre 1 cela va favoriser la multiplication des politiques et programmes de santé au Burkina Faso avec souvent un rôle important joué par les partenaires techniques et financiers. Ces acteurs internationaux du fait de la faiblesse des États bénéficiaires arrivent à mettre en place en s’appuyant sur des organisations et des acteurs locaux ces programmes de santé parfois en dehors de l’agenda national des pays bénéficiaires. Face aux échecs constatés des politiques antérieures à améliorer les indicateurs de santé de façon considérable, la solution proposée par ces acteurs était simplement de remettre en question le modèle existant en introduisant un autre programme de santé jugé plus performant donc capable d’améliorer le système de santé et in fine les indicateurs de santé (état de santé des populations bénéficiaires). Ces nouveaux programmes et politiques sont souvent introduits en remplacement de ceux existant (dans une logique de changement) parfois en association avec ceux existant entrainant une forme d’empilement des programmes et politiques en espérant que les uns impactent positivement les autres. Si le FBR était perçu comme un changement par son mode de fonctionnement en comparaison au financement traditionnel du système de santé il a été mis en œuvre en plus d’autres programmes de santé avec parfois une absence de complémentarité entre eux. Nous soutenons ainsi l’affirmation selon laquelle l’introduction du FBR comme alternative dans le cas du Burkina Faso n’a pas permis d’améliorer les indicateurs de santé comme annoncé ni d’améliorer considérablement et efficacement le système de santé du pays dans la perspective d’une couverture santé universelle.
Positionnement de la recherche
Dans son livre « introduction à l’économie » Jacques Généreux essaie de retracer l’évolution de l’économie dans une perspective historique. Il affirme ainsi que l’économie a initialement été pensée comme un sujet de philosophie morale et politique jusqu’à la renaissance (XVe-XVIe siècles). Il s’agit à l’époque de moraliser l’usage de la monnaie et la pratique des échanges pour s’assurer que la cupidité et la compétition pour les richesses ne détruisent pas la cohésion de la société. L’économie ne constituait pas une sphère autonome et restait subordonnée aux normes sociales, philosophiques et religieuses qui structuraient la société. Cela va changer entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle caractérisé par le déclin du pouvoir religieux, l’affirmation du pouvoir politique, la rivalité croissante des Etats pour le contrôle des nouvelles routes commerciales (Indes, Amériques) et des colonies. Ces facteurs entre autres vont contribuer à créer le terreau favorable à une première révolution dans la manière de penser l’économie en Europe. C’est alors que vont émerger des auteurs dits mercantilistes qui vont réhabiliter la richesse comme source du bonheur privé et du bien public.
L’économie va s’émanciper ainsi de la morale antique et de la religion pour devenir une science politique. Ces auteurs fondent une nouvelle discipline qui sera appelé économie politique à l’initiative de Montchrestien (1615). Si l’analyse économique reste essentiellement politique, elle ne s’émancipe pas totalement de la philosophie avant le milieu du XIXe siècle et le désir de « faire science » gagne progressivement en importance dans les travaux. Par la suite, l’économie politique va se transformer en science mathématique des choix individuels et de leur coordination par les marchés : on parle de la révolution marginaliste. Cette révolution scientifique opérée dans les années 1870 par les auteurs comme Léon Walras, Carl Menger et William Stanley Jevons va conduire à rebaptiser le « political economy » en « economics ». Cette expression avait pour but de souligner le fait qu’il s’agira désormais d’une science mathématique. Ces auteurs vont poser ainsi les bases d’une école qualifiée de « néoclassique » qui va constituer le courant dominant à la fin du XIX e siècle malgré le paradigme keynésien des années 1930-1970. Ce bref rappel historique nous permet de comprendre la genèse des différents courants qui occupent le champ de l’économie. L’économie de la santé est également traversée par cette diversité d’approche dans l’analyse des problèmes en santé. Le dictionnaire français en ligne 3définit l’économie de la santé comme une discipline visant à appliquer à la santé les principes de la science économique. Les principes étant différents, cela va se traduire par une diversité d’approche.
Pour l’économie mainstream, le principe de base est que l’agent économique est un homo-œconomicus, rationnel et intéressé uniquement par la maximisation de son utilité. En économie de la santé ce principe pourra se résumer en deux phrases pour ce qui concerne l’offre et la demande de soins :
Le patient est rationnel et la consommation des soins de santé serait le fruit d’un choix rationnel
Le soignant est intéressé uniquement par la recherche de maximisation de son profit.
Cette approche a montré ses limites particulièrement dans le secteur de la santé. Pour ce qui concerne le premier volet, Batifoulier et Domin ont remis en cause la pertinence du consommateur rationnel en affirmant : « le domaine de la santé met en avant que l’humain puisse souffrir et qu’il est souvent particulièrement démuni face à la maladie et plus encore à la mort. La demande de soin présente le plus souvent un caractère involontaire et ne peut être assimilée à un simple désir. On ne choisit pas d’avoir un accident cardiaque ni même un mal de gorge. Le soin de santé ne correspond pas à un « achat plaisir » comme certains biens de consommation courante. Dans la majorité des cas, on ne peut pas prévoir le besoin, indépendant de la responsabilité individuelle. Le besoin en santé répond à des caractéristiques biologiques du fait d’une vulnérabilité humaine commune face à la maladie et à la souffrance. Il est aussi lié à des traits culturels et sociaux du fait du rôle du contexte sociétal dans la définition de la norme de santé. Vouloir réduire le besoin de santé à une stratégie ou une simple préférence individuelle occulte son caractère collectif et social » (Batifoulier et Domin, 2015).
Pour ce qui concerne le second volet, qui se rapproche plus de notre sujet de thèse, la logique de l’économie standard est de proposer aux soignants des incitations (notamment financière) afin de les amener à produire plus de soins de qualité. C’est la même logique visée par le FBR. Da Silva (2013) a démontré les limites de cette approche également tout en soulignant la nécessité de prendre en compte d’autres valeurs au-delà de la motivation financière dans l’analyse de la motivation des soignants. Il s’agit en occurrence des motivations anti-utilitaires particulièrement importantes pour les professionnels de la santé comme la définition de la bonne pratique, la définition de la profession, les problèmes éthiques et déontologiques, les relations avec les patients, la reconnaissance etc. (Da silva,2013).
L’approche par l’économie standard nous paraît en toute évidence inadaptée voire incomplète pour mieux cerner notre objet d’étude.
En outre, comme nous l’avons exposé plus haut, cette approche met un accent sur la scientificité et se base exclusivement sur les sciences qualifiées d’exactes excluant de ce fait un rapprochement avec les autres sciences sociales. La santé est un fait social et l’économie de la santé ne peut être abordée sans prendre en compte les sciences sociales. Nous épousons l’idée que les sciences économiques constituent une science sociale qui ne peut exister que par son dialogue avec les autres sciences sociales et par la controverse. Par ailleurs, nous mobilisions plusieurs disciplines (économie, sociologie, santé publique) pour conduire notre travail de thèse. Pour toutes ces raisons évidentes, nous jugeons que l’approche par l’économie standard ne convient pas à notre objet d’étude.
Enfin, je suis médecin à la base et la formation que j’ai reçue de même que l’expérience que j’ai acquise dans l’exercice de ma profession ne me permettent pas de dire que la motivation médicale se limite à la recherche du profit et les incitations financières ne peuvent pas suffire pour induire un changement dans le système de santé comme supposé par l’approche néoclassique. Le secteur de la santé est donc celui qui permet le mieux de démontrer les failles du raisonnement néoclassique.
Nous nous inscrivons dans l’approche qui est celle de l’économie politique de la santé. Les politiques de financement de la santé (dans les pays du Sud pour ce qui nous concerne) sont construites par les politiques et la santé constitue la manifestation des enjeux économiques et sociaux. L’économie politique de la santé est par conséquent forcément pluridisciplinaire. Elle permet d’historiciser et de déconstruire les problématiques académiques usuelles (Duchesne, 2021)