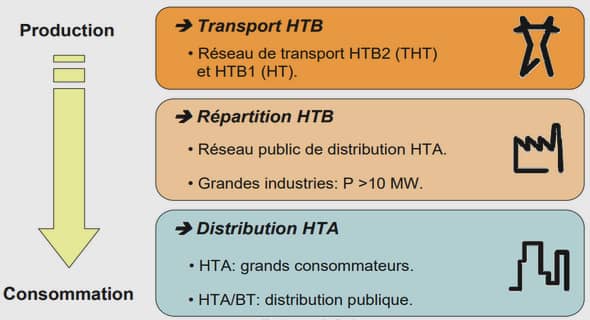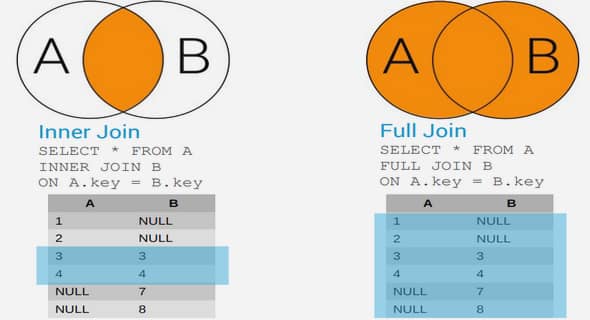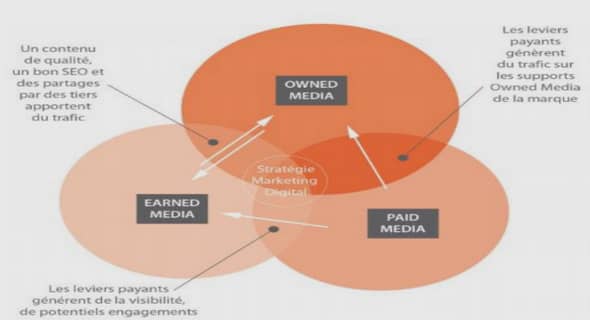Des départs inéluctables.
Pourquoi sont-ils partis ?
Le rapatriement de la population française implantée outre-mer est un corollaire de la décolonisation, mais les agriculteurs français de Tunisie n’ont pas quitté le pays pour les mêmes raisons. Les motifs de départ sont sseza nombreux et cette volonté de départ est bien souvent légitime. Il convient de rapporter les raisons de ce rapatriement.
Il importe de faire ici une remarque : le départ, dans ses débuts, des agriculteurs français d’origine tunisienne est dans un premier t emps une émigration volontaire, puis cette émigration devient imposée par les évènements, dans une deuxième phase. Il arrive cependant, et il ne faut pas le passer sous silence, que ce retour en métropole d’un certain nombre d’agriculteurs français de Tuni sie, peut être volontaire, particulièrement en 1956.
La proclamation de l’indépendance de la Tunisie et même sa perspective avait amené des Français à songer au retour ou du moins à provo quer l’émigration des agriculteurs européens installés dans ce pays. Cela signifiait ourp eux la démission de l’Etat français et a eu pour conséquence le découragement de plusieurs des leurs, ce qui précipita les retours. Le passage de l’état de ressortissants de la puissance coloniale à celui d’étranger dans un pays qui vient d’accéder à l’indépendance comporte la nécessité d’une difficile reconversion psychologique, à laquelle les intéressés peuvent, plus ou moins long terme, préférer un retour en métropole. De nombreux Français sont désormais considérés comme des étrangers et usto leurs privilèges disparaissent. Effectivement, le changement de situation morale, la perte du prestige, la peur de l’avenir et corrélativement la crainte d’arriver les derniers pour prendre les places en métropole, sont autant de motifs qui poussent au retour en métropole.
Pour beaucoup, c’est alors le signe du départ soit par obligation professionnelle, soit par la perte de leur clientèle ou encore par fuite de l’insécurité liée aux luttes d’indépendances.
En outre, la situation des Français n’a cessé de se dégrader notamment à cause des graves difficultés politiques qui ont opposé la France et la Tunisie depuis l’indépendance de ce pays. Les relations sont tendues entre les deux pays et il existe certaines vicissitudes, des tensions et des pressions entre ces deux pays. Le climat est crispé durant des années ce qui ne rend pas la vieagréable aux ressortissants français. Les Français de Tunisie ne peuvent plus vivre corre ctement malgré des conventions signées avec les nouveaux gouvernements reconnaissants leurs biens et leur garantissant la liberté de circulation pour les biens et les capitaux. Les agriculteurs français subissent un traitement difficile. Notons aussi que la situation de nombreux colons est très obérée. Les agriculteurs rencontrenbien des difficultés que ce soit des difficultés liées aux conditions techniques et écomiquesn dans lesquels ils sont appelés à travailler ou alors difficultés liées auclimat politique et social qui ne cesse de se dégrader avec le temps. Cette situation d’ensemble nous oblige à repenser l’avenir de cette colonie dans ce pays. Ce climat d’incertitude et d’inquiétude pour l’avenir se trouve inévitablement crée chez nos nationaux, climat qui ne peut qu’accélérer ce mouvement de retour .
Ce sont, bien davantage, des causes économiques et psychologiques qui sont à l’origine de ces retours. On relève aussi des raisons politico-économiques à ces retours telles que le fait que la Tunisie retire de nombreuses licences de transports et d’exploitation de fonds de commerces, les cafés notamment en tant que débits d’alcool et officines de police.
A coté de ça, l’accession à l’indépendance implique la fin de l’administration directe par la France et l’extension des attributions de l’ administration locale. En effet, le nouvel Etat entame rapidement une politique de « préférence nationale » dans les services publics mais aussi dans le commerce1. Les nouveaux dirigeants ont une préférence nationale pour les postes de fonctionnaires, les emplois dans les industries et pour les professions libérales. Dans de nombreuxemplois, les autochtones prennent la place des fonctionnaires français. Ils accèdent à des postes de direction et de surveillance jusque là réservés à des Européens : ’estc ce qu’on appelle la tunisification de l’administration ou de la fonction publique. C’est désormais les nationaux qui sont aux leviers de commande de l’Etat. Et comme un fort pourcentage travaillait comme fonctionnaires, la plupart furent obligés de renter en Métropole, car ils dépendaient directement de la présence française. D’autres étaient employés dans des filiales d’entreprises nationales telles que EDF GDF ou SCNF qui risquaient de partir avec l’indépendance.
En outre, les commerçants, les membres de professio ns libérales, les artisans dont l’essentiel de la clientèle était composé de fonctionnaires ou de militaires français voient leur revenu diminuer. Effectivement, le Français, surtout en milieu urbain, vivaient entre eux, dans une société repliée sur leel-même et le départ de nombreux fonctionnaires, en autre, signifiait alors la perte d’une clientèle pour diverses entreprises et professions libérales.
Toutes ces réactions ont tendance à se conjuguer en chaîne. Pour prendre un exemple, 30 individus qui partent, ce sont 30 clients perdus pour l’épicier et si celui-ci s’en va, le médecin perd un patient. En ce sens, il est probable que la présence de l’armée ne constitue pas seulement un facteur de sécurité, mais, par les dépenses effectuées sur place, un élément de fixation.
Le ralentissement de l’activité économique et l’asphyxie progressive de l’activité économique qui marquent généralement la mutation politique, la moindre progression des salaires réels et parfois même leur réductionffectenta la vie des français installés en Tunisie et les incitent à rentrer en France.
Un retour forcé ?
La non signature de conventions culturelles ou autres peut entraîner et être une cause de retour en France mais le retour en métropole de plusieurs agriculteurs français de Tunisie se caractérisent par le fait qu’il s’agit d’une migration « politique » réalisée sous la pression d’évènements majeurs absolument indépendants des causes qui affectent normalement la situation professionnelle des intéressés : compétence technique, conjoncture économique,… La plupart des retours se trouvent marqués par ce caractère et les Français établis hors de la métropole ont dû venir s’y installer par suite d’évènements politiques.
Certains évènements internationaux ont provoqué lereflux massif vers la métropole de plusieurs milliers de Français sans ressources. Le bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef s’est suivi d’un mouvement de retour en Fra nce (cf. annexe 1) tout comme l’a été l’affaire de Bizerte. Les militaires français encore présents sont évacués en toute hâte de Tunisie au moment de la crise de Bizerte, en juillet 1961. Cet événement a précipité le départ de plus d’un. Au lendemain de’indépendance,l le gouvernement négocie le maintien, pour quelques années, de l’armée française sur la base militaire de Bizerte. En mai 1961, les militaires français décident d’agrandir une piste d’envol sans l’avis de s autorités tunisiennes. Celles-ci profitent de la situation pour engager une épreuve de force en contraignant les militaires français à arrêter les travaux.
Chaque camp se tenant sur ses positions, l’escalade est inévitable. Les deux armées s’affrontent, des coups de feu sont échangés, des ombardements effectués par l’armée française. Les relations diplomatiques sont rompues entre les deux pays et les pertes importantes. Le cessez-le- feu est demandé par les Français le 22 juillet. Le 26 août, l’assemblé général de l’ONU condamne la France pourson agression. La base de Bizerte est évacuée par les Français le 15 octobre1963. A la suite de cette affaire, des militaires et des civils français sont internés dans le camp de Sousse, d’autres sont arrêtés ou expulsés. Aussi, des fermes françaises onts réquisitionnées sans aménagement, tandis qu’inversement, des mesures empêchent de se rendre librement en France. Les Français prennent peur, l’interdicti on de quitter le pays les réduisant à une situation d’otages.
Qui plus est, la réduction des forces armées françaises, leur concentration dans quelques bases, entraîne une réduction des affaires dans les localités où elles étaient implantées. Par ailleurs, en raison du départ des orcesf françaises, la majorité des Français décident de partir craignant que leur sécurité physique et matérielle ne soit plus assurée. Alors, l’insécurité règne partout :euxd fermes françaises sont attaquées par des Tunisiens dans la région de Mateur, des agriculteurs ont fait état de services. Les événements qui se sont déroulés entre 1956 et9651 dans les pays d’expansion française ont contraint des milliers de Français in stallés à demeurer en Tunisie à regagner la métropole, abandonnant, fréquemment entotalité leurs biens corporels et incorporels devenus invendables et intransférables,sinon expropriés.
Une autre cause à l’origine des rapatriements est c elle lié à l’ insécurité autant des personnes que des biens. La violence et les heurts entre communautés ont été certainement la cause des départs les plus nombreux. L’indépendance de la Tunisie n’a pas échappé aux tensions surtout entre 1952 et 1956 (d’où le fait que les premiers retours ont eu lieu bien avant 1956). Dés janvier 1952, à la suite de la nomination de Jean de Hautelocque au poste de Résident Général,esl tensions sont palpables. On peut relever des agitations constantes, des incidents, des représailles, des opérations de police, des manifestations, des répressions, des révoltes, des pressions… On a même un terrorisme et un contre-terrorisme (la Main Rouge) qui se développent ainsi que des nombreux enlèvements, meurtres,… La liste des v iolences peut continuer à s’allonger. Soulignons seulement qu’un réel climat de terreur s’installe et l’engrenage de la violence est lancé.
Néanmoins, les rapatriements pour raison de sécurité, par suite de l’hostilité des populations locales ou sous la contrainte du gouvernement étranger sont rares. La question de sécurité semble être passée au secondlanp. Il existe tout de même des tensions comme en témoigne le climat insurrectionnel régnant dans le pays. On parle même de zones dites d’insécurité et de zones critiques c’est-à-dire là où il y a les opérations militaires, prés de la frontière algérienne. Nombreux sont ceux qui ont dû quitter leurs exploitations, motif pris qu’elles se trouvaient dans ces zones dangereuses. De même, au lendemain des incidents Sakiet-Sidi-Youssef, les autorités tunisiennes ont fait évacuer des familles françaises établies dans des régions considérées par le Gouvernement tunisien comme dangereuses pour la sécurité de ces familles : il s’agit des régions de Tabarka, Sbeitla, Aïn Drahan, Souk-el-Arba, … Les Français éloignés de leur domicile sont en presque totalité des agriculteurs. Leurs exploitations ont été dirigées en leur absence pardes gérants « de fait » imposés par les autorités locales. En réalité, le Gouvernement tunisien a des vues sur les propriétés des Français éloignés. Il projette d’installer des Tunisiens sur ces propriétés. Celles-ci font l’objet de véritables mises sous séquestres. On asiste ici à une véritable prise de possession des terres par les autorités tunisiennes.
Par ailleurs, les déclarations de Métouia par exemple, certaines décisions du Gouvernement tunisien de même que les agissements des autorités locales, imposent le retour dans leur pays des agriculteurs français not amment. Il a d’ores et déjà adopté une législation qui lui permet de donner une couverture juridique à des actes arbitraires de dépossession de nos ressortissants par les déchéances de lots domaniaux, les mises sous séquestre, l’application de la loi sur la mise en valeur de la basse vallée de la Medjerdah, … Certains se sont vus expulsés du pays, par le gouvernement tunisien, dans les mois qui ont suivi la proclamation de l’indépendance ou comme cela s’est produit dans la région du Kef. De nombreux colons se sont vus évincés de leurs exploitations à la suite de l’évolution politique du territoire tunisien. Les terres appartenant à des particuliers français victimes de spoliation, peuvent être évalués à 200 000 hectares environ1. Les retours sont liés aux évictions, aux spoliations et aux saisies pratiquées alors.
S’il est certain que nombre de solliciteurs assurent depuis fort longtemps leur survie économique grâce à l’aide directe ou indirecte de l a France, c’est une aggravation continue des mesures de rigueur qui pesaient sur eux ou encore la simple volonté de réaliser quelques opérations spectaculaires tellesque des reformes agraires mises en œuvre par le gouvernement qui ont accentué ce mouve ment de retour et étaient prétexte de départ. Par conséquent, tout un secteurde la colonie française de Tunisie est condamné à partir à plus ou moins brève échéance : les agriculteurs. Les céréaliers dont les conditions d’existence sont mises en cause par les réformes agraires et les restrictions des débouchés sur la France. Le gouvernement tunisien va prendre des mesures successives qui aboutiront à déposséder lescolons français ou à rendre leur existence en Tunisie impossible. La politique de « préférence nationale » mise en place par le Gouvernement tunisien est également visible dans l’agriculture. Des réformes agraires sont décidées de manière à mieux répartirla propriété agricole qui ne peut rester majoritairement aux mains des anciens colonisateurs.
Le Gouvernement tunisien a manifesté à maintes reprises son intention des reprendre les terres agriculteurs étrangers. La situation desagriculteurs inspire effectivement de vives inquiétudes et cela ne va faire que s’aggraver avec le temps par les diverses mesures entreprises.
La France a engagé en Tunisie une politique de décolonisation agraire en différentes étapes. Trois mesures ont abouti à la dépossessiondes agriculteurs français en Tunisie et entraînent la disparition du patrimoine immobilier agricole français en Tunisie. Elle s’est vue contrainte de le faire car elle était préoccupée de l’avenir de ses colons. Elle dut dégager l’implantation agricole française en Tunisie en tenant compte de la politique économique et sociale tunisienne. Ce n’est là qu’un aspect du repli de la colonie française de Tunisie mais c’est un des plus important en raison, tant des actes et des intentions des autorités tunisiennes que de la nature et la situation assez particulière des entreprises agricoles françaises.
La première étape est celle mise en place par la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957. A la suite des évènements de Sakiet-Sidi-Yousef, le Gouvernement français s’entend avec le Gouvernement tunisien pour le rachat des terres françaises en Tunisie situées en bordure de la frontière algérienne. Lesaccords de 1957 prévoyaient la cession, dans le domaine agricole, d’un nombre important d’exploitations françaises aux autorités tunisiennes. En application de cet accord, 150 000 hectares de terres françaises sont ainsi cédés aux autorités tunisiennes contre paiement aux propriétaires français de la valeur estimée de leurs exploitations. Cette opération de rachat s’étend de 1958 à 1963.
Plusieurs agriculteurs français sont soumis aux dis positions du protocole franco-tunisien du 13 octobre 1960, protocole qui prévoyait la nationalisation des céréalières appartenant aux Français et transférées au gouvernement tunisien. Ces accords concernent essentiellement la cession volontaire de 100 000 hectares de terres céréalières au Gouvernement tunisien. C’est là unenouvelle étape dans la politique de décolonisation agraire et française mise en place par le gouvernement tunisien. Elle a pour objectif « de favoriser la réalisation des programmes de développement agricole en Tunisie ». Finalement, les agriculteurs français de Tunisie sont menacés et condamnés à terme par cette nouvelle tranche de cession de terre bien que son exécution ait été entravée par les événements dezerteBi et le protocole additionnel de mars 1963. Non seulement, ce protocole prévoit le rachat par le Gouvernement tunisien de 150 000 hectares en 1963 (100 00O hectares font l’objet du protocole du 13 octobre 1960 et 50 000 celui du 2 mars 1963), mais une autre tranche complémentaire va être prévue. Cette tranche s’applique à 50 000 nouveaux hectares dont la cession était prévue en date du 30 septembr 1964 (objet du protocole du 2 mars 1964). Au final, 50% des terres appartenant aux Français, soit 180 000 hectares furent ainsi nationalisées.
Les opérations de cession des tranches de 1963 ont été unilatéralement interrompues par la Tunisie le 12 mai 1964. En vertu de cette loi relative à la propriété agricole en Tunisie, le Gouvernement tunisien a pris possession de toutes les terres appartenant à des étrangers ainsi que tous les cheptels vifs ou morts existant sur les domaines et des récoltes pendantes. Depuis des années, le Gouvernement tunisien menace d’une réforme agraire qui lui permettrait d’atteindre son but pratiquement sans débours. Ce jeune Etat indépendant du procéder à cette réformeagraire car son économie est essentiellement agricole et sa population rurale. La poussée démographique et les revendications politiques devant lesquels il se trouve l’obliger à mettre en œuvre cette réforme agraire, dont la conséquence sera nécessairement l’éviction d’un nombre important de colons. Il cherche à récupérer les teres appartenant aux européens. La politique appliquée dés sa prise de pouvoir par lePrésident Bourguiba n’a cassé d’être conforme aux principes établis par le Congrès néo-estouriend réuni à Sfax dans les dernières années du Protectorat. Une ancienne conception coranique, assortie de socialisme agraire, a inspiré toutes les revendications concernant la terre tunisienne.
En définitive, la loi du 12 mai 1964 n’a plus reconnu l’exercice du droit de propriété sur cette terre qu’aux seules personnes physiques tunisiennes et à certaines coopératives. Cette loi interdit donc à tous les étrangers de posséder des terres agricoles et a permis de nationaliser au profit du gouvernement tunisien l’ensemble des exploitations appartenant à tous les étrangers. Cette appropriation autoritaire est absolument contraire à l’esprit comme à la lettre d es conventions franco-tunisiennes. En effet, le protocole du 2 mars 1963 garantissait une paisible jouissance et une exploitation sans entrave de leurs propriétés agricoles aux agriculteurs français ne figurant pas encore sue les listes de cession. Il s’agit là de la violation la plus grave apportée aux termes des accords.
Ainsi, de 1955 à 1964, toutes les terres possédéespar des Français passèrent-elles aux mains des Tunisiens. Cette loi de nationalisation des terres est une mesure importante et un autre volet de la politique de décolonisationagraire, qui a précipité le départ des colons, d’une certaine catégorie de population et a incité la grande majorité des étrangers européens à quitter la Tunisie. En conclusion, cette loi permettant au gouvernement de nationaliser toutes les terres appartenant à des étrangers ainsi que cheptels vifs ou morts existants sur les domaines et les récoltes pendantes, génère donc de nombreux autres départs. Cette opération a portésur pratiquement 267 000 hectares de terres laissées à l’écart du programme de rachat de terres et sur 89 000 hectares inclus dans le programme de rachat de terres, soit plus de 350 000 hectares au total. Les colons ont été dépouillés de leurs terres, morceau par morceau et ces diverses dépossessions vont poser la question de l’indemnisation.