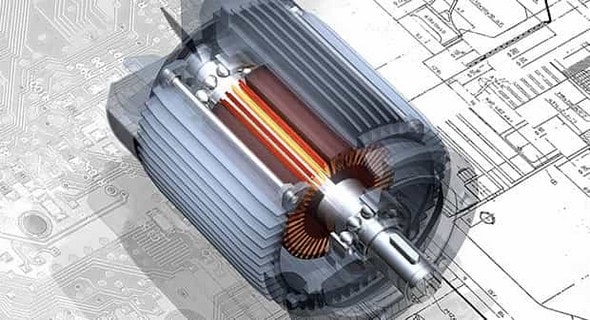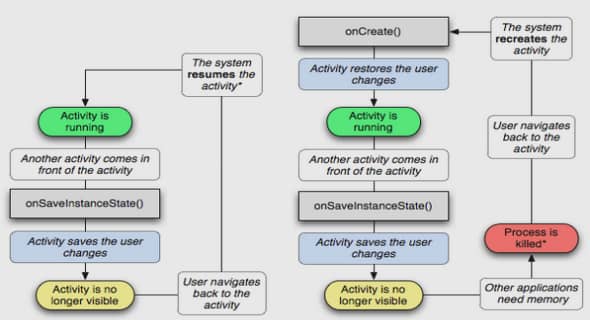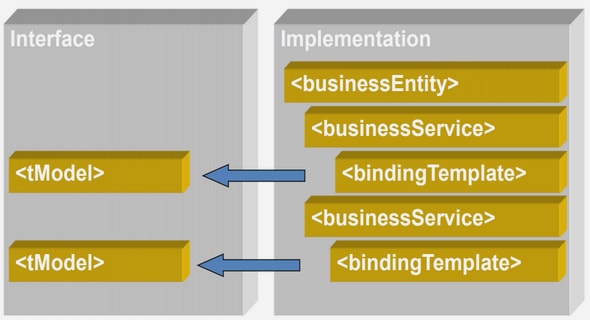Critiquer en ligne
L’enquête vise la production d’une combinatoire des situations possibles. L’enquêteur n’est pas ici fixé sur un terrain intégré qui constituerait l’horizon central à partir duquel il reconstituerait une entité collective. Il circule entre plusieurs chantiers, au fur et à mesure des dimensions qui apparaissent pertinentes dans l’analyse de chaque cas. S’il cherche parfois à trouver un terrain qui lui permette d’approfondir un régime d’action ou une forme d’activité, il s’attend à ce que ce terrain soit de fait plus hétéroclite que prévu et l’oblige à prendre en considération l’intrication avec d’autres formes d’action. Le matériel collecté s’apparente souvent à un corpus assez vaste de données textuelles issues de sources hétéroclites »278 – Baszanger et Dodier
Cette hétérogénéité de nos matériaux et l’attention portée aux espaces publics de jeu n’est pas cantonnée au LAN parties. L’actualité de notre objet de recherche est venue d’une autre manière influer sur le recueil des données. Il n’était pas question de faire fi de cette actualité où de porter des œillères enfouissant le bruit causé par le contexte public dans lequel cette recherche et les gameuses sont aux prises. Notre recherche a commencé en 2012. Cette date coïncide avec la publication en ligne de divers travaux féministes déconstruisant la domination masculine dans les jeux vidéo. Ils sont de diverses natures (articles, vidéos, sites internet) et ont suscité autant de réactions qu’une importante couverture médiatique par les médias traditionnels (radio, télévision, presse). Cette partie de notre terrain s’appuie sur les travaux de deux féministes gameuses : Anita Sarkeesian et Mar_Lard. Notre récolte de données se concentre principalement sur ces initiatives critiques (contenus, forme des argumentaires) et leur réception. Cette dernière est entendue dans un sens large et prend en compte autant les commentaires en ligne que l’accroissement de la réflexivité (Lemieux, op.cit.) sur ces sujets suite aux prises de parole publiques chez les gameuses rencontrées.
Les principaux matériaux empiriques sont donc multiples. Ils sont envisagés en s’inspirant du traitement pragmatique des affaires (Lemieux, op.cit. ; Barthe, et al., op.cit.) comme autant d’opérations critiques dans la mesure où ils donnent à voir des processus d’administration de la preuve et de la justification. Le recensement de ces données s’est fait par le biais d’une ethnographie en ligne (2012 à 2016) des différents types de travaux produits par Anita Sarkeesian et Mar_Lard. La mobilisation de ces travaux féministes publicisés permettent d’ouvrir la boîte de la critique interne » (Lemieux, 2000 ; Moreau de Bellaing, 2016) dans le domaine vidéoludique venant des gameuses elles-mêmes. L’analyse de l’écho de ces travaux et prises de parole dans l’espace public est indispensable. Si, comme nous l’avons vu, certains travaux se sont penchés sur la domination masculine et ses effets dans le domaine technologique et vidéoludique, il est tout autant important de voir comment les gameuses se sont saisies de ces problématiques. Dans la volonté de prendre en compte les épreuves, l’analyse de ce corpus critique permet d’atteindre la dimension publique de dénonciation et de visibilité de la domination masculine dans les jeux vidéo émergeant des personnes directement concernées.
Les terrains
Ainsi, l’ensemble de ces matériaux empiriques s’est construit dans une volonté de « collection de cas » (Lemieux, op.cit.) comme autant de ressources donnant à voir les rapports sociaux de genre en terrain vidéoludique. Ces différents terrains et les ethnographies combinatoires qui le composent sont pensés dans la volonté d’« identifier les différentes formes d’action dans lesquelles les personnes peuvent s’engager, ainsi que leurs combinaisons possibles »279 (Baszanger et Dodier, op.cit.). En conséquence, la nature de nos matériaux est caractérisée par une mise en ordre des données allant du domicile au LAN parties et à l’arène critique : du « proche » à celui « du public » (Thévenot, 1994).
Afin de clarifier nos différents matériaux, les tableaux ci-dessous recensent l’ensemble des données issues de ces combinaisons et nivellement empiriques. Ils vont du « proche » (entretiens et observations chez les gameuses) au « public » (jeu dans l’espace public et publicisation de la critique) sur lesquels cette recherche s’appuie.
Praxéologie de genre
Notre approche se place dans une volonté de poser le regard sur les pratiques et les espaces en les plaçant au cœur de l’analyse (Røpke, 2009). Cette démarche praxéologique, appliquée au domaine vidéoludique, passe par le recensement d’un grand nombre d’éléments à observer, à voir, à entendre et à saisir pour pouvoir enfin les comprendre. Pour autant, cette approche praxéologique n’est pas adoptée dans une perspective où les rapports sociaux de genre ne seraient qu’une simple variable distinguant les usages. En effet, la pratique mise au centre est celle des femmes devant se positionner et surtout composer avec des référentiels experts alliés au masculin. Partant de ce constat, la posture consiste dans une même dynamique à étudier la pratique vidéoludique et à voir comment les rapports sociaux de genre s’y réalisent dans l’action et certains de ses espaces. Il s’agira principalement de voir comment les gameuses s’intègrent dans ces sphères de pratique en proposant une approche praxéologique vidéoludique de genre. La terminologie « praxéologie du genre », originalement détaillée par Fabienne Malbois (2011), « se donne pour tâche de rendre compte des usages ordinaires des catégories de sexe, ainsi que des activités que celles-ci accomplissent au sein du cours d’actions dont il s’agit, à chaque fois de déterminer le sens »280 (ibid.). Sa démarche et la nôtre sont semblables dans la mesure où les deux attentions sont portées sur l’action en train de se faire, appréhendant ses détails comme des zones d’accomplissement du social et du genre en mouvement :
Or s’il paraît juste, d’un côté, de considérer que le monde social est appréhendé en tant qu’il est un ordre normal et naturel, il ne pas faut oublier, de l’autre, que ce qui constitue cette normalité et cette naturalité est ordinairement sujet à des réaménagements, à des changements, à des renouvellements. Aussi, à la lumière de la confrontation entre les thèses de la performance versus de l’accomplissement du genre, et de leurs écueils respectifs, nous proposons, quant à nous, de mettre en œuvre une sociologie praxéologique qui envisage les catégories de sexe à la manière de « méthodes culturelles » (Eglin, 1980) fournissant des points d’appui à l’action »281 – Malbois (…) qu’il s’agit d’observer afin de parvenir à la compréhension de ce qui est en train de se passer est la façon dont les propriétés normatives du dispositif « catégories de sexe », où l’une ou quelques-unes d’entre elles, sont constituées par les agents à un moment donné d’un cours d’action comme un trait pertinent de la situation, et sélectionnées afin d’organiser, soit de saisir sous un certain ordre, les actions en train d’être réalisées. Autrement dit, une telle sociologie s’intéresse à la capacité des individus à faire varier les échelles de pertinence des détails qui composent les situations, ceux-ci étant susceptibles de passer, dans le cours d’une action, d’un état de non-pertinence à un état de pertinence, et vice versa»282 – Malbois
L’essentiel de notre parti-pris de départ réside à entrer dans l’analyse par une praxéologie de genre vidéoludique. Celle-ci s’attache à comprendre, tout en considérant le genre comme un opérateur de sens (Malbois, op.cit.) dans l’action et dans des situations, des espaces vidéoludiques variées avec pour leitmotiv : comment joue-t-on et où se jouent les rapports sociaux de genre dans la pratique des jeux vidéo en ligne ?
Récapitulons
l’aune de la démocratisation des technologies et d’une grandissante présence des femmes dans le secteur, nous abordons la pratique des jeux vidéo en ligne multijoueur·euse·s en déconstruisant sa naturalisation au masculin. Il s’agit de la sortir du cloisonnement différencié selon lequel elle a été souvent pensée, en essayant de comprendre ces univers discursifs selon une approche dynamique des rapports sociaux de genre. Nous allons entrer par la « petite porte » de celles qui sont invisibilisées, minoritaires et considérées comme marginales. Situer et entrer, par les pratiques des femmes, dans les univers vidéoludiques à haut niveau d’expertise et les plus légitimés, amène à comprendre comment le genre s’éprouve et se construit au quotidien. L’enjeu est doublement situé dans le « devenir » et « l’être ». Il s’agit essentiellement de revenir sur les trajectoires et les registres d’appropriation et la confrontation aux épreuves de ces univers par les gameuses en analysant les degrés d’investissement et par quels biais/indicateurs ils se donnent à voir. Récapitulons les principaux questionnements : Comment devient-on une outsider ? Qu’est que nous apprennent les biographies des gameuses ? Quels types de transitions biographiques ont elles traversées ? Dans quelle mesure ces dernières ont impacté leur pratique ? Cette attention sur les trajectoires et les rapports à la culture des femmes se fera toujours dans une perspective active et en connexion avec leur pratique au quotidien. En effet, les dispositions, ces legs du passé, et ces initiations seront appréhendées dans l’ensemble des temps de la pratique qui participent à comprendre et à définir le présent de la pratique des jeux en ligne de type M(M)OG. La volonté analytique principale se situe dans sa caractérisation et dans l’agrégation de ces multiples réalités. Qu’est-ce qu’une gameuse de jeux vidéo ? Par quelles mesures, indicateurs et compétences se définissent les pratiques vidéoludiques en ligne ? Comment s’accomplissent-elles in situ et par quelles prises matérielles et selon quels critères sont-elles jugées ? Selon quels degrés une approche praxéologique des gameuses de M(M)OG donne-t-elle à voir ou pas des épreuves et dans quelle mesure les rapports de genre y jouent-ils un rôle ?
Toujours selon cette démarche mêlant déconstructions et dynamismes, il est indispensable de désenclaver la pratique de sa domestication. En effet, nous ambitionnons d’analyser cette dernière à travers plusieurs de ses espaces. Dès lors que nous nous centrons sur les femmes, cette intention révèle une visée double : non seulement analyser les pratiques et les suivre dans les différentes arènes dans lesquelles elles se jouent, mais également participer en parallèle à la sortie des femmes d’un espace dans lequel elles sont majoritairement cantonnées. Cet aspect entraine également l’avantage d’élargir le spectre des données et des lieux d’activité de la pratique afin d’observer les rapports sociaux de genre dans des contextes différents.