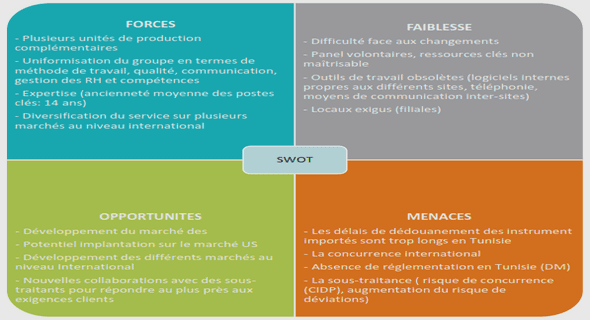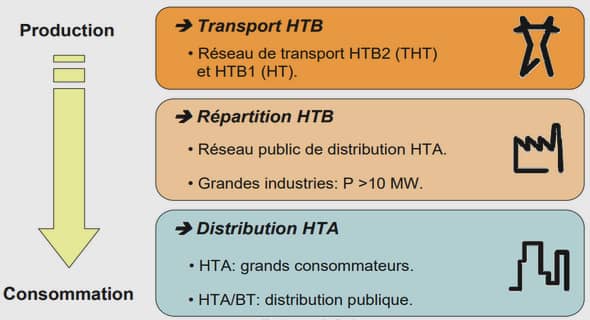L’image du monde extérieur
Les écrivains réalistes décrivent dans leurs textes littéraires le concret en faisant allusion à la vie matérielle. Le fait qu’ils décrivent avec précision le milieu d’une société nous donne une exacte représentation « des mœurs du siècle »8. Comme Stendhal, Balzac et Zola étaient des écrivains qui exprimaient la vérité en décrivant le milieu en détail. Colette Becker montre dans son livre comment les romanciers décrivaient les petits faits. Selon Becker, Zola expliquait comment il admirait la méthode d’un Balzac et d’un Stendhal dans un texte qu’il écrit dans ses réflexions : Différences entre Balzac et moi : « Eux [Balzac et Stendhal] seuls ne sont pas des poètes déguisés. Ils ont pénétré le mécanisme de la vie, en chirurgiens impitoyables, et nous ont expliqué nos misères et nos grandeurs. Leurs œuvres […] sont le plus grand magasin de documents que nous ayons sur la nature humaine »9. Alors en introduisant dans leurs romans des détails fondés sur l’observation du milieu, on va comprendre leur explication concernant la réalité de leur époque.
L’image des personnages
Pour avoir une bonne compréhension de la situation sociale de l’époque, il s’agit également de comprendre la situation de l’individu dans cette société. A travers les personnages, l’écrivain donne une représentation de l’homme et de sa relation avec la société.
On voit, par exemple, la description du monde aristocratique par le regard de Mme Bovary, une petite bourgeoise, qui était fascinée par ce monde-là. Par ce regard, Flaubert expose, selon lui, la réalité du monde extérieur, de la condition de l’individu et du milieu qui l’entoure. Dans l’œuvre Les essais de psychologie contemporaine, Paul Bourget fait une analyse des formes que prend le pessimisme chez des écrivains pessimistes à travers leurs œuvres littéraires. Selon Ninane de Martinoir 10 ci-dessous, Bourget dit à propos de Flaubert que « Ses personnages sont le produit d’une civilisation fatiguée […]. Dans toutes ses œuvres, il [Bourget] entend un sanglot, celui de l’homme qui a trop pensé. »10
Cela explique ce que Flaubert pense de sa société et de l’individu. Il traduit ses pensées à travers ses personnages. Ses personnages sont un bon exemple que G. Flaubert peut donner pour qu’on comprenne quelle est la situation de l’individu d’une certaine classe de la société.
Le développement de la science
Le XIXe siècle a expérimenté un essor de la science, visible dans les pensées positives exprimées par des écrivains par exemple. Ils avaient plus de foi dans le progrès scientifique que dans la religion. C’est-à-dire qu’ils n’ont peut-être pas trouvé une réponse convaincante à beaucoup de questions concernant la vie et la nature dans la religion. En revanche, la science a développé leurs idées grâce à l’expérience et à l’observation.
On peut dire que la méthode de l’observation dans la littérature a été remarquée grâce à l’intérêt pour la science à l’époque. La science a alors influencé la littérature et l’image des écrivains réalistes concernant l’humanité : L’apparition des sciences humaines, les modèles de classement et d’analyse découlant de la médecine et de zoologie influencent la vision de l’humanité d’un Balzac et plus tard d’un Zola. La littérature, selon eux, doit avoir une exigence scientifique de précision et de rigueur dans l’observation et l’expression, pour atteindre le vrai.11
L’auteur précise en décrivant les choses et les lieux par ses moindres détails. Par l’observation exacte, il montre les mœurs du siècle pour apporter son idée sur la vérité au lecteur. La méthode scientifique a inspiré les écrivains à étudier les sciences humaines, c’est-à-dire, les cultures humaines, leur histoire et leurs comportements individuels et sociaux.
Les parties différentes du réalisme présentées ci-dessus ont pour but de donner une conception plus claire de l’écriture chez les écrivains réalistes et de voir pourquoi ils écrivent de cette manière-là. On peut comprendre, après avoir lu ces parties, le style et le point de vue chez G. Flaubert et G. de Maupassant. En analysant leurs images du monde extérieur et leurs personnages dans les parties suivantes du mémoire, on aura une plus grande compréhension de leurs pensées réalistes concernant la situation de la femme.
La situation de la femme au XIXe siècle
Selon Yannick Ripa, l’auteur de Les femmes, actrices de l’histoire, la femme du XIXe siècle a vécu dans une société patriarcale où elle a dû se soumettre à l’homme. Elle a souffert du fait que cette société favorisait l’homme à la femme : « La femme est la moitié de l’homme, la réciprocité relève l’impensable. Il est fort, elle est faible ; il est chaud, elle est froide, il est le feu, elle est l’eau ; […] il est courageux, elle est craintive. »12
Ripa montre comment le XIXe siècle renforce la différence entre les deux sexes. Cette situation comparative nous donne une vision de l’inégalité entre l’homme et la femme et de la place que la femme occupe dans la société. On comprend, d’après le livre de Yannick, que les femmes en général, que ce soit les femmes privilégiées ou les femmes du tiers état, ont la même destination, la maternité. « La maternité est le but de la vie de toute femme. Elevée au rang de principe normatif et fixée par la nature. »13.
Ripa explique que selon les idées dominantes du XIXe siècle la femme, en respectant l’ordre naturel, doit être épouse, mère, élever les enfants et s’occuper de la maison.
La faiblesse de la femme est décidée non seulement par les lois de la nature mais elle est également inscrite par le Code civil, élaboré entre 1800 et 1804, qui légalise la hiérarchie des deux sexes en faisant de la femme « une éternelle mineure »14 et dépendante de l’homme (le mari, le père).
Ce sujet a été critiqué par des écrivains réalistes dans leurs œuvres. Leurs idées sur les femmes étaient influencées par leur temps. Ils ont exposé la condition féminine au XIXe siècle en montrant les aspects réels de la situation de la femme : l’inégalité, l’absence de droits et l’incapacité des femmes dans la société.
L’éducation des femmes
Les filles bourgeoises et nobles reçoivent l’éducation dans les institutions religieuses. L’enseignement religieux et limité prépare la fille à sa destination dans la société, c’est-à-dire d’être épouse et mère. Elle est « mal préparée à la vie, impuissante à se réaliser et à infléchir sa destinée […] »15. A cause de cette éducation limitée, la femme va vivre dans une société où elle va être ignorée et incapable de faire face à la dure réalité. Dans le livre Destins de femmes, désir d’absolu de Micheline Hermine, elle explique comment était la situation de la femme au XIXe siècle. « L’éducation religieuse isole les filles du monde, les oriente vers la rêverie, enseigne le mépris du corps, le dégoût de la sexualité, les détourne de la vie. »16
Alors, pour remplir cette incompréhension et ce vide dans sa vie, la fille imagine ce monde où elle espère vivre heureuse et cela va remplir son esprit et son cœur de « fausses idées sur la vie et l’amour »17. Dans ses rêveries, elle cherche une vie idéale où il n’y pas de déception comme dans la vie réelle.
Les compensations
Le mariage est la destinée prévue pour la femme comme Lieber l’explique: « Le but de la vie d’une fille, c’est l’amour et le mariage »18. Elle sait que sa destinée va être le mariage et la maternité. La seule chose qu’elle doit probablement faire comme femme, c’est d’attendre l’époux. Elle s’attend au bonheur comme épouse après le mariage, un bonheur qui va être comme dans ses rêveries, mais dans la réalité, beaucoup de femmes ont trouvé la souffrance et la déception dans le mariage. Comment trouve-t-on le bonheur et la satisfaction si on ne fait rien que de s’occuper de la maison et se soumettre à l’autorité du mari ? Du point de vue réaliste et critique, Flaubert et Maupassant représentent cette situation d’une femme insatisfaite, qui ne voit qu’un seul chemin devant elle, dans leurs personnages. Alors à cause de cette déception, elle va essayer de trouver une distraction pour fuir la réalité. La distraction ou l’oubli de « l’erreur de sa vie »19 pour une femme était non seulement vivre dans ses rêveries mais également le soin de ses enfants. La maternité était la fuite de cette erreur. Une autre distraction était d’avoir un amant qui permet à la femme d’échapper et « de retrouver leurs rêves d’adolescente et de revivre leur idéal enfui. »20
Les personnages Emma et Jeanne incarnent la condition de la femme faible et déçue à l’époque. Elles sont deux âmes qui représentent la difficulté et l’incapacité de vivre dans une société qui, selon l’article d’Ellen Constans, ne considère la femme que comme « un objet soumis aux manipulations de la société, des hommes et de la puissance divine »21. Constans explique que le type patriarcal et l’inégalité des sexes sont l’idéologie et la morale dominante dans la société du XIXe siècle.
Flaubert et Madame Bovary
Gustave Flaubert est né à Rouen en 1821. Il vient d’une famille bourgeoise heureuse et unie. Son père était le chirurgien de la ville qui dirigeait l’école de médecine et qui était « l’un des grands médecins de son temps »22. Le milieu médical a influencé Flaubert. On peut par exemple voir dans Madame Bovary la représentation de son père dans le personnage du docteur Larivière. On voit aussi comment Flaubert s’est inspiré des lieux et du milieu : « personnages et lieux ont été créés par l’artiste à partir de la réalité, ou plutôt d’un ensemble de réalités […] »23.
Flaubert montre sa vision pessimiste sur la vie à cette époque dans son roman réaliste Madame Bovary publié en 1857 et dans ses autres œuvres. Ses thèmes, comme par exemple la condition de la femme à l’époque, sont inspirés de la vie réelle. Il transmet une image parfaite de la réalité triste en utilisant la description et l’observation des choses.
Le roman de Madame Bovary raconte l’histoire d’une jeune femme, Emma, qui vit avec son père à la campagne. Emma a passé son temps à lire des romans romantiques en attendant son avenir heureux. Cette littérature romantique l’avait beaucoup influencée et elle rêvait d’avoir la même vie que celle dans ces histoires. Elle voulait découvrir le monde en épousant Charles Bovary, un personnage qui, quand on lit le roman Madame Bovary, est sans charme et manque d’imagination. Emma pensait que sa vie conjugale et son mari allaient ressembler à celle dans ses rêveries et les romans qu’elle lit. Mais pour elle, c’était le contraire. Pour cette raison, elle a cherché la vie parfaite en échappant à la réalité et en plongeant dans ses rêves. Mais à la fin, elle était menacée d’une saisie de ses biens et elle se suicide en prenant de l’arsenic.
Madame Bovary a été critiqué et refusé par la société parce que le roman manque de pudeur en écrivant sur l’adultère. Il était également attaqué parce que Flaubert a critiqué « l’institution du mariage »24 et la condition de la femme qui à l’époque était « comme un objet d’échange »25. A cette époque, les institutions religieuses n’acceptaient que des femmes insoumises. Cela n’est pas les mœurs que les filles doivent apprendre. C’était la raison principale pour ne pas accepter le contenu du roman ainsi que le langage et le style. Mais dans le livre de Stephen Heath Gustave Flaubert, Madame Bovary, il explique clairement que le roman a reçu un grand succès malgré toutes les critiques : « Everyone has read it, is reading it or wants to read it»26.
Le style de Flaubert dans Madame Bovary
Flaubert a mis cinq ans à écrire son roman Madame Bovary. Il voulait que le langage et le style soient parfaits pour donner, avec le contenu ou le sujet, une image complète de la situation. Il écrit à Louise Colet dans une de ses lettres : « Sais-tu combien j’ai fait de pages cette semaine ? Une, et encore je ne dis pas qu’elle soit bonne ! » 27.
Le roman expose des moments d’une vie où les actions montent vers le dénouement, le moment de la mort.
Par rapport à la présentation des personnages, Flaubert commence par décrire l’extérieur physique et puis son intérieur ou son caractère. Prenons l’incipit du roman qui décrit Charles Bovary : « un nouveau habillé en bourgeois » (p.47). Cette phrase et les phrases suivantes donnent une image extérieure d’un garçon qui vient de la campagne, en décrivant les détails physiques et la façon de s’habiller. L’auteur décrit la casquette de Charles Bovary en détail et cette scène nous dresse le portrait d’un nouveau garçon ridicule et très timide. Flaubert montre ici la présentation de la classe bourgeoise par la caricature et le caractère de Charles Bovary, un bourgeois sans personnalité.
On remarque le style réaliste par la description du milieu et des personnages. La description minutieuse du château du Marquis est un exemple réel de la vie élégante que les autres classes de la société souhaitent : « Les bougies des candélabres allongeaient des flammes sur les cloches d’argent ; les cristaux à facettes, couverts d’une buée mate […] des bouquets étaient en ligne sur toute la longueur de la table » (p.100).
On voit aussi une description scientifique exacte dans le roman en ce qui concerne la médecine parce que Flaubert était élevé dans un milieu médical. Cela l’a aidé à décrire, d’une manière exacte, la condition de santé d’Emma avant sa mort : « Sa poitrine aussitôt se mit à haleter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche.» (p.419). Dans l’ouvrage Madame Bovary et les savoirs, Juliette Azoulai montre dans son article « Le savoir médical dans la scène des abricots » le savoir médical de Flaubert en écrivant son roman Madame Bovary : «Madame Bovary est […] un roman de la médicine, où le savoir […] gravite autour d’un point aveugle : la maladie d’Emma.»28 Cela explique donc le savoir de Flaubert des traités de médecine quant il décrivait la maladie d’Emma par exemple.
A la fin du roman, on peut voir le style réaliste de Flaubert quand il décrit la scène de la mort d’Emma. Il photographie la mort telle qu’elle est avec des paroles courtes qui manquent de sentiments ou d’imagination. Il décrit l’agonie d’Emma en détail, ce qui nous donne l’impression de la souffrance : « Il fallut soulever un peu la tête, et alors un flot de liquides noirs sortit, comme un vomissement, de sa bouche.» (p.426). C’est un style descriptif et réaliste qui nous dit que la réalité n’est pas toujours belle. A travers ces descriptions qui expriment la souffrance et la déception dans la vie d’Emma, on voit également que c’est le point de vue de Flaubert sur sa société : « A cette époque, Flaubert affiche des opinions tranchées contre la bêtise de son époque, refuse d’être de son temps. Emma, en quelque sorte, c’est lui. »29. Et dans une lettre à Maxime du Camp que Flaubert a écrit, il exprime très clairement son dégoût contre sa société dès sa jeunesse: J’ai eu, tout jeune, un pressentiment complet de la vie. C’était comme une odeur de cuisine nauséabonde qui s’échappe par un soupirail. On n’a pas besoin d’en avoir mangé pour savoir qu’elle est à faire vomir. » 30
Dans les passages suivants, je ferai une analyse plus détaillée des traits réalistes dans Madame Bovary en analysant le personnage d’Emma qui, selon l’idée de Flaubert, représente les femmes au XIXe siècle.
Le personnage d’Emma
Emma est une femme rêveuse et romantique qui désire une vie parfaite et remplie d’amour comme celle dans ses lectures romanesques. Après le mariage, elle ne trouve pas la vie passionnante qu’elle attend quand elle s’intègre dans la réalité. Au contraire, elle est devenue malheureuse et à la fin, elle était désespérée et ruinée. Je vais donc commencer par analyser les traits romantiques, c’est-à-dire les rêves et la passion que l’héroïne espère réaliser dans sa vie réelle et puis faire une analyse de ce qu’elle a trouvé comme déception en parlant de son ennui, son insatisfaction et sa fuite de sa vie conjugale et son destin qu’elle juge misérable. Je réponds finalement à la question que j’ai posée dans l’introduction du mémoire pour savoir si Emma est une victime dans la société ou non ?
Le rêve et la passion
Emma Rouault était fascinée par la littérature et les histoires d’amour dès son adolescence. Cela a nourri sa passion et son envie de vivre ce genre d’amour : « Emma cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d’ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. » (p.84). Elle a lu de longs chapitres qui parlaient d’amours, amants, amantes […] » et elle « s’éprit de choses historiques, rêva bahuts, salle des gardes et ménestrels. » (p.87). Elle rêvait donc de cette vie riche et de ce temps splendide qu’elle aurait voulu vivre dans le passé.
En parlant des choses historiques et du passé dans le roman, Flaubert montre son ironie envers le romantisme. Il parle de «chansons galantes du siècle passé » et dit qu’« Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture » (87). Flaubert considère ces romans comme vieux parce qu’ils racontent des moments ou des choses irréels dans le passé. Dans le siècle romantique, on voit que les choses et les personnages sont décrits d’une façon qu’on comprenne que le monde est parfait: « Messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux […] et qui pleurent comme des urnes». A travers cet exemple, Flaubert explique l’idée du romantisme représentée, par exemple, par le stéréotype idéal l’homme, un homme qui a du courage, doux et sensible. Mais dans la réalité, la perfection n’existe peut-être pas.
Ces romans donnent donc un imaginaire et un sentiment idéal où elle a cru qu’il y aura de l’amour, un amant et le prince charmant. Mais à cause de son éducation au couvent, elle ne découvre la vérité qu’après le mariage. Flaubert expose donc ici la raison principale qui provoque l’avenir malheureux d’Emma.