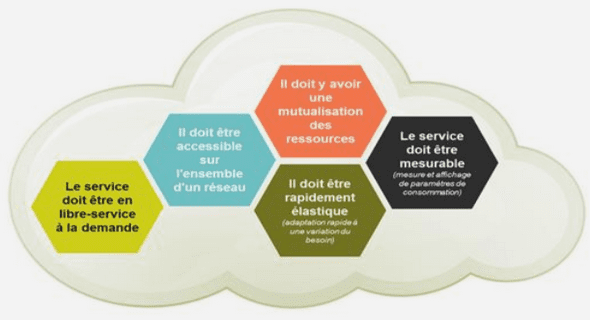L’individu et la communauté
Le système corporatiste sous Louis XIV se définit à travers une organisation de stratification sociale, basée sur des distinctions et des privilèges selon le sang, le rang et l’argent11. Tout le XVIIe siècle est défini par une grande perturbation économique. Ce déséquilibre est dû à plusieurs facteurs antérieurs, comme des prélèvements de taxes et des périodes de famine et de maladie 12 . La majorité de l’Europe subit une forte crise qui porte à conséquence sur l’organisation hiérarchique et sur les inégalités sociales. La France compte environ vingt millions d’habitants dont la grande majorité est paysanne. La société est majoritairement rurale et s’organise à travers des compositions de cercles de familles et de diverses cellules dans les villages. Un aspect important dans la société rurale est celui de la solidarité paysanne. La communauté est dirigée par des chefs acteurs des grandes décisions lors des assemblées13. L’époque classique se caractérise par une opposition entre l’ordre public et le domaine du privé. Cet antagonisme se traduit par l’idée de l’être humain comme supérieur à la nature, la nature étant sauvage et incontrôlée et devant être domestiquée. Le XVIIe siècle est à la fois inscrit dans une fascination pour la beauté de la nature et au besoin d’en être une autorité supérieure. L’homme dans le système patriarcal symbolise la culture, la civilisation, la maîtrise de soi et celui qui donne la sagesse. Cette vision du monde a ses origines dans la foi et la doctrine scripturaire chrétienne. Le concept de civilité arrive avec la Réforme et permet de distinguer l’homme raisonné et contrôlé de celui sous la domination des passions exprimant la perversité dans la doctrine chrétienne14. La civilisation permet au XVIIe siècle le contrôle de l’individu à travers une pensée collective15.
L’image de la femme dite naturelle
Le XVIIe siècle se caractérise ainsi par la séduction pour la nature et par la domestication de celle-ci à travers un système patriarcal fondé sur la raison et l’ordre en opposition aux pulsions et à l’animal. La société patriarcale compare les attraits du sexe féminin à ceux de la sauvagerie de la nature: belle et dangereuse. Il est ici possible de faire un parallèle avec la description d’Eve, symbole de l’origine de la tentation exprimé par celui de l’épisode du fruit défendu. Celui-ci est à la fois symbole de transgression et de pulsion, deux images que nous décrit La Fontaine dans les contes licencieux. Beaucoup de discours et de débats masculins de cette époque commencent volontiers par des phrases telles que : La nature a fait que… comme nous explique Duby et Perrot à travers l’histoire de la femme, ceci afin de distinguer les prédispositions différentes et les contraires apparents et cachés entre l’homme et la femme16. Cette représentation de la femme enferme ainsi celle-ci physiquement et mentalement dans un système de servitude face à l’homme, un ilotisme renforcé à travers l’acte du mariage et dans celui de l’acte commis de l’adultère où la femme est condamnable et non le mari. La glorification du genre féminin dans les textes littéraires ne rend pas toujours justice à la femme, ce sont souvent des rôles construits autour de normes qui l’enferment dans des archétypes, des images, des représentations17. Il faut ici prendre en compte déjà trois points essentiels: la dénégation pendant très longtemps d’écrivains féminins dans les académies par exemple, le manque d’éducation des femmes et l’idéalisation de la femme ou la représentation mensongère de celle-ci se construisant à travers des entités d’ordre social et moral au cours des siècles. Il y a la description du physique et du mental de la femme par l’homme et non par la femme. Qui écrit? Qui est l’auteur, qui porte son regard sur l’autre? Dans un article sur l’usage métaphorique dans la correspondance, Van Assche mentionne la symbolique utilisée pour décrire les diverses images de l’esthétique féminin construites sur des systèmes d’opposition comme celui de l’ombre à la lumière. Ces antonymes sont représentatifs de symboliques utilisées dans des écrits scripturaires pour écrire sur le thème du mal en opposition à celui du bien18. Nous pouvons par exemple comparer la littérature du XVIIe siècle à celle du Moyen âge pour comprendre que la littérature parfois inscrit l’image de l’esthétique féminin dans une construction figée et voulu par l’homme. Nous voyons ainsi que le roman courtois représente la femme comme passive et faible, dans un rôle d’attente et discours d’éloge de la femme, d’idéalisation esthétique et de perfection d’amour19. Les contes licencieux paraissent dans un premier temps être l’expression d’une misogynie et pourtant La Fontaine s’en défend par la justification du style employé comme une critique sociétale plutôt que celle d’un genre.
La Fontaine déclare: « Quant à la seconde objection, par laquelle on me reproche que ce livre fait tort aux femmes, on aurait raison si je parlais sérieusement: mais qui ne voit que ceci est jeu, et par conséquent ne peut porter coup? Il ne faut pas avoir peur que les mariages en soient à l’avenir moins fréquents, et les maris plus fort sur leurs gardes20. »
Cette explication est bien sûr celle d’un auteur masculin et d’autant plus se situant dans un siècle aux normes patriarcales. C’est pour cela que nous devons faire une réflexion d’autant plus neutre en précisant que l’analyse ne se situe pas dans une étude sur le genre mais sur celui d’une recherche historique à travers un écrit, même si nous analysons la représentation des personnages féminins. Pourquoi donc choisir cette approche du personnage féminin? Tout simplement parce que l’auteur choisit de mettre en avant la description des personnages féminins dans ces trois contes pour exprimer l’adultère. Les femmes sont décrites par l’auteur comme l’objet principal du désir masculin. Cette transgression passe par le sentiment du désir en rapport avec les attraits physiques féminins. La femme est donc ici un élément capital car elle se traduit comme le reflet de la société aussi bien en littérature qu’à travers les rôles normatifs que lui définit la société. Nous oserions ainsi même dire que la condition de la femme est révélatrice de l’état d’une société. Perrot et Duby décrivent ces rôles normatifs comme la « triade classique de la vierge, l’épouse et la veuve »21. Ces schémas qui lui attribuent des rôles sont soutenus par les conditions sociales et économiques qui dès sa naissance dictent son destin. La femme paysanne doit, selon son rôle, se marier, enfanter et obéir à son mari ou se retirer dans un couvent si ce choix lui est permis22. Cette construction sociale est soutenue par son physique en opposition à celui de l’homme et celle-ci est maintenue par des arguments aussi bien philosophiques qu’idéologiques. Selon Duby et Perrot, des théories faites à partir de discours médicaux datant du XVIe siècle présentent la femme comme inférieure naturellement en raison de l’apparence et la composition de son organe sexuel23.
Vie privée et vie publique
Le mariage au XVIIe siècle illustre la construction et la légitimité sociale de l’individu et de la vie familiale, mais cette légitimité comporte des inégalités entre les sexes. Comme le constate Maurice Dumas dans ces recherches historiques sur les contrats de mariage et la naissance de la famille moderne, ces traités évoluent au cours du XVIe et XVIIe siècles et ils développent un caractère plus religieux avec une priorité donnée à la vie de famille. Il y a une réelle réflexion sur la raison de s’unir qui va au-delà de celle de se manifester comme chrétien24. Le mariage apporte ainsi à la femme et à l’homme une légitimité individuelle au sein du village et une reconnaissance au sein de la paroisse. A partir du XVIIe siècle le mariage obtient la valeur de la grâce en étant défini comme un des sept sacrements 25 . Cependant le motif du mariage n’est pas toujours celui de l’amour. L’Eglise ne conçoit pas la reproduction comme un acte indispensable pour renforcer les liens de l’amour, mais il est accepté selon diverses échelles de valeurs telles que celles décrites par François de Sales. Celui-ci décrit la fréquence de l’acte sexuel en rapport au devoir des époux, l’acte sexuel devant s’inscrire non dans un sentiment de désir mais de préférence celui d’un devoir de reproduction26. Les recherches effectuées par Maurice Daumas montrent que l’image du péché véniel et de l’acte sexuel évolue progressivement. La tendresse et l’amitié deviennent ainsi des éléments de taille au sein du couple dans la description de la relation interne dans le mariage. Il y a selon lui une distinction sur l’image de la procréation entre le XVIe et XVIIe siècles 27. Celle-ci se rattache à la fois à l’évolution de la place de l’enfant au sein de la famille et à celle de la famille moderne. Ceci atténue l’ancienne vision de terreur liée à l’acte sexuel, même si le plaisir lié à l’acte s’inscrit toujours dans celui d’un péché véniel. L’adultère est considéré comme le plus grand des péchés et au XVIIe siècle, le mot qui définit la grâce du couple est celui de la fidélité mentale et physique28.
Notions sur les contes licencieux
Les contes de La Fontaine sont en majorité issus de la partie des nouveaux contes provenant d’un recueil de livres, Contes et nouvelles en vers, édité en plusieurs parties par Garbin, entre 1665 et 1671. Le style de La Fontaine est basé sur une hyper textualité, il reformule des textes plus anciens qu’il a choisis avec soin. Ces choix de texte ne sont pas anodins et sont destinés à faire réagir et à réfléchir, mais ils ne sont pas à la portée de tous même si La Fontaine décrit des situations où les trois ordres sont présents. L’utilisation littéraire est subtile, recherchée, complexe et charmante. Elle est poétique et plaisante et parfois très osée, elle s’oppose à l’amour décrit dans les romans de galanterie ou même de celles des poésies de La Fontaine29. La Fontaine utilise certaines techniques textuelles telles que la répétition, le questionnement et le discours argumentaire. Celles-ci lui permettent de communiquer de manière directe, il parle aux lecteurs comme si ceux-ci étaient face à lui, il a un vrai dialogue avec le lecteur, mais il lui demande de faire l’effort de l’imagination et du détachement au texte. Le thème de la transgression sexuelle est compliqué car il demande un effort considérable de la part de l’auteur pour suivre des codes de bienséance tout en traitant un thème interdit. A l’époque du XVIIe siècle la bienséance est fondamentale, car la censure peut être directe pour l’auteur, ce qui d’ailleurs fut le cas un peu plus tard, puisque ces contes furent censurés par La Reynie en 167530. L’effet de répétition qu’utilise La Fontaine est un élément très efficace et donne un rythme au texte et renforce certains temps-clés du texte. Dans Comment l’esprit vient aux filles, la première et la dernière phrase de la première strophe sont reliées par un effet de répétition qui souligne l’importance de la transgression dans le texte: « Il est un jeu divertissant pour tous…Or, devinez comment ce jeu s’appelle ». (La Fontaine : 811)
Les personnages des contes sont exposés à des situations exigeant un choix, définissant l’intention et la nature réelle de l’individu. Nous avons sélectionné trois contes sur le thème de la désillusion amoureuse qui place le désir du corps de la femme au centre de la réflexion. Cette analyse comporte l’étude des contes suivants: Les frères de Catalogne, La jument du Compère Pierre, Les troqueurs. Ces textes décrivent des sujets tabous sous forme de métaphores et de textes imagés où l’importance de la forme domine. Il est nécessaire pour l’auteur de cacher la transgression sexuelle en utilisant des phrases bordées de sous-entendus pour ne pas choquer le public et rester dans un texte à la fois franc mais supportable. La Fontaine utilise ainsi des textes déjà écrits, il s’inspire d’auteurs comme Boccace. Il n’invente pas vraiment, il réécrit des nouvelles à sa manière en enrobant les textes. Cela peut s’apparenter à un dialogue intertextuel. Comme nous l’explique Bermann dans son analyse sur la publication des nouveaux contes de 1674, La Fontaine utilise la ponctuation et le silence pour exprimer l’inexprimable. Il parle alors de voilage dans le texte31. La particularité de la forme de la satire qu’utilise La Fontaine est que celle-ci se situe dans une forme d’enfermement, elle traite d’un sujet de manière critique mais cette critique se situe dans un contexte d’époque et à une période qui rejoint la critique de l’auteur. Le deuxième point important à noter pour les textes de La Fontaine est la connivence demandée entre l’auteur et le lecteur. La forme satirique ou parodique nécessite de la part de celui qui lit le texte de s’y intéresser, d’y avoir accès et de pouvoir le comprendre de manière distancée, les textes étant issus d’autres textes plus anciens et y faisant par moment référence. Les contextes des contes demandent une prédisposition suffisante pour en comprendre ses subtilités, puisque tout n’est pas dit mais sous-entendu. Nous pouvons ainsi citer dans Les frères de Catalogne un dialogue entre le mari cocu et sa femme: Ah! monsieur, vous me faites tort, Reprit-elle, ce qui me presse, Ce n’est pas d’aller à confesse C’est de payer; car si j’attends, je ne le pourrai de longtemps ». (La Fontaine :616). Le qui de Madame faisant ici référence au cocuage de celle-ci.
L’expression des corps en excès aussi bien masculins que féminins permet notamment aux personnages féminins de franchir des barrières sinon difficilement surmontables au XVIIe siècle. La Fontaine utilise un discours moralisateur et pédagogique en parallèle et son choix des contes de Boccace renforce celui de son discours permettant ainsi aussi celui du récit initiatique de la sexualité 32 . Le récit/conte initiatique ou encore roman d’apprentissage propose une découverte du monde à travers le regard du protagoniste avec des passages de rites ou d’étapes à franchir où la personne est débutante, ce récit suggère que le protagoniste, curieux et peut-être insatisfait de sa condition, cherche autre chose, ailleurs. Ceci peut sous-entendre un mécontentement sociétal.
La représentation de la femme comme objet de désir et valeur marchande
Les frères de Catalogne
Les femmes sont présentées comme des épouses jeunes mariées à des hommes plus âgés. Elles sont décrites à travers des adjectifs tels que bêtes et frivoles. L’auteur décrit un discours tenu par l’homme où les frères tiennent un discours de persuasion aux épouses pour que celles-ci se permettent de commettre l’adultère. Dans ce discours, la femme est silencieuse, elle écoute mais elle ne participe pas aux discours tenus, ce qui fait qu’elle est dans un discours passif. L’auteur fait croire au lecteur que l’échange de conversation existe, mais c’est l’auteur qui à travers les paroles des frères développe la discussion et amène vers la transgression. La femme est présentée comme « le sexe » et lors du discours argumentaire la femme est interpellée avec l’aide du « vous » : « Au temps que le sexe vivait Dans l’ignorance » « Le sexe suit cette sentence », « Vous me direz que notre usage…Qui ne vous coûte presque rien…Qui vous témoigne notre zêle…Régler votre temps sur le nôtre » (La Fontaine : 612, 613)
Cette approche de la femme la rend impersonnelle et créé une sorte de distanciation avec les frères, c’est une manière de déshumaniser le personnage, regroupant la femme. Celle-ci perd de son individualité et devient plus facilement contrôlable, la relation devient aussi moins personnelle. L’auteur se sert de cette approche pour décrire la femme au sein d’un groupe, d’un sexe en opposition à celui du sexe masculin. Les frères représentent ainsi tous les hommes et les épouses toutes les femmes et la séparation entre les deux sexes devient marquée.
La femme est aussi présentée comme une forme de valeur d’échange pour payer la dîme que doit le mari à l’Eglise : « Rendez grâce aux bontés célestes, Nous laissant dîmer , sur un bien » (La Fontaine : 613), « Droit athentique et bien signé Que les papes nous ont donné : Droit enfin et non pas aumône : Toute femme doit en personne S’en acquitter trois fois le mois, Vers les frères catalanois. Cela fondé sur l’écriture….de reconnaissance et d’hommage…Or les œuvres de mariage Etant un bien » (La Fontaine : 613)
L’argument du cocuage balance entre l’obtention du salut individuel et celui du faux argument du devoir et de reconnaissance d’épouse envers le frère. Nous pouvons ici constater une étrange parenté avec le discours du droit seigneurial du Moyen Âge. Le mot bien est ici un mot de substitution pour ne pas prononcer le mot de corps de la femme, c’est le bien précieux, c’est la valeur de bien que possède la femme qui sert de monnaie d’échange. Dans la première partie La Fontaine suggère un discours fallacieux tenu par des représentants supposés se situer du côté et en faveur de l’Eglise. Le discours malhonnête 15 tenu par les frères est décrit comme celui d’un intérêt personnel pour commettre une transgression de chair. Le représentant de l’Eglise est ainsi mis au niveau de l’individu qui agit en rapport avec ses pulsions, il est ainsi humanisé et non plus une institution ou représentant de celle-ci. La femme est ici décrite comme jeune, belle et ignorante, elle est ici décrite comme passive face aux discours masculins. La deuxième partie du conte marque un tournant dans le déroulement de l’histoire puisque celle-ci se construit autour de l’action de l’acte lui-même.
Les Troqueurs
La Fontaine présente deux hommes menant une transaction d’échange de leurs épouses. Les épouses sont comparées entre elles, l’une étant belle et l’autre agréable à vivre. En premier lieu La Fontaine compare la valeur d’un amour à celui d’un bon plat. La femme est représentée en tant qu’objet. Mais le sentiment du désir et du plaisir est capricieux et il semble que La Fontaine décrive l’amour comme un sentiment éphémère : « Le changement de mets réjouis l’homme : Quand je dis l’homme, entendez qu’en ceci La femme doit être comprise aussi. » (La Fontaine : 819).
Cette vision de l’amour comme variable peut d’une certaine manière rejoindre le message du discours chrétien paulinien. Daumas évoque l’argument que l’excès de l’acte sexuel dans le mariage sans relation approfondie provoque la lassitude des conjoints et crée un vide 33. Cette comparaison avec la nourriture exprimée par La Fontaine peut donc soutenir la réflexion sur la fragilité du couple.
Puis l’auteur présente les personnages principaux: deux hommes débattant sur d’autres hommes ayant choisi de changer d’épouses ou de femmes: J’ai dans l’esprit une plaisante affaire. Vous avez sans doute en votre temps Plusieurs contrats de diverse nature, ne peut-on faire un où les gens Troquent de femme ainsi que de monture? » (La Fontaine: 819)
La femme est ici présentée comme un objet de vente ou d’échange et celle-ci est décrite comme ayant la même valeur que celle d’un animal. Plusieurs comparaisons de ce type prédominent dans le texte, un homme parle de son épouse comme de ses animaux, les époux comparent entre eux la beauté et le mental de leurs femmes : « Mes brebis sont ma femme…Chacune vaut en ce monde son prix La mienne ira but à but pour la tienne On ne regarde aux femmes de si près. » (La Fontaine: 820)
Les deux hommes compère Etienne et compère Gille comparent dans un dialogue des attraits et caractéristiques de leurs épouses. La discussion de rajouter un âne en compensation s’argumente par la valeur que prend la plus grande beauté physique de l’une des deux femmes. La femme Tiennette a ici une plus grande valeur esthétique que celle de la femme Jeanne selon leurs regards masculins et ici la valeur esthétique du corps féminin et ses compétences morales sont situées au même niveau que ceux d’un animal. Dans la société rurale l’importance d’un animal est primordiale à la survie d’une ferme. Il donne une plus-value au paysan et à sa famille. Le revenu des récoltes allant en majorité pour payer les taxes et les récoltes pouvant varier de beaucoup, un animal apporte de la nourriture et de l’aide en plus34 : « Tiennette n’a ni suros ni malandre…Jeanne a le corps net comme un petit denier…et Tiennette est ambroise…Tu ne connais Jeanne ma villageoise..Je t’avertis qu’à ce jeu…m’entends-tu?…Tiennette et moi nous n’avons qu’une noise A Jeanne; top; puis à Tiennette; masse. » (La Fontaine: 820, 821)
Dans la comparaison physique des deux femmes, l’homme maintient la femme en dehors du dialogue. Celle-ci est évaluée selon ses critères physiques et mentaux. Le regard masculin porte un jugement sur la valeur de la femme. Les maris ne se demandent pas si leurs épouses souhaitent changer de partenaires. Un des hommes cite en exemple un mari qui, lassé de sa compagne, l’abandonne rapidement pour satisfaire ses propres désirs: « Car messire Grégoire Disait toujours…cependant Il a changé : changeons aussi compère, Très volontiers reprit l’autre manant ». (La Fontaine : 820)