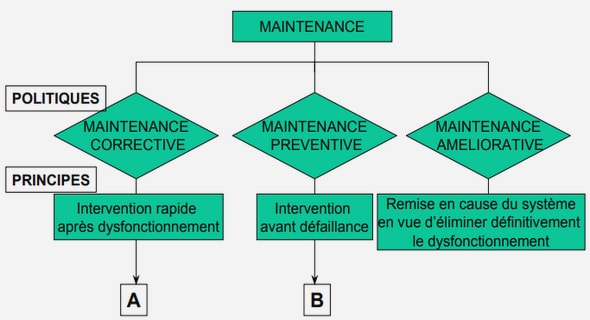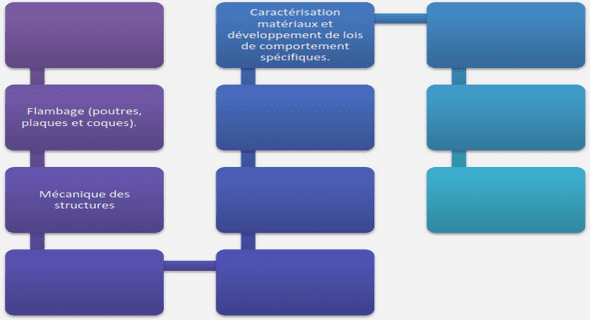L’AGE D’OR DE LA PIRATERIE
L’âge d’or de la piraterie désigne une ou plusieurs montées de la piraterie dans le début de l’époque moderne. Dans sa définition,l’âge d’or de la piraterie s’étend des années 1650 aux années 1730 et l’on distingue trois montées séparées de la piraterie dont la première fut la période des flibustiers vers 1630 à 1680,caractérisée par les marins Anglais et Français basés en Jamaïque et sur l’île de la Tortue ,attaquant les colonies et navires Espagnols dans les Caraïbes et à l’Ouest de l’Océan Pacifique ;la seconde fut nommée « la ronde des pirate » des années 1690,associée aux voyages longue distance en provenance des Bermudes et des Amériques pour voler des cibles Arabes et la Compagnie Anglaise des Indes orientales dans l’Océan Indien et la mer Rouge. La dernière c’est la période de l’après-guerre de Succession d’Espagne s’étendant de 1716 à 1726 quand des marins Anglo-américains et des corsaires laissé inoccupés par la fin de la guerre se sont engagé en masse dans la piraterie aux Caraïbes, sur la côte Est Américain, la côte Ouest Africain et l’Océan Indien.
LA PIRATERIE MODERNE
La définition de la piraterie faisant foi en droit international est issue de la Convention de Genève sur la Haute Mer du 29 avril 1958 (article 15), reprise ensuite dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (dite Convention de MontegoBay ou UNCLOS selon son acronyme anglais) du 10 décembre 1982. En son article 101, elle dispose que :
« On entend par piraterie l’un quelconque des actes suivants : tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire agissant à des fins privées, et dirigé: – contre un autre navire ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer – contre un navire, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun état.
tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire lorsque son auteur à connaissance de faits que ce navire est un navire pirate;
tout acte ayant pour but d’inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b) ou commis dans l’intention de les faciliter. »
Deux critères sont particulièrement significatifs :
le lieu : la haute mer, soit au-delà de la limite des eaux territoriales (12 milles nautiques) ou des eaux archipélagiques. En deçà, il s’agit de brigandage armé.
la finalité : la piraterie se distingue du terrorisme par sa finalité privée (le gain) et non politique ou revendicative.
Le premier critère est aujourd’hui problématique dans la mesure où l’immense majorité des actes de piraterie et de brigandage armé répertoriés ont lieu à l’intérieur des eaux territoriales.
LES CONSEQUENCES INCONTESTABLES DE LA PIRATERIE MARITIME
L’Etats, les travailleurs, les créateurs sont aussi victime que les navires, les cargaisons et les membres d’équipages attaqués par des pirates.
Un impact néfaste à l’image des Etats côtiers concernés : L’atteinte portée à l’image et à la réputation des États pourrait nuire certains projets maritimes. Prenons l’exemple de la Malaisie, l’établissement d’une zone portuaire à TanjungPelepas, au sud du détroit de Malacca pour concurrencer Singapour, contraint les autorités à un effort considérable pour sécuriser les approches maritimes afin de ne pas effrayer d’éventuels clients ou investisseurs, sans aucune garantie de succès.
A Djibouti, le projet concrétisé en 2008 pour développer leur port a été fragilisé par la hausse des primes d’assurance et le recul des investisseurs.
Il ne s’agit pas seulement de sécurité maritime : les attaques pirates perturbent le trafic commercial entre l’Europe et l’Asie via le Moyen-Orient et elles constituent aussi une menace à la sécurité énergétique ou économique des Etats.
Les attaques pirates contre des supertankers comme le Nagasaki Spirit en 1992 ou le Sirius Star en 2008 font craindre pour la sécurité des approvisionnements énergétiques du Japon comme de l’Europe : 30% du pétrole brut mondial transite par le Golfe d’Aden, tandis que 70% du pétrole chinois et 80% du pétrole japonais transite par Malacca, soit les points les plus actifs de la piraterie mondiale.
La piraterie anéantit les fondations des industries culturelles locales et a une influence néfaste sur leurs relations avec des partenaires étrangers. Elle affaiblit les entreprises licites qui ne sont pas en mesure de rivaliser avec les bas prix pratiqués par les pirates. Elle aboutisse même à la détérioration de la perception de la région comme destination touristique en plus de l’accroissement du coût de la sécurité dans la région.
LA PRISE EN CHARGE DU DROIT INTERNATIONAL FACE A CE FLEAU
Les problèmes juridiques : La souveraineté de l’Etat La souveraineté des Etats constitue un principe fondamental du droit international public autour duquel s’organisent les relations. Puisque chaque Etat, par sa souveraineté est pleinement et exclusivement compétent sur son territoire, aucun autre Etat ne peut intervenir dans les affaires intérieures d’un Etat.
Mais, cette souveraineté exclusive est remise en cause par le principe de la relation internationale du fait qu’un Etat souverain est soumis au droit international public61. La souveraineté désigne ainsi le caractère de l’Etat qui n’est soumis à aucune autorité supérieure, mais qui est soumis au droitinternational dans ses relations avec les autres Etats souverains, qui sont ses égaux. Le droit international impose des limitations à la souveraineté des Etats.
Depuis la codification par les conventions de Genève de 1958 les espaces maritimes distinguent la haute mer et les mers territoriales, celles-ci étant placées sous la souveraineté de l’Etat côtier. La convention de MontegoBay, a fixé à 12 milles marins la profondeur maximale des mers territoriales et créé la zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins, ces distances se mesurant à partir des lignes de base, c’est-à-dire de la laisse de basse mer. Désormais la haute mer, commence donc à partir de 200 milles. La ZEE n’est pas une zone de souveraineté de l’Etat côtier mais une zone dans laquelle celui-ci exerce des droits souverains et de juridiction dans des domaines limitativement énumérés par la convention : l’exploitation et l’exploration, la gestion des ressources naturelles, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine etc.
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER : LA PIRATERIE MARITIME DE RETOUR SUR LA SCENE INTERNATIONALE
§1-Un crime longtemps reconnu par la coutume internationale
I- La piraterie dans l’Antiquité
1- Considération générale
2- La piraterie et la législation maritime dans l’antiquité
3- Des pirates grecs
4- Rome et la piraterie
5- La piraterie en Europe
II- L’AGE D’OR DE LA PIRATERIE
SECTION 2 : LA PIRATERIE MODERNE
§1- Définitions
§2-Une résurgence pluricausale
a- Facteurs socio-économiques
b- Facteur due à l’instabilité politique
c- Positionnement géographique
§3-Les modes opératoires
1- L’attaque au quai
2- l’attaque en mer
a- Un rayon d’action étendu et des modes opératoires perfectionnés
b- Des modes opératoires visant à rançonner les compagnies pétrolières
c- L’organisation à bord des pirates
CHAPITRE DEUXIEME : LA PIRATERIE MARITIME ET SES EFFETS
SECTION 1 : LES ZONES LES PLUS TOUCHEES
§1- l’Afrique et la péninsule Arabique
I- Le golfe d’Aden
II- Le golfe de guinée
I- Piraterie en Asie du sud-est
II- La piraterie dans le reste du monde
SECTION 2 : LES CONSEQUENCES INCONTESTABLES DE LA PIRATERIE MARITIME
§1- Un impact néfaste à l’image des Etats côtiers concernés
§2- Des atteintes réelles et intolérable à la vie humaine
§3- Les impacts de la pêche européenne au large de la somalie
§4- Impact sur le marché des assurances maritimes et les propriétaires d’un navire
§5- Impacts sur la créativité et les industries culturelles
§6-Atteinte à la liberté des mers
§7- Impacts sur le trafic maritime
CHAPITRE PREMIER : LE CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE LA PIRATERIE MARITIME
SECTION1 : LA PRISE EN CHARGE DU DROIT INTERNATIONAL FACE A CE FLEAU
§1-Les problèmes juridiques
I- La souveraineté de l’Etat
II- Le régime juridique de la haute mer
§2- Les Conventions Internationales, et d’autres Organisations encadrant la piraterie
I- La Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer : Convention de Montego Bay (CMB) L’article 101 de la convention
II- Dérogation à la loi du pavillon : La compétence universelle
III- Le droit applicable à la piraterie prévu par la convention de Montego Bay
IV- La charte des Nations –Unies
1- Le chapitre I de la charte
2- Le chapitre VII de la charte des Nations Unies
V- L’Organisation Maritime Internationale
VI- Le Bureau Maritime International
§3- Les divers textes encadrant la piraterie maritime
I- Les principales Résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
II- La Convention de Rome de 1988 : La Convention SUA
L’article 1.5.02. – Définition d’un navire ou d’un aéronef pirate
IV- La Convention Safety Of Life At Sea
SECTION 2- LES INSTITUTIONS PRIVEES FACE A LA PIRATERIE
§1- Les assureurs
I- Piraterie lucrative et piraterie politique
II- L’intervention des assureurs
III- La police « Risques de guerre et Assimilés »
IV- La police « Kidnapping & Rançon »
V- Principe de la contribution aux « avaries communes »
§2- Les armateurs
I- Un moyen de sécurité préventive et défensive
SECTION 3- LES PROBLEMES DE DROIT POSE PAR LA PIRATERIE MARITIME
§1-En matière de répression pénale
§2- Des coûts et financements très importants
§3-Une vide juridique à combler
I- Un droit de poursuite limité : Interruption de poursuite en cas de constatation d’acte illicite
II- Le respect de la non-ingérence
CHAPITRE DEUXIEME : LES MOYENS DE LUTTES APPORTES POUR COMBATTRE LA PIRATERIE
SECTION1 : DES SOLUTIONS PRISE AU NIVEAU NATIONAL
§1- Les diverses répressions : des luttes traditionnelle datant de l’époque moderne
I- Le modèle grecque et romain de répression de la piraterie
II- La guerre de Rome contre la piraterie
III- Rhodes en lutte contre la piraterie
IV- La chasse aux pirates à l’époque moderne : procès et exécutions
§2- Des mesures récemment prises par divers Etats
I- La France et la lutte contre la piraterie
1- Des dispositifs sont mise en place
2- Les incriminations de la piraterie en droit commun français
II- Les dispositions prises par les armateurs
III- L’envoi par les Etats des moyens militaires
IV- L’Afrique s’unie pour lutter contre la piraterie
1- La Communauté Economique des États de l’Afrique Centrale(CEEAC)
2- La Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
3- La Commission du Golfe de Guinée
4- L’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC)
V- Mesure de répressions
VI- D’autres initiatives unilatérales
1- En Asie : les Etats réalisent la nécessité de riposter les attaques fortement accru
a- les Malacca Straits Sea Patrols (MSSP )
b- Eyes in the Sky (EiS)
c- l’Intelligence Exchange Group (EIG)
d- l’Information Sharing Centre (ISC)
e- l’Information Fusion Centre (IFC)
I- Coordination Internationale des forces navales
1- L’opération EUNAVFOR Atalanta : une première pour l’Union Européenne
2- L’opération Ocean Shield
3- La Combined Task Force 151
4- International Recommended Transit Corridor (IRTC)
II- La réaction des Organisations Internationales
1- Les résolutions de l’ONU
2- Les rôles des bâtiments du groupe OTAN
3- Les actions de l’Union Européenne
4- Le rôle de l’Organisation Maritime Internationale (OMI)
§3-Les mesures prévu par le Droit International
Le cadre du droit commun: la CNUDM ou CMB
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE