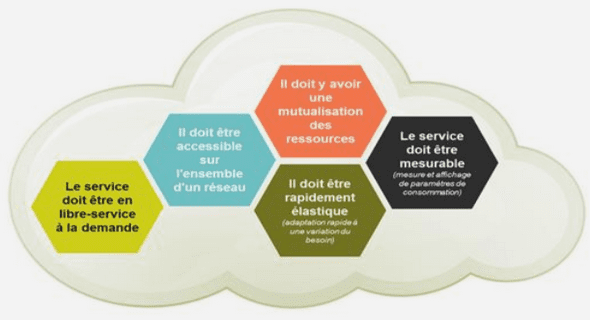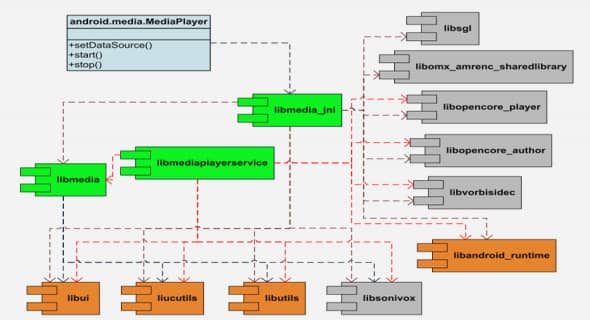Les liens entre le droit et l’économie : la possibilité d’un codage économique des questions juridiques
Le cloisonnement de l’économie et du droit est souvent critiqué, tant par les économistes que par les juristes. Ainsi, Hayek déplore « l’éclatement des disciplines » qui a pour conséquences « que les règles de juste conduite que le juriste étudie servent un genre d’ordre dont le juriste ignore largement le caractère ; et que cet ordre-là est principalement étudié par l’économiste qui, à son tour, est semblablement ignorant du caractère des règles de conduite sur lesquelles repose l’ordre qu’il étudie »36. Pour le juge Brandeis, « a lawyer who has not studied sociology and economics is very apt to become a public enemy »37. De même pour le juge Holmes, « for a rational study of the law, the black letterman may be the man of the present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics (…) As a step toward that ideal it seems to me that every lawyer ought to seek an understanding of economics. The present divorce between the schools of political economy and law seems to me an evidence of how much progress in philosophical study still remains to be made »38.
Toutes ces critiques signalent le lien de parenté étroit entre l’économie et le droit. Pour certains the connections between law and economics appear to lie in the origins of economics itself. Indeed, they are perhaps genetically related… »39. Ainsi, Adam Smith, s’il est souvent considéré comme le fondateur de l’économie politique moderne, est aussi l’auteur des Lectures on Jurisprudence. Ce père de l’économie politique était d’ailleurs fils de juriste (même si son père meurt avant sa naissance). Bentham était lui aussi à la fois juriste et économiste. Backhaus fait remarquer, dans le même sens, que « For Wolf, for instance, applying an economic analytical argument to a legal question was still a standard approach. Only after the disciplines had gone their separate ways would it seem natural for an economic problem to be met with an economic analytical tool, and a legal problem with the proper legal analytical tools »40. Autrement dit, tant que l’économie et le droit ne se sont pas constitués en disciplines, la séparation des approches est impossible, seule la question posée compte.
Plus généralement le lien de parenté se retrouve dans l’étymologie même du mot économie. En effet, celui-ci vient du grec « oikos nomos » qui signifie littéralement la loi ou l’ordre de la maison. Nomos peut aussi renvoyer aux règles de juste conduite41. L’économie politique a d’ailleurs été perçue comme un outil permettant d’assurer, avec le droit, l’ordre de l’Etat.
A l’étymologie, qui ne peut jamais constituer un argument conclusif, il faut ajouter la proximité des problématiques42. La question de l’allocation des ressources rares est ainsi centrale tant en économie qu’en droit. La rareté des ressources est même à l’origine du droit et de l’économie. Si nous sommes dans une société d’abondance, l’économie n’a que peu d’intérêt puisque justement elle suppose une rareté. De même, le droit tend à disparaître car il touche spécifiquement à la question du conflit qui renvoie, elle aussi, à la question des ressources rares. La rareté est aussi liée, plus profondément, à la présence d’autres individus, autrement dit à l’existence d’une société. A la problématique de l’allocation des ressources, il faut donc ajouter celle de la coordination et de l’interaction efficiente. L’économie touche plus spécifiquement la coordination par le marché mais cherche aussi à évaluer l’impact d’autres modes de coordinations43. Le droit vise à instaurer des règles permettant une coordination des individus (par exemple, le fait de rouler à droite ou à gauche. La coordination suppose que tous les individus aient les mêmes intérêts) ou une interaction efficiente (par exemple les règles du droit pénal ou du droit constitutionnel. L’interaction efficiente vise les cas dans lesquels les individus n’ont pas nécessairement les mêmes intérêts ; le cas du vol est typique)44. Plus généralement, le droit et l’économie s’intéressent à la question de « l’ordre » dans la société et s’avèrent être des palliatifs puissants contre les limites de la rationalité humaine.
De la même manière, tant en économie qu’en droit, les choix sont supposés se réaliser sur des bases rationnelles. Il ne s’agit pas simplement de prendre une décision mais de prendre une bonne décision relativement à un certain nombre d’objectifs et de contraintes. Le choix rationnel est actuellement au centre de la définition de l’économie même si l’idée qu’il véhicule est moins transparente qu’il n’y parait au premier abord45.
Enfin, la représentation symbolique du droit via la balance et l’iconographie de la déesse Thémis n’est pas sans rappeler l’analyse coûts / bénéfices et sa neutralité affichée. De même, le glaive renvoie à la logique de l’incitation. Là où Thémis opérait un arbitrage, l’analyse économique propose un calcul46.
Cette représentation rend floue la frontière entre droit et politique (ce qui a certainement favorisé l’émergence de ce type d’analyse dans les pays de common law). Néanmoins, l’étude de la fonction du droit est tout aussi nécessaire que l’étude de sa forme et il ne nous semble pas possible de définir véritablement le droit sans faire référence à ces deux aspects. La forme explique la fonction et la fonction est relative à la forme. Négliger l’une ou l’autre, c’est se priver de la possibilité d’une perspective globale.
L’origine commune du droit et de l’économie47 aurait ainsi pu conduire à un constant dialogue, même après la séparation et l’autonomisation des disciplines au cours du XIXe siècle. Par un effet de retour, elle a permis le codage économique des questions juridiques. En effet, comme nous le rappelle Menard, « l’application d’une méthode hors de son domaine d’origine ne saurait créer une nouvelle théorie dans le champ où elle intervient sans l’émergence préalable, dans ce champ, des questions et des concepts qui rendent l’application pertinente, c’est-à-dire ‘significative’ »48. Il faudra néanmoins attendre les années 1960 pour que naisse véritablement l’analyse économique du droit dans sa forme moderne.
L’apparition du mouvement Law & Economics sous sa forme moderne
Les origines du mouvement Law & Economics sont plus profondes que le milieu du XXe siècle. Il serait possible d’en trouver des traces dans les écrits de Hobbes, Smith, Hume, Bentham, Blackstone, Mill, voire même Aristote ou Thomas d’Aquin !49 Nous ne développerons pas plus avant ce parallélisme, puisqu’il est assez délicat de savoir si ce dernier est construit ou s’il est réel. Néanmoins, il nous invite à nous interroger sur la spécificité des analyses issues du mouvement Law & Economics : changeons-nous simplement les flacons ou modifions-nous aussi le contenu ?
D’une manière générale, l’évolution du dialogue entre juristes et économistes, sauf en ce qui concerne son aboutissement, est semblable dans presque tous les pays européens50, mais aussi aux Etats Unis51. Ainsi, dès la moitié du XIXe siècle, une réflexion économique appliquée au droit et une prise de conscience de l’interdépendance des deux disciplines apparaissent, incarnées par l’économie institutionnaliste. Le droit devient – et l’inspiration positiviste n’est pas négligeable –un outil de gestion et un outil au service de la politique. Comme tel, il ne peut se désintéresser des problématiques économiques.
Cette analyse déclinera ensuite à partir des années 1920. Hovenkamp avance quatre paramètres susceptibles d’expliquer l’intérêt pour une analyse économique des institutions et du droit à cette période : « (1) the widespread application of evolutionary models to the development of both law and economics theory ; (2) the influence of the German Historical School, which encouraged economists to spend more time studying social institutions, including law; (3) the rise of utilitarian welfare economics, with its enhanced concern about the relationship between distribution and efficiency; and (4) the development of the social sciences, which were perceived to include both law and economics, and the widespread belief that the social sciences must somehow be “unified” »52.
Le vent positiviste qui souffle sur la seconde moitié du XIXe siècle est certainement l’élément déterminant à la fois de l’émergence de ce type de raisonnement (et plus largement de la mise en interaction du droit et de l’économie) mais aussi de son déclin. La méthode utilisée est souvent mise en avant pour expliquer l’échec de cette analyse53. Ainsi, pour Coase, « the American institutionalists were not theoretical but anti-theoretical, particularly where classical economic theory was concerned. Without a theory they had nothing to pass on except a mass of descriptive material waiting for a theory, or a fire »54. Tout aussi virulent, Blaug met en avant le phénomène du « raconter des histoires [storytelling] » pour évoquer la « méthodologie » des institutionnalistes : « ‘Raconter des histoires’ utilise la méthode de ce que les historiens appellent la colligation, c’est-à-dire relier ensemble des faits et des généralisations de faible niveau, des théories de niveau élevé et des jugements de valeur dans une narration cohérente, le tout lié par le sentiment d’un ensemble implicite de croyances et d’attitudes que l’auteur partage avec ses lecteurs.
‘Raconter des histoires’ manque de rigueur, manque d’une structure logique définie, il n’est que trop facile de vérifier et virtuellement impossible d’infirmer »55. Ainsi le positivisme a œuvré tant au rapprochement des disciplines qu’à leur autonomisation (et donc à leur séparation) via la construction de méthodologies spécifiques.