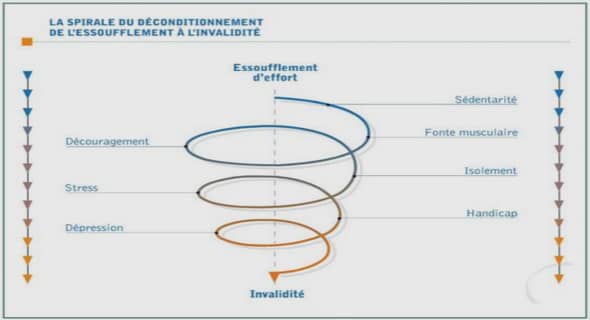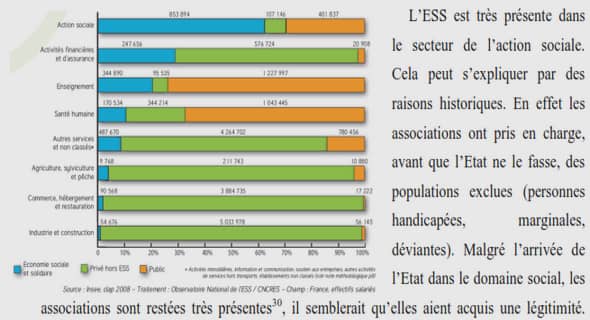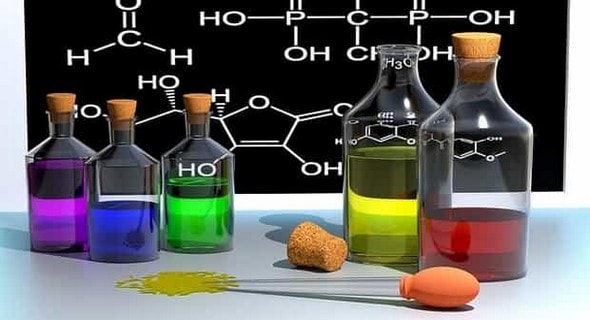La pression anthropique liée à l’agriculture sur les émissions de N2O
Méthodes d’estimation des émissions de N2O
Mesures directes in situ
La méthode de mesure des émissions de N2O la plus répandue est celle des chambres statiques manuelles (méthode détaillée dans le Chapitre 2). Cette méthode présente l’avantage d’être peu coûteuse, d’être facilement déployable entre différents sites et de pouvoir être utilisée sur des sites expérimentaux de taille réduite (Reeves and Wang, 2015) ou ne disposant pas d’accès à l’électricité. Néanmoins, ce dispositif n’est pas autonome et demande la présence régulière d’un personnel pour assurer un échantillonnage temporel exhaustif. L’échantillonnage spatial est également limité. Les fréquences temporelles et la couverture spatiale des mesures, si celles-ci ne sont pas représentatives, peuvent avoir un impact significatif sur l’estimation des émissions et des bilans N2O d’un site (Zhang et al., 2014 ; Tellez-Rio et al., 2015 ; Reeves et al., 2016 ; Delon et al., 2017 ; Vinzent et al., 2017 ; Tallec et al., 2019). L’emploi de chambre automatiques dynamiques (Peyrard et al., 2016 ; Tallec et al., 2019) sont une méthodologie alternative permettant d’augmenter la fréquence d’échantillonnage temporelle et réduire les incertitudes liées aux variations temporelles des émissions de N2O (méthode détaillée dans le Chapitre 2). Cette méthode présente l’avantage de fonctionner en autonomie, de réaliser les mesures de fraction molaire de N2O in situ et de pouvoir effectuer des mesures à des moments plus contraignants (la nuit par exemple) par rapport aux chambres statiques. Néanmoins, ce dispositif expérimental est difficilement déménageable sur d’autres sites et peut tomber en panne. Les développements technologiques récents ont conduit à la mise au point de la méthode des fluctuations turbulentes (Eddy-Covariance) appliquée au suivi des émissions de N2O (méthodologie largement reconnue et appliquée depuis quelques décennies au CO2, H2O et CH4 notamment). Cette méthodologie présente l’avantage d’effectuer des mesures en continu à haute fréquence (10 Hz avec une intégration des flux à la demi-heure) sur de grandes surfaces (plusieurs dizaines de m² à plusieurs hectares) (Nemitz et al., 2018) permettant de s’affranchir de l’hétérogénéité spatiale et temporelle des émissions de N2O. Néanmoins, les filières de traitement de données sont nettement plus complexes et reposent sur de nombreuses hypothèses. Malgré les différences importantes dans le fonctionnement et leur mise en œuvre, Tallec et al. (2019) ont montré que les 3 méthodologies de mesures donnaient des résultats comparables en termes de dynamique. La pertinence de l’analyse de la dynamique et du calcul des bilans annuels des émissions de N2O dépend donc plus du nombre de données qualitativement correctes et manquantes que de la méthode de mesure utilisée. De ce fait, le choix de l’utilisation d’une méthode se fait au regard des objectifs de l’étude (bilans, processus, etc.) et des équipements disponibles sur place (accès à l’électricité par exemple).
Méthodes de reconstruction de données manquantes
Les base de données constituées avec les méthodes de mesure présentées en section 2 chapitre 2 peuvent néanmoins comporter de longues périodes de données manquantes dû à des fréquences de mesure trop courtes dans le cas des chambres statiques, à des déplacements du matériel technique dans le cas des chambres automatiques ou à des pannes et/ou une filtration et suppressions des données après contrôle qualité pour les chambres automatiques et les mesures Eddy Covariance. Donc quelle que soit la méthodologie utilisée, les pertes de données sont inévitables. Ce manque peut-être critique pour la compréhension et l’interprétation de la dynamique des émissions ainsi que pour les calculs de bilans annuels de N2O. Il n’existe actuellement aucun consensus sur la méthode à utiliser pour combler ce manque de données (Nemitz et al., 2018). La méthode la plus couramment utilisée dans les études sur les émissions de N2O est la technique utilisant l’interpolation linéaire (Tellez-Rio et al., 2015 ; Vinzent et al., 2017). Mais cette méthode présente le désavantage de ne pas prendre en compte les variabilités environnementales ayant un impact sur la formation et l’émission de N2O des sols. Son utilisation pour des mesures réalisées très ponctuellement dans le temps peut entrainer une sous ou sur estimation des bilans annuels de N2O, et donc une mauvaise interprétation des effets du climat et des pratiques agricoles sur ces bilans. L’utilisation de réseaux de neurones artificiels (ANN) pour remplacer la méthode traditionnelle de l’interpolation linéaire des flux de N2O apparait comme une bonne alternative. Taki et al. (2018), dans leur étude menée avec un jeu de données issues de 6 années de mesures sur un site de culture au Canada, recommande l’utilisation de l’ANN comme méthode de reconstruction de données manquantes en remplacement de l’interpolation linéaire, les résultats avec l’utilisation de l’ANN montrant de meilleurs résultats statistiques par rapport à l’interpolation linéaire, avec des R² de 0.41 et 0.34, respectivement.
RESUME |