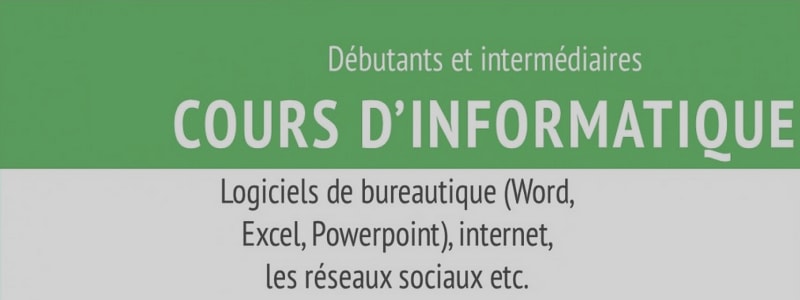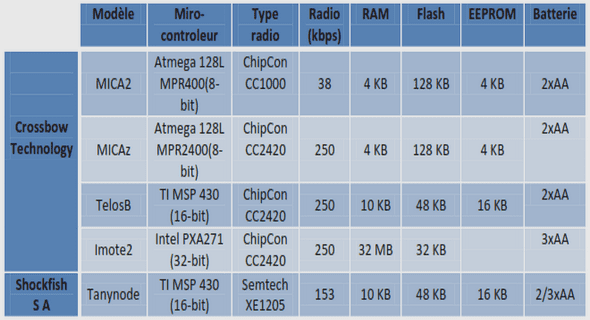L’image de la périphérie paisible pour les professionnels
J’ai débuté les entretiens des acteurs23 du quartier avec mes collègues urbanistes et techniciennes qui participent régulièrement aux différents processus24 participatifs et sont les chefs d’orchestre de la partie urbaine du projet : Hélène Bergen 25, urbaniste spécialisée dans le logement ; Julie Volans, chef de projet pour la partie aménagement, chapeautant les architectes-urbanistes ; Martine Devert, responsable de l’unité territoriale voirie-cités, en charge de la réalisation des espaces publics dans les cités (statut paradoxal s’il en est, qui va bien avec sa « double casquette » de responsable des amicales de locataires de la Confédération Nationale du Logement à Saint-Denis) ; et enfin Stéphanie Rocher et Florence May, responsables du projet urbain à la communauté d’agglomération, et notamment de la coordination des nombreux acteurs partenariaux et du lien avec l’État26. Sur le terrain27 dionysien, la part est belle aux entretiens avec les professionnels, et pour cause ! Ils sont extrêmement présents à toutes les étapes du processus participatif, ce qui est justement une spécificité du terrain français. Jean-Pierre Mariault, le maire-adjoint au quartier, seul représentant du Mouvement des Citoyens de la majorité de gauche de la mairie, m’a également fait part de son point de vue. J’ai enfin rencontré des habitants, membres d’associations (la groupe femmes par exemple), et membres de l’amicale des locataires.
Quelle image ces acteurs ont-ils du quartier ? Ce détour par l’image du quartier Sémard pour ses acteurs est parcellaire : ils m’ont dit ce qu’ils pensaient voir dans ma question. Chacun, depuis sa place, y voit un sous-entendu différent. Les techniciennes et urbanistes de la communauté d’agglomération ont bien sûr en premier lieu une approche urbaine, mais toutes s’accordent pour faire valoir l’ambiance agréable de ce quartier, et témoignent leur attachement. Ainsi, on peut mettre en regard ces deux descriptions, de Julie Volans et d’Hélène Bergen : elles racontent chacune les « barres jaunes ». Cet urbanisme de « chemin de grue », avec ses constructions en préfabriqué, marque en effet le quartier par sa linéarité, l’amenant au nord vers un terrain vague, un ancien terrain de jardins ouvriers, aujourd’hui démolis pour laisser place à des baraques de chantier. Certaines de ces constructions sont de si mauvaise qualité qu’elles ont dû être démolies pour des raisons de sécurité, face aux fissures qui lézardaient leurs murs. Jean-Pierre Mariault (l’élu du quartier) qualifie cette architecture de « soviétique ». Chacun de ces acteurs du projet fait valoir l’ambiance particulière de Sémard. Si les conflits avec les amicales y sont rudes, les liens entre les habitants semblent plus présents qu’ailleurs c’est du moins une sorte de référence pour ces techniciennes qui bâtissent dans différents secteurs de l’agglomération. Sont proposés de front les deux descriptions données par Hélène Bergen et Julie Volans, toutes deux urbanistes spécialistes de l’aménagement urbain :
Pourtant, selon Ouria Aït, une ancienne habitante qui fait partie d’un groupe de femmes de Sémard, ces liens étaient plus intenses auparavant : elle décrit un quartier qui aurait basculé, après la démolition des immeubles Petit et Grand Sémard, d’une convivialité dense à une indifférence générale. Cela rejoint aussi le constat de Bernard Florent (BF), habitant de Sémard de longue date et membre de l’amicale des locataires, qui répond à ma question en pensant que je l’interroge sur la sécurité dans le quartier :
ER28 Pour commencer est-ce que vous pourriez me parler du quartier Sémard ?
BF C’est-à-dire, qu’est-ce que tu veux que je te dise sur le quartier Sémard ?
ER Quand vous rencontrez des gens qui ne le connaissent pas, qu’est-ce que vous en dites de ce quartier ? Comment vous en parlez ?
BF On a un quartier qui est bien, qui est vivant et agréable. Faut dire ce qui est, c’est un bon quartier. C’est pas Chicago. Moi je dis que c’est un bon quartier. Il n’y a pas de secret là-dessus.
Sa réponse présuppose que Sémard, en tant que quartier de Saint-Denis, serait insécure. Quand on confronte les deux présentations des quartiers, un contraste apparaît entre l’approche des urbanistes (encadrés ci-contre), pour qui ce quartier n’est pas le pire » et où il fait bon travailler ; et la perception des habitants, corroborée par l’élu du quartier, qui fait état d’un changement d’ambiance, qu’ils attribuent au changement de population et de son mode de vie.
Cela rejoint d’ailleurs plusieurs études menées sur le quartier. En 1985, un dossier définitif dans le cadre d’une opération « Habitat et vie sociale »29 fait état d’un processus d’attribution de logements sociaux vacants à une population « en difficulté ». Cette évolution semble poursuivie par la suite d’après les dires de Jean-Pierre Mariault, l’élu du quartier, durant son mandat en tant que maire-adjoint au logement, lors d’un précédent mandat municipal (il y a plus de dix ans):
Citons ainsi ce témoignage de Jean-Pierre Mariault :
Les difficultés de la vie de quartier ne viennent pas de là, ou pas seulement de là, mais aussi d’une politique de peuplement. Il y a eu une dégringolade du quartier, que j’ai bien vu quand j’étais élu au logement. Pendant un temps, les familles qui avaient le moins de ressources étaient systématiquement logées à Barbusse ou à Sémard, car c’étaient les seuls logements auxquels ils avaient accès financièrement. Les ménages plus aisés sont soit partis, soit les gens âgés sont décédés, ou ils ont vieilli… En plus au niveau de l’architecture, ces grandes cités, c’est vraiment de l’architecture purement soviétique ! ».
Le terme, imprécis, « en difficulté » est utilisé dans l’étude, ainsi que celui de « marginalisation ». Le principe d’une dégradation de la vie sociale rejoint les conclusions d’un diagnostic partagé qui avait été réalisé en 2003 par des professionnels du quartier30 : les travailleurs sociaux y font état d’une prévalence forte de problèmes de santé mentale et de dépression. Ils concluaient alors à une « dégradation de la vie sociale ». Cela correspond aussi à l’analyse issue d’une étude31 réalisée en 2003 qui identifiait alors un type de population à Sémard appelé le groupe des « placés là par hasard » : les CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) et hôpitaux psychiatriques, selon cette étude, installaient fréquemment des personnes fragilisées dans le quartier Sémard à cause de sa tranquillité. Cette même étude fait d’ailleurs état d’un faible investissement de l’espace public du quartier, hormis en pied de bâtiment : cela serait lié aux fragilités d’une partie de la population. Selon cette étude, le fort taux de difficultés psychologiques et sociales présentes dans le quartier contribuerait à un repli sur les appartements et à un faible investissement de l’espace public.
ER Est-ce que tu pourrais me parler un peu du quartier Sémard, comment tu le vis.
HB C’est compliqué ! Comment je le vis… j’aime bien le quartier Pierre Sémard.… Oui, c’est un quartier certes en périphérie et de ce fait, on a l’impression qu’il n’est quasiment pas Saint-Denis, vraiment en limite, mais on s’y sent bien. Oui, on me dit tout le temps si tu vas la Courtille, vas-y le matin, si tu vas à Franc-Moisin, surtout, n’y va pas l’après-midi… Et par contre à Sémard on ne se pose pas de question. Il y a des problèmes, les gens ne se sentent pas toujours bien. Mais avec le relogement on voit qu’ils adorent leur quartier.
Mais c’est quand même hyper-compliqué en termes de relations. Même s’ils en ont, les habitants ont moins de difficultés d’ordre social, financières, de santé qu’ailleurs ; mais en termes de relationnel je trouve le fonctionnement avec l’amicale des locataires extrêmement compliqué. Il n’y a qu’à Sémard qu’on voit cela. Même si on a d’autres amicales dans d’autres quartiers, ce fonctionnement avec l’amicale Sémard est extrêmement bizarre. Nous leur donnons beaucoup d’importance. Même dans le cadre du relogement je trouve que les discussions avec les locataires sont compliquées. Il y a une spécificité de Sémard. Je le vois quand on fait un point d’étape en interne : « faites un état d’avancement de vos projets » : ils savent qu’à Sémard il y a une spécificité. La population est assez âgée donc on en fait un peu plus en termes d’accompagnement. Ce n’est pas un accompagnement comme sur d’autres quartiers où les personnes sont relogées, et très contents de cela. A Sémard, c’est comme s’il fallait faire « plus plus ». parce que le DSU [Service du Développement Social Urbain] s’en est beaucoup occupé auparavant. (…)
ER D’un point de vue urbain ou social, qu’est-ce qui caractérise ce quartier ? Quand tu en parles, tu en parles comment ?
HB Je décris un peu le bâti, bâti des années 60, pas forcément en bon état, avec des gens qui sont là depuis le début. C’est peut-être parce que je ne fais pas de permanences ailleurs, j’ai l’impression que ma vision est un peu biaisée. Mais je suis contente de voir des petites mamies qui me disent « oh la la c’était mieux avant », je me dis qu’elles sont dans ce quartier et dans ce logement depuis des années alors que moi, personnellement, cela ne me parle pas : comment on peut rester à un endroit autant de temps ? De ce fait, ce quartier ne me paraît pas globalement trop difficile socialement, même si évidemment il y a des situations particulières. Je le trouve moins difficile qu’ailleurs et d’un point de vue urbain, il a une forme allongée qui fait qu’il y a un Nord et un Sud. Les gens adorent leur quartier. (…)
JV Pour moi, il est caractérisé par le grand ensemble de barres jaunes en fond de voie ferrée donc très très marqué. Ce qui m’a frappée au début est son homogénéité dans le sens de l’uniformité et le bruit très très présent. Les quelques fois où j’y suis allée tout seule pour le voir un peu avant de prendre mes fonctions à Plaine Commune, j’ai été frappée par le bruit des voies ferrées, le bruit des avions également que je ne trouve pas négligeable. En y allant et en y passant un peu de temps en concertation, je suis frappée de la façon dont les gens se connaissent, des liens qui existent. Il y a sûrement des personnes très isolées aussi mais j’ai l’impression qu’il y a du lien social qui existe et s’est construit.
ER Toi, tu peux comparer avec d’autres quartier, ce qui n’est pas trop mon cas : trouves-tu cela différent par rapport à d’autres
quartiers ?
JV Je peux comparer à Gare-Confluence qui est l’autre quartier de Saint-Denis que je pratique. Cela n’a vraiment rien à voir en termes d’échanges et de liens entre les habitants. Nous avons un peu de tissu associatif mais qui est très lâche et il n’y a pas de démarches communes, en tout cas à ma connaissance : il n’y a pas le même système d’entraide qu’à Sémard.
ER A quoi cela tient-il d’après toi ?
JV Cela peut déjà tenir à la configuration du quartier : les pieds de bâtiment où les gens s’arrêtent, le groupe scolaire qui est vraiment juste en face, les aires de jeux d’enfants proches… Il y a moins cela à la Gare où l’on peut déjà difficilement s’arrêter dans la rue. Oui, avoir des espaces publics larges, avec des rues et des trottoirs larges, je pense que cela joue. Je passe aussi moins de temps à stationner et à regarder dans le quartier Gare-Confluence qu’à Sémard. Je ne peux pas voir les mêmes choses. Mais je ressens en Démarche Quartier ou dans la rue une autre tension sociale, qui n’a rien à voir avec Sémard ; ce sont d’autres difficultés qui sont beaucoup plus marquées, visibles et une pression plus forte sur les espaces publics.
Le quartier en « décrochage » pour ses habitants
Cette idée du décrochage du quartier est centrale pour comprendre l’amorce des processus de démocratie participative à Sémard, tout autant que pour saisir l’idée de quartier. Au seul examen des propos des acteurs, j’aurais aisément attribué ce discours pessimiste à des temps de vie : autant les jeunes professionnelles semblent enthousiastes, autant Ouria Aït, Bernard Florent, tous deux aux cheveux gris et aux enfants déjà grands, regrettent le « bon temps » d’un quartier qu’ils ont connu plus jeunes.
Ainsi, Bernard Florent fait état de cette croissance de l’anonymat entre les gens du quartier dans l’encadré ci-contre.