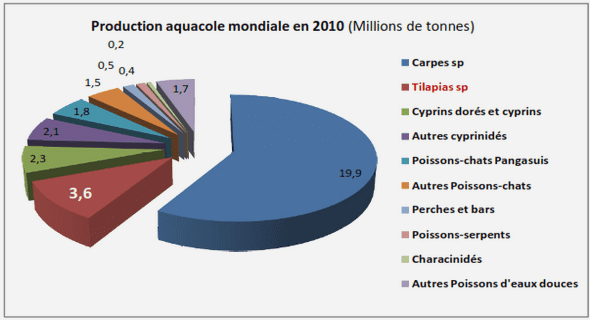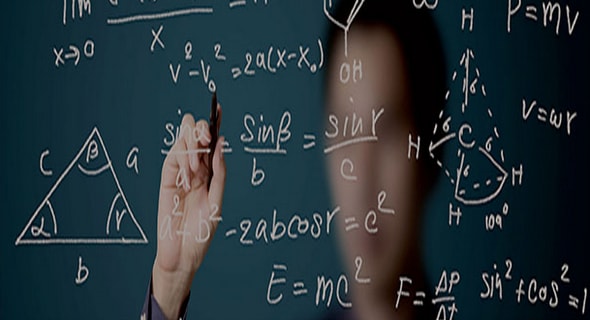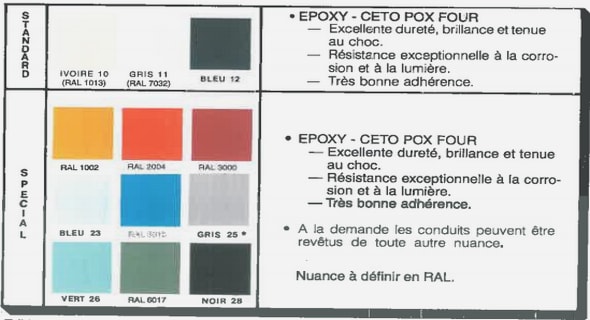Le choix des techniques
Comment peut-on rendre compte de la démarche de terrain au Gabon ? Et quelle approche fait-on du terrain et du sujet ?
Avais-je fait le choix d’une technique d’analyse particulière ? Si jusque-là, je n’avais pas de réponse tranchée à cette question, il m’a vite semblé judicieux de privilégier les techniques anthropologiques basées sur l’écoute, l’enregistrement des histoires professionnelles et l’observation minutieuse des relations de travaux et l’immersion totale dans l’entreprise. Elles seules, en effet, pouvaient me permettre d’avoir une approche plus objective » du concept d’hybridation, des déterminants sociaux de recrutement, de différents rapports sociaux, de la gestion du temps de travail, des pratiques culturelles, et de la façon dont se structurent des trajectoires et des itinéraires des travailleurs dans l’entreprise. En effet, ces pratiques n’ayant pas encore fait l’objet d’aucune étude anthropologique systématique, je me suis donc armé de passion, de patience, de courage et de tact pour recueillir des informations somme toute essentielles pour la réalisation de la présente thèse. Telle est, me semble-t-il l’intérêt essentiel de cette recherche.
Pour ce faire, je ne pouvais pas envisager d’aller vers les travailleurs de la SMAG (dont j’ignorais sans doute l’essentiel des pratiques) avec un questionnaire très fermé. Au contraire, pour en savoir un peu plus sur leur vie au travail et surtout sur le champ dans lequel se structure leur intégration professionnelle, j’avais intérêt à recourir à des techniques qui permettent aux interlocuteurs de décrire leur occupation professionnelle antérieure par rapport à l’actuelle.
J’ai ainsi opté pour cette approche qui relève de la méthode anthropologique, parce qu’elle offre des informations qui, par leur nature, forment une totalité cohérente et enracinée dans l’expérience sociale réelle. Cela leur confère une plus grande capacité à dévoiler le réel contrairement aux réponses à des questions prédéterminées qui ne font qu’en refléter les termes. En effet, la technique d’histoire de vie professionnelle est fondée sur un dialogue avec un interlocuteur. Dialogue qui signifie que je me préparais à recevoir l’inattendu. De plus, le cadre d’ensemble lui-même, au sein duquel les informations sont recueillies, n’est pas déterminé par le chercheur mais par l’interlocuteur ou l’interlocutrice. Généralement, c’était à moi de m’insérer dans le cadre de l’entretien, et non l’inverse. Il est donc normal, dans ce type d’entretien, de dialogue, que l’essentiel soit exprimé sans référence à des questions trop directes et fermées. Ainsi, la forme de telle ou telle question ne joue pas un rôle fondamental lors de l’observation et des entretiens, et l’on peut, au fur et à mesure que l’enquête progresse, s’intéresser aux questions nouvelles voire, déplacer le centre d’attention sans pour autant mettre en danger la cohérence de la recherche.
Le véritable sens des histoires professionnelles consiste à écouter comment le représentant, le membre d’une culture organise son expérience de vie professionnelle ; cette écoute renseigne sur les attentes, les valeurs et les corpus culturels auxquels cette personne participe et appartient.
Cela étant, il est utile de se demander si ce que l’on recueille dans ces histoires professionnelles, est représentatif de la vie d’une personne, de sa naissance jusqu’au moment où elle se soumet à cet entretien ? Ou bien, est-ce que l’on ne recueille que les segments, des périodes de vie professionnelle qui intéressent le chercheur ?
En guise de réponse, comme le souligne Isabelle Bertaux Wiane10, il faut savoir sans cesse s’adapter et s’effacer devant son interlocuteur sans faire abstraction de ce qui n’aurait a priori aucun sens. En effet, le chercheur doit recourir à une certaine souplesse pour la simple raison qu’il ne sait pas par avance comment cette vie-là s’est déroulée, ni ce que la personne a envie de faire valoir. Mais, cette étude ne peut considérer ces histoires professionnelles comme des produits finis, c’est plutôt un matériau de première main à partir de laquelle s’articuleront d’autres recherches plus précises au travers de l’espace et de l’enquête.
Comment traiter ces histoires professionnelles ? Concernant mon travail de recherche, ma méthode a évolué au fil des ans, de sorte que je peux évoquer plusieurs étapes.
Première étape de l’observation : Mon travail saisonnier de 2005 à 2007
Partir d’histoires professionnelles, je vais essayer de reconstituer, d’une part, un type de comportements et d’autre part, la façon dont ils décrivent, pensent le terrain sur lequel ils évoluent, et enfin la perception qu’ils ont des règles du jeu formelles et informelles.
J’accorde aussi une importance soutenue au code qu’ils utilisent, car comme le disent les ethnométhodologues, « la signification du langage dépend du contexte dans lequel ce langage apparait ».
Dans l’entreprise étudiée, mon statut a été un peu atypique. Atypique, parce que la première phase de ma recherche11 a été marquée par un travail en tant que temporaire12 pendant deux mois, puis trois mois au magasin d’aliments pour bétail. Pratiquant l’observation participante, j’ai occupé un poste de « chargeur et de souleveur de sac d’aliments pour bétail » dans une équipe du magasin d’aliments, sous la direction de M. Jean-Fidèle13 et confié à Moussavou14 qui devait m’apprendre le travail. Je participais alors pleinement à la vie de l’entreprise. Écoutant quotidiennement les différentes conversations ordinaires ; scrutant de petites querelles entre individus, entre équipes, entre catégories socioprofessionnelles, entre hiérarchies ; notant les commentaires qui ne manquaient pas de fuser à propos de l’un ou de l’autre ; participant à la palabre dans les heures perdues. C’était au fond le quotidien du travail à la Société Meunière et Avicole du Gabon qu’il m’était ainsi permis de saisir au vif. Mon dessein était clair. Entrer dans la SMAG par le biais du travail temporaire relevait moins d’un choix de méthode que d’une exigence de la réalité. Il y avait le désir de comprendre le quotidien des travailleurs de la SAMG, et surtout de réaliser une anthropologie du travail de cette entreprise. Il s’agissait donc de pénétrer dans une communauté de travailleurs, d’ouvriers, d’agents de maîtrise et de cadres pour tenter d’y mettre en place les méthodes classiques de la production d’un savoir anthropologique comme l’observation, la participation directe, le partage de modes de vie. Tout cela pose en soi des difficultés comme le souligne l’anthropologue Nicolas Adell-Gombert (2006), surtout quand la cohésion du groupe repose en grande partie sur un principe de fermeture. Cela du fait qu’on ne vit pas avec les travailleurs de la SMAG. A peine peut-on, ainsi que j’ai essayé de le faire durant plusieurs mois, vivre comme eux de façon temporaire, s’inviter dans les lieux où l’institution relâche son étreinte, là où elle doit composer nécessairement avec le monde qui l’entoure. Il s’agit alors de fréquenter les espaces du travail, les ateliers, l’usine, la salle de repos, parfois les ménages des salariés, tous ces endroits où les travailleurs ont l’habitude de gérer la proximité du profane, que celui-ci soit ouvrier, chercheur, stagiaire, visiteur, enseignant. Il m’a semblé logique de penser que, dans le lot, un anthropologue pouvait aussi y passer.
Cela ne veut pas dire pour autant que d’autres lieux de travail n’ont pas été arpentés. Ils l’ont été, mais, de manière plus partielle et mieux préparée. Et cette fréquentation a toujours été subordonnée à une présence sur les lieux d’actions, d’ateliers, de magasins. D’une certaine façon, il me fallait passer le test dans les différents magasins aliments et farines, consistant non en une évaluation des compétences, mais en une appréciation de mon intérêt pour le travail des autres et, surtout, de ma capacité à reconnaître sa qualité. Que ce soit au fond des ateliers, ou dans un coin du magasin, que je sois manœuvre sur les chantiers, ou autre, toutes les positions réputées ingrates ou dégradantes parfois, me convenaient dans l’entreprise. L’anthropologue que j’étais, en faisant comme les autres, faisait constamment moins bien. Mon intégration passait par cette dévaluation. Pour ma part, tout ceci n’a pas demandé une application particulière. L’attention prêtée aux hommes plus qu’au travail ainsi qu’une gaucherie assez naturelle m’assurait définitivement ce statut subsidiaire. Mes tentatives d’héroïsme professionnel au magasin d’aliments (charger les sacs d’aliments de 50 kg dans une camionnette, sous un soleil de 28 °C en longueur de journée…) se soldaient généralement par un échec : « Tu es faible, tu es quel genre d’homme (…) ici nous ne sommes pas à l’université, ici on soulève le sac et il faut le dominer… si tu n’es pas capable, tu rentres chez toi… », me répétait, à chaque fois, le responsable du magasin aliments M. Jean-Fidèle.
Mais cette position, aussi bien dérisoire que ridicule, constituait mon seul sésame pour approcher un ordinaire qui m’aurait absolument échappé. Pour ne pas rester définitivement à l’extérieur, objet profane d’un rejet en bloc, la place la plus mauvaise me convenait. Durant cette période, je n’ai pas eu accès à l’ensemble des pans de ce qui était de la vie quotidienne des travailleurs. À ce propos, je n’ai jamais eu l’illusion de l’exhaustivité. Mais je pouvais espérer saisir, à des moments déterminés et en des endroits précis, certains de ces impondérables » qui, comme disait Malinowski, dessinent des logiques d’un autre niveau, œuvrant à d’autres étages de la vie sociale.
Durant cette période, j’ai pu approcher et comprendre quotidiennement les relations de travail et la conception du temps de travail mises en œuvre sur ces lieux.
Deuxième étape de l’observation : apprenti chercheur
Peu de temps plus tard, j’étais considéré par certains comme un jeune étudiant chercheur, et par d’autres, comme un stagiaire. J’eus enfin le droit de passer dans chaque service au sein de l’entreprise (une semaine environ dans un service). Cela me permit de découvrir les différentes activités et le travail accompli dans chaque branche d’activité. Mais une position interne de longue durée dans l’entreprise n’est concevable qu’avec un travail minimum. Et c’est pour cette raison que je me remis à la contrainte. À partir de là, j’ai donc été l’homme à tout faire (chargeur de sacs de farine et d’aliments pour bétail, triage des œufs, agent au personnel), ce qui a largement facilité mon intégration et permis la compréhension de l’entreprise : ses règles, mœurs, et enjeux de pouvoir. D’une manière générale, comme le souligne Jean Marie Ndekamotsebo (2001), les conditions dans lesquelles l’anthropologue peut effectuer son enquête resteront toujours indéterminées. Cela veut dire qu’aucune limite ne lui est explicitement signifiée, mais aussi que l’accès aux documents, ou même aux salariés ne lui est pas davantage garanti. Ainsi, le désaveu du responsable juridique par le directeur général lui confère une totale liberté de mouvement et d’investigation dans l’entreprise, mais parfois l’hostilité que lui vouent certains responsables et leurs subordonnés représentent de réelles difficultés, en particulier dans les services administratifs. Certains salariés demanderont, avant qu’un rendez-vous ne soit fixé pour un entretien, qu’une demande d’autorisation soit spécialement formulée auprès de leur chef de service. J’ai dû moi aussi surmonter toutes sortes de difficultés, affronter les réticences, lever les barrages. Pour pallier tout cela, et comme le souligne le proverbe africain : « la main qui demande est toujours en bas ». J’étais donc contraint de me soumettre à la règle en présentant à chaque fois la lettre de recommandation rédigée par mon directeur de thèse (voir annexe).
Dans les premiers jours de mon observation, je profitais amplement de la situation de mon oncle Ndong Jean-Christian affecté au service du personnel15. Nguema16, son collègue de bureau ne semblait pas être gêné par ma présence, car il me connaissait déjà depuis que j’étais encore étudiant au Gabon. Les week-ends, je le rencontrais au domicile de Ndong Jean-Christian. Mais pour respecter la relation qui était en train de se nouer avec Nguema, j’ai dû laisser passer du temps avant de pouvoir l’interroger sur certaines questions. Je suis resté longtemps dans ce bureau convivial avec Nguema qui buvait le Malaba17 de sa gourde qu’il partageait avec Ndong Jean-Christian. Dans ce bureau, il y avait deux ou trois ordinateurs, une imprimante et une photocopieuse. Au fond, un placard où se trouvaient toutes les archives (dossiers des salariés), bien classées par années. À côté de ce bureau, un petit coin, un WC bien entretenu par la femme de ménage, la sœur de Ndong Jean-Christian. Sur les murs des bureaux du bâtiment de la direction générale, plusieurs photos de l’ex-Président de la République gabonaise, Omar Bongo Omdimba.
Au service du personnel, Ndong Jean-Christian me permettait de consulter des listes de personnes employées, des registres de demandes d’aides et d’autorisations d’absences. Mais par-dessus tout, je repérais les allées et venues des ouvriers et des délégués du personnel. Cela me permit parfois de prendre des notes. En effet, la relation privilégiée que j’entretins avec Ndong Jean-Christian, très fortement intégré dans ce milieu, me donna un accès privilégié au « monde privé des ouvriers »18 de la Société Meunière et Avicole du Gabon, surtout vis-à-vis d’une catégorie d’informations personnelles des travailleurs souvent difficiles à obtenir pour toute forme d’investigation. Ma présence dans le bureau du chef du personnel me donna matière à enrichir mes connaissances, étant donné que salariés et délégués du personnel se succédaient régulièrement tout au long de la journée afin de lui exposer divers problèmes. Paradoxalement, ce choix est sans doute le meilleur moyen de se mettre en situation de restituer l’ensemble des dimensions de la vie des travailleurs.
C’était également une possibilité offerte pour tisser des liens, s’informer sur les conflits individuels, personnels et surtout collectifs. J’écoutais les sujets de conversation des agents au téléphone et je notais les gabonismes (idiotismes) offerts par la langue locale, usitée par le personnel administratif. L’anthropologue que j’étais découvrait que la langue fang restait la plus parlée par le personnel administratif, l’ethnie fang représente la « SMAG en miniature ». En effet, sur un total de deux cent trente-cinq (235) salariés, quatre-vingt-quinze (95) appartiennent à l’ethnie fang alors que l’entreprise elle-même emploie une trentaine d’ethnies.
Vers chaque cinq du mois, des attroupements d’ouvriers se formaient devant le bureau, pour réclamer les prêts à l’entreprise sous forme d’avances de solde ou de bons de caisse, qui sont accordés en fonction de la catégorie socioprofessionnelle et par rapport à l’urgence de la demande. De ce point de vue, il m’était donc possible de suivre les différentes étapes du paiement des rémunérations et d’observer les déplacements de salariés ou de leurs représentants entre le service du personnel et les bureaux des responsables financiers. Enfin, le voisinage immédiat des vestiaires du personnel de l’usine offrait plusieurs opportunités en vue d’entamer des discussions, surtout lorsque l’activité s’interrompait et que « la palabre » prenait place dans les ateliers et les magasins. Pour cela, il me fallait prendre de la distance avec le bureau du personnel, bureau déjà occupé par trois personnes qui ne permettait pas les entretiens car on me confondait à un jeune stagiaire du service du personnel.
Aucun délai ne m’avait été imposé pour réaliser mon enquête. « Tu restes autant que tu veux (…) et si tu as besoin de quelque chose, tu me demandes », m’avait tout simplement dit « mon oncle » au service du personnel. Mais le regard porté par quelques employés me fit prendre conscience de mon intrusion au sein de ces locaux. J’avais noté le refus, la peur et la mauvaise volonté de nombre de mes interlocuteurs, qui me refusaient les entretiens. Pour certains, j’apparaissais comme un agent des services secrets envoyés par le pouvoir, pour leur faire subir ces enquêtes de moralité qu’ils prétendaient subir de temps en temps. Il me fallait prendre du temps pour les convaincre de parler. Je devais justifier de ma présence dans l’entreprise, et ce à quoi serviraient les données que je recueillais. Parfois, je me permettais de présenter la liste des services où j’étais passé et j’énumérais les personnes avec lesquelles je m’étais entretenu. Tout cela pour essayer de les mettre en confiance et aussi leur faire savoir que dans l’entreprise, la voix de tout travailleur est utile. Les interrogations suivantes revenaient constamment : pourquoi m’avez-vous choisi et pas tel ou tel autre salarié, alors que nous faisons le même travail et que nous avons le même nombre d’années de service ? Me soupçonnez-vous de quelque chose ?
J’avais été admis dans cette entreprise en tant que jeune chercheur, et lorsque d’aucuns acceptaient volontiers de m’accorder des interviews, voilà comment une tranche (des chefs d’équipes) des responsables voyait en moi un élément perturbateur du bon fonctionnement du travail. Pendant douze semaines, j’ai mené mon enquête en évitant de troubler les salariés à leurs postes de travail. Les premiers jours, j’arrivais le matin dans l’entreprise et repartais en milieu d’après-midi, puisque le travail commençait à 7 h 30 et se terminait à 15 h 30. Tous les jours, puis un jour sur deux.
Avec l’autorisation de la direction du personnel, je prenais mes repas au foyer de l’entreprise (750 francs le repas), qui s’avérait un autre espace d’observation intéressant. Par la suite, et au fur et à mesure, je réduisis la fréquence de mes visites et la durée de ma présence dans les locaux de la Société Meunière et Avicole du Gabon. Dans les dernières semaines, je ne restais que quelques heures par jour, trois fois par semaine environ. Cette observation directe dans l’entreprise alternait avec des visites de plus en plus fréquentes sur les lieux de résidences des salariés. Que pouvais-je faire d’autre pour aller plus loin dans cette observation des travailleurs ?
J’ai cherché. Aussi ai-je participé au défilé du 17 août (de l’année 2011) de la fête de l’indépendance du Gabon pour l’entreprise SMAG. J’avais mis le tee-shirt et la casquette aux initiales de la SMAG. Et pendant de longues heures sous le soleil, j’ai marché et suivi. J’ai défilé devant les plus hautes autorités du pays, chantant et marchant au pas selon le rythme des chants du terroir, et toujours souriant. Dans mes mains, je tendais fièrement les marques de fabrique des produits de l’entreprise, de la farine, des œufs. Au milieu de l’après-midi, je participais à un match de football organisé par l’entreprise. En soirée, j’assistais aux remerciements des travailleurs, suivis par une interminable soirée dansante qui dura jusqu’à l’aube. Comme le fait remarquer Jean Copans (2011) à propos de ce genre d’observation, cette perspective peut donner l’illusion qu’on est dans un fait social total. Mais en réalité, celui-ci ne va pas de soi : il résulte bien sûr de l’intervention de l’anthropologue qui sélectionne les paroles rituelles ou anodines et élabore un signifiant propre. L’événement banal devient nécessairement exceptionnel par le fait de sa sélection d’une part, et par le résumé et des expressions orales prononcées à cette occasion d’autre part.
Dans l’entreprise, les acteurs en position inférieure (les travailleurs de toutes les catégories) investissent parfois la relation d’enquête afin de dénoncer les dirigeants. Ils reproduisent ainsi l’accusation d’infériorité produite par l’ancien dominant « Blanc » en l’actualisant symboliquement à travers la personne de l’anthropologue. La relation à l’anthropologue est ainsi mise à profit pour souligner les écarts aux normes. Elle le place dans une position d’arbitre ou de témoin extérieur pour une condition de travail qui est inacceptable ou, par exemple, au sujet du non-respect du Projet d’Accord d’Établissement19. Une telle attitude culmine chez certains ouvriers par une mise en accusation accablante des dirigeants de l’entreprise qui se résume fréquemment par cette formule : « Ici, il y a plus de travail, alors que le salaire ne suit pas ». Ces acteurs (essentiellement les agents d’exécution) s’emploient ainsi à édifier leurs relations à l’anthropologue en le situant comme agent extérieur à l’entreprise et sans doute statutairement supérieur. La légitimité de sa recherche trouve à leurs yeux ses fondements dans l’autorité des normes de l’ancienne puissance coloniale dont il ressortit20. Ainsi réappropriée et traduite, l’enquête est d’autant mieux perçue qu’elle est utilisée pour introduire un procès symbolique contre les dirigeants de l’entreprise, l’anthropologue étant réinvesti du rôle de juge, sauveur, médiatisant, par son écoute, une condamnation sans appel.
Ces diverses considérations sur les conditions d’enquête et la place attribuée au chercheur expliquent rétrospectivement pourquoi les contacts furent d’emblée beaucoup plus faciles à nouer avec la catégorie des agents d’exécution qu’avec tout autre salarié, et ceci malgré le souci d’appréhender l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Les fréquentes interruptions du travail dans l’usine, occasionnées par le défaut d’approvisionnement en matière première et surtout par l’attente des clients, donnent aux ouvriers des périodes d’inactivité qui sont mises à profit pour susciter des rencontres et des discussions. Ce que confirment ces propos du responsable du magasin œufs : «… Dans notre magasin, quand on a beaucoup de clients, nous avons beaucoup de travail, et ce vice-versa. Moi, je considère la SMAG comme une « grande boutique »21. Pendant ces temps de pause ou d’attente, les ouvriers profitaient de mon enquête pour mettre à nu leurs différentes difficultés avec leurs dirigeants. Tout cela favorisait ma recherche. À l’opposé, les salariés présents dans un bureau (espace fermé) et a fortiori les opérateurs de saisie, souvent envahis par la clientèle, étaient d’une approche plus difficile. Des discussions étaient possibles au foyer ou lors des déplacements, le plus souvent publics et très courts. Le prolongement de ces contacts exigeait l’obtention d’un rendez-vous. Reçu dans un bureau, j’étais pris dans les mailles d’une relation professionnelle et renvoyé à ma position de stagiaire. Auprès d’eux, la démarche interrogative suscitait la gêne et pouvait être perçue comme une remise en cause. Dans de telles conditions, j’éprouvais beaucoup de difficultés à aborder librement les questions liées à la vie quotidienne. Peu d’entretiens seront finalement obtenus à l’écart de l’entreprise avec cette catégorie de salariés. Mon enquête porte donc surtout sur l’usine. Elle est le cœur de ma recherche, mon monde, ma passion. Là, j’ai trouvé, vu, écouté des chefs de service, cadres, agents de maitrise et agents d’exécutions.
Dans une entreprise comme la SMAG, l’enquête provoque des réactions de défense, d’accusation ou d’altercation qui structurent et animent les discours. À titre de démonstration, on notera que certains cadres de la SMAG, publiquement et devant moi, ont nié avoir embauché des membres de leur famille. Alors qu’il est pourtant facile de repérer au sein de cette entreprise une vingtaine de salariés qui se réclament d’un lien de parenté plus ou moins proche avec ces derniers. Mais ce n’est pas tant la correspondance entre les déclarations et la réalité qui importe ici, que tous les enjeux symboliques que manifeste un tel comportement. Parce que recruter un « parent » peut paraître comme un enfermement dans une condition d’infériorisation, celle de l’ »Africain ». En insistant sur leurs adhésions au principe des modèles représentés par la famille « européenne » et par le capitalisme « occidental », les cadres tentaient de se démarquer du stigmate commun de l’ «entrepreneur africain ». Ils cherchaient ainsi à s’éloigner de ce recrutement familial caractéristique habituellement attribué aux chefs d’entreprise du continent, aussi bien dans les discours dominants que dans un certain nombre de travaux scientifiques22.