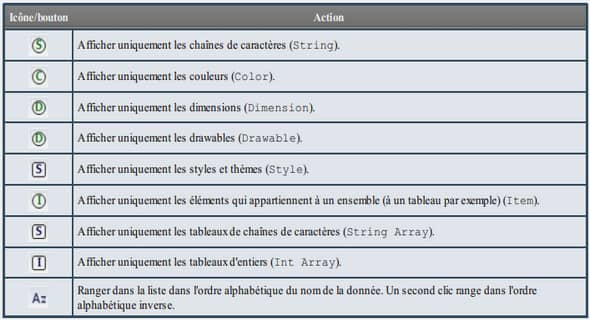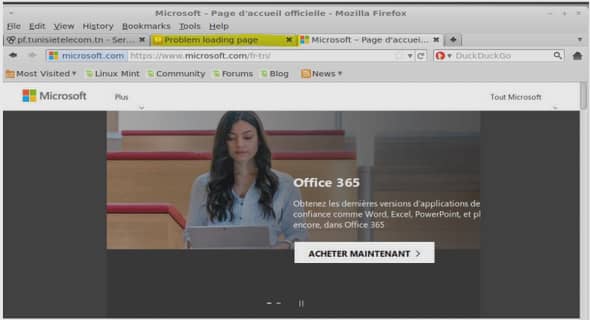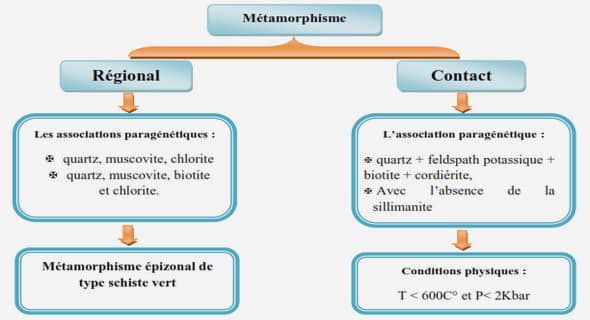Les Rapports du Conseil de tutelle de des Nations Unies
Les Rapports annuels du Conseil de tutelle des Nations Unies sont les premiers documents que j’ai exploités dans le cadre de ce travail. Cet organe de l’ONU avait en charge : l’examen des Rapports d’administration que les puissances administrantes des territoires sous tutelle avaient l’obligation de lui transmettre tous les ans ; la réception et l’examen des pétitions des populations de ces territoires ; et l’organisation des Missions de visite des inspecteurs des Nations Unies dans les territoires sous tutelle.
Pour le Cameroun, Territoire sous tutelle des Nations Unies, le Conseil de tutelle a produit 14 Rapports entre 1947 et 1960. Ce sont des documents de 150 à plus de 250 pages qui synthétisent, territoire par territoire, les réalisations des puissances administrantes dans les domaines politique, économique et social. Il m’a fallu plusieurs semaines pour parvenir à en extraire les informations pertinentes qui se rapportaient à mon sujet.
Les questions relatives à l’éducation étaient traitées dans la rubrique des Rapports intitulée « Progrès de l’enseignement ». Pour le Cameroun, cette rubrique apparaissait deux fois : d’une part, pour le territoire camerounais administré par la France (zone francophone), et d’autre part, pour le territoire camerounais administré par le Royaume-Uni (zone anglophone). Les thématiques soulevées dans cette rubrique sont nombreuses. Travaillant sur l’enseignement supérieur, j’ai pu constater que nombreux points de cette rubrique touchaient aux questions que je me posais dans le cadre de mes recherches. En effet, dans tous les rapports, les représentants des membres du Conseil de tutelle, font état du manque d’établissement d’enseignement supérieur sur le territoire, et relèvent que c’est une chose grave pour un territoire dont la finalité de l’administration est l’indépendance nationale. Les questions de financement, de l’obtention de bourses d’enseignement supérieur à l’étranger pour les meilleurs élèves sont régulièrement posées dans ces Rapports. Des comparaisons sont faites avec d’autres pays du continent africain. Ces Rapports évoquent aussi les tentatives infructueuses ou retardées de construction d’universités ainsi que les disciplines les plus prisées par les étudiants ou celles proposées dans les programmes d’étude.
Le Rapport de la Conférence d’Addis-Abeba
Deux autres documents officiels issus du site de l’Unesco m’ont été utiles dans le cadre de mon travail. Il s’agit du Rapport final de la Conférence des États africains sur le développement de l’éducation en Afrique (Addis-Abeba/Éthiopie, 15-25 mai 1961), et du Rapport sur la Conférence sur le développement de l’enseignement supérieur en Afrique (Tananarive/Madagascar, 3-12 septembre 1962). Ces deux documents sont disponibles en libre accès sur Internet. Il en est de même pour les Rapports du Conseil de tutelle de l’ONU.
Dans le Rapport de la Conférence tenue à Addis-Abeba en 1961, un inventaire de la situation de l’enseignent en Afrique est fait. L’enseignement supérieur y tient une place importante. Il m’a été précieux notamment pour apprécier l’appui que les institutions internationales ont apporté à la création des universités en Afrique. L’ensemble des personnes présentes à cette Conférence (délégués, représentants, professeurs invités) soutenaient l’amélioration des conditions d’enseignement en Afrique. Les questions liées à la coopération internationale en matière d’éducation interafricaines sont soulevées lors de cette Conférence. Il s’agit de démontrer comment les échanges ou transfert de connaissances peuvent participer une amélioration de l’enseignement, dont l’enseignement supérieur. L’un des aspects intéressants de ce Rapport est qu’il donne des informations sur les disciplines plus ou moins prisées par les étudiants africains. De nombreux tableaux recensent le nombre d’élèves par niveau sur plusieurs années. Dans sa partie annexe, ce Rapport reproduit plusieurs discours prononcés par des personnalités invitées, à l’exemple du professeur Ki-Zerbo.
Le Rapport de la Conférence de Tananarive
Le Rapport de la Conférence tenue à Tananarive en 1962 est plus directement en lien avec mon sujet et mes questionnements. Elle est en effet centrée sur le sujet de l’enseignement supérieur. Les participants à cette Conférence militent pour la création d’universités en Afrique, notamment pour réduire le nombre des étudiants africains qui sont obligés d’aller se former à l’étranger, et le plus souvent en dehors du continent africain. Ils prônent aussi une valorisation de la coopération interafricaine pour faire naitre une identité continentale. La formation supérieure est présentée comme l’une des conditions préalable à l’unité nationale et au développement économique des pays africains. De nombreux tableaux sont fournis dans ce rapport. Ils font état des différentes disciplines universitaires prisées par les étudiants ainsi que celles qui souffrent d’un déficit d’étudiants. Des prévisions sont aussi faites pour la décennie à venir par rapport aux dépenses liées à la construction des universités et à l’approvisionnement du matériel pour les classes.
La tâche a ainsi été aisée au départ pour trouver des sources. La disponibilité de ces différents documents sur Internet m’a permis de comprendre l’ossature institutionnelle qui entourait les débats sur l’enseignement supérieur en Afrique en général, et au Cameroun en particulier.
LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
Je me suis par la suite employée à obtenir des documents rendant compte du point de vue des personnes concernées par toutes ces discussions, c’est-à-dire les étudiants. Sur le conseil de l’une de mes camarades, je me suis rendue aux archives de la Préfecture de Police, qui se trouvent aux Lilas, en Seine Saint Denis. Je m’y suis rendue aux mois d’octobre et novembre 2015.
J’ai été très surprise par la documentation trouvée aux archives de la Préfecture de Police. Je ne soupçonnais pas du tout, qu’à l’époque, la Police surveillait les étudiants aussi bien dans leur vie privée, que dans leurs activités associatives et militantes. Elle retranscrivait les discussions des étudiants lors de leurs réunions. Certaines fiches de renseignements font état d’étudiants africains jugés dangereux. À Paris et dans le reste de la France, des associations d’étudiants africains existaient. Ceux-ci se regroupaient pour pouvoir faire entendre leurs voix et leurs revendications. Ils revendiquaient souvent de meilleurs logements, le paiement de leurs bourses, s’insurgeaient lorsque l’on fermait les locaux qui leur servaient de lieu de réunion. La police avait toujours les comptes rendus des discussions ayant eu lieu dans les foyers ou autres endroits de réunion. Tous les participants aux réunions des étudiants africains étaient connus des services de la police.
Les documents que j’ai consultés aux Archives de la Préfecture de Police, m’ont révélé que la police craignait les mouvements panafricanistes. La période des années 1950 et 1960 étant marquée par des tensions dans les colonies au sujet de la décolonisation, la crainte du développement de mouvements révolutionnaires sur le territoire français était particulièrement forte, car on était dans un contexte de Guerre froide. Malgré cette surveillance policière, des associations étudiantes africaines sont créé s en France. J’ai eu l’occasion de consulter des documents concernant celles-ci. J’ai ainsi pu consulter les comptes rendus de l’association de la Fédération des Étudiants d’Afrique Noire en France (FEANF). La FEANF avait son journal « L’Étudiant d’Afrique Noire » qu’elle distribuait en métropole et en Afrique.
Des Camerounais, en tant qu’Africains, faisaient partie de la FEANF. Ils avaient cependant leur propre association : l’Union Nationale des Étudiants du Kamerun (UNEK). Ils publiaient un journal : « L’Étudiant du Kamerun ». Ce journal traitait de des questions d’ordre général dont celle liée à l’enseignement supérieur au Cameroun : la construction des établissements, la formation des élèves, les questions de financement, les contenus des programmes, etc. Le journal avait de nombreux lecteurs (trop vague) et j’ai pu consulter de nombreux numéros. J’ai en particulier exploité le numéro de 1965 qui, dans pratiquement toutes ses pages, traite de l’enseignement supérieur.
La découverte et l’exploitation des documents des archives de la Préfecture de Police ont failli m’éloigner de mon sujet. Je me suis prise de passion pour les fiches de renseignement et j’ai failli réorienter mon sujet pour travailler sur l’activité des étudiants camerounais en France dans les années 1940 jusqu’aux années 1960 ». Je me croyais dans une enquête policière lorsque je lisais toutes ces fiches de renseignement. La police était obsédée par le moindre détail. Mais après réflexion, j’ai recentré mon travail sur mes touts premiers questionnements.
LE SITE CAMEROUNAIS DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
J’ai consulté le site Internet du ministère de l’Enseignement supérieur au Cameroun (MINESUP), dans l’espoir d’y trouver un historique des dates les plus importantes dans la mise en place d’instituts scolaires de niveau supérieur. Je n’ai malheureusement rien trouvé de cette nature sur ce site Internet. Pas d’informations sur les débuts dans les années 1960. J’ai été assez déçue car je pensais que le site m’aiderait plus, sachant que sur les sites Internet des ministères de l’Enseignement supérieur d’autres pays en Afrique, les informations sont plus abondantes.
LES DOCUMENTS TROUVES EN ANGLETERRE
Les archives nationales de Kew Richmond, à Londres
Avec une documentation initiale conséquente, je pensais qu’il n’était pas nécessaire de me rendre en Angleterre pour consulter les archives anglaises, car les rapports de l’ONU traitaient à la fois du Cameroun français et du Cameroun britannique. Je pensais que les informations que j’avais sur la partie anglophone via ces Rapports suffisaient. Mais sur le conseil de ma directrice de mémoire, Madame Anne Hugon, je m’y suis rendue et cela m’a été fort utile.
Au mois de janvier 2016, je suis allée à Londres aux Archives nationales de Kew. J’y ai trouvé différents types de documents : des fiches de renseignement sur des étudiants ; des correspondances diplomatiques entre les ambassades du Royaume-Uni à Yaoundé et celle de Russie ; des correspondances entre les membres du gouvernement camerounais et celui du Royaume-Uni ; des documents qui établissent des contrats de financement de la faculté de droit de l’Université de Yaoundé par le Royaume-Uni ; des documents qui concernent le Cameroun méridional et les écoles qui s’y trouvent ; des documents sur les étudiants envoyés en Grande-Bretagne, en Inde et au Nigéria.
Senate House Library
l’Université de Londres, j’ai pu lire le 9e numéro de la revue Policy for Scholarship (Southern Cameroon) datant de 1955. Destiné au Cameroun méridional sous administration britannique, c’est une revue qui est spécialement dédiée aux questions éducatives. Les éditeurs sont nigérians. D’où leur intérêt pour le Cameroun méridional. Ce numéro nous donne des informations sur les bourses qui étaient données aux élèves dans cette partie du pays pour qu’ils aillent étudier au Nigéria à Lagos et Ibadan. Dans les années 1950, il existait des moyens d’aller à l’Université en Afrique notamment pour des Camerounais. Ces moyens sont très bien explicités dans la revue. C’est un document qui m’a permis de me rendre compte de la force des liens qu’entretenaient la région du sud avec le reste du Nigéria, et par conséquent j’ai compris pourquoi, lorsqu’il s’agissait d’éducation, les partenariats bilatéraux étaient si nombreux.
LES ARCHIVES NATIONALES D’OUTRE-MER, AIX EN PROVENCE
Je me suis enfin rendue à Aix en Provence au mois de mars pour consulter les archives d’outre-mer. Là aussi mes recherches se sont avérées fructueuses. Des documents concernant les bourses pour les étudiants sont disponibles. Ils donnent des informations sur les modalités d’obtention des bourses ; sur le profil social des boursiers, sur les voyages des étudiants français au Cameroun, sur les voyages des étudiants africains en France, etc.
LE RAPPORT DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LANGUES ET CIVILISATIONS
Au mois d’avril, à la bibliothèque universitaire des langues et civilisation (BULAC), j’ai découvert un document digne d’intérêt pour mon travail : « Le rapport de la commission consultative pour le développement de l’enseignement supérieur en République Fédérale du Cameroun ». Le document publié par l’Unesco date de 1962. La première partie de ce Rapport, intitulée « Planification de l’enseignement », est un bilan de la situation de l’éducation au Cameroun. Les analyses portent sur les disparités régionales en termes de moyens financiers alloués aux établissements d’enseignement supérieur, en termes de scolarisation entre filles et garçons, en termes d’effectifs d’étudiants dans les différentes disciplines, etc. La deuxième partie du Rapport analyse les modalités de construction de l’université du Cameroun, les langues qui y sont parlées, les matières enseignées, etc. Cette partie du Rapport m’a été extrêmement utile dans la compréhension des problématiques liées à la façon dont on conçoit l’université, notamment à travers les moyens mis en œuvre pour l’adapter aux préoccupations de développement.