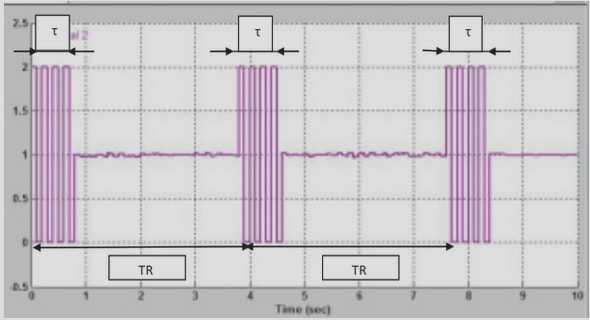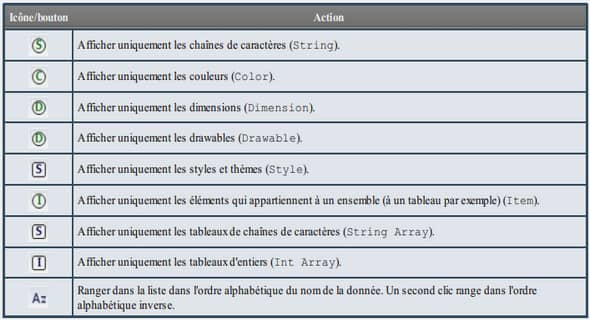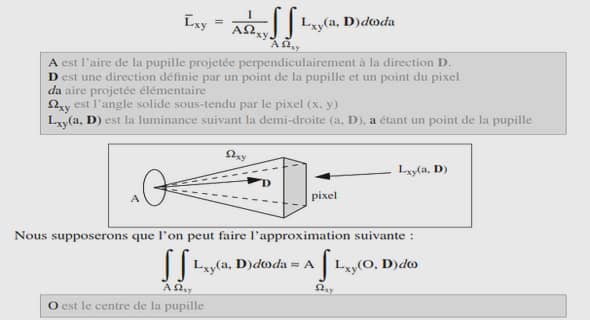Le rôle de l’institution scolaire : l’évolution des pratiques et dispositifs d’enseignement et leurs effets différenciateurs
En effet, il semble somme toute impossible de concevoir que la relation que les élèves entretiennent avec une discipline ou un ensemble de savoirs puisse être complètement décorrélée de la question de leur apprentissage. Dès 1993, à l’analyse des « bilans de savoir » des élèves (et surtout à la lumière de ce qu’elle et il ont pu observer vis-à-vis des mathématiques), Élisabeth Bautier et Bernard Charlot pointaient elleux-mêmes le fait que le rapport des élèves au savoir se construit inévitablement à travers sa transmission (Charlot & Bautier, 1993, p. 23). Si nous ne pourrons réellement discuter à l’appui de nos données de l’effet des diverses pratiques d’enseignement sur la production d’inégalités dans le rapport aux maths, il paraît aujourd’hui néanmoins nécessaire de tourner le regard vers l’école et l’institution (Bonnéry, 2007 ; Deauvieau & Terrail, 2017 ; Terrail, 2002). Les quelques éléments présentés dans cette sous-section seront donc à garder à l’esprit lors de l’interprétation de certains résultats tirés de nos analyses.
L’évolution du système scolaire et les différentes phases « d’explosion scolaire » ont ainsi nécessairement été accompagnées par l’émergence de certains enjeux et questionnements, notamment en ce qui concerne la capacité de l’école à transmettre les savoirs aux publics d’élèves socialement défavorisés nouvellement scolarisés.
Deux principaux concepts bien connus de la sociologie de l’éducation visant à expliquer la relation entre inégalités sociales et inégalités scolaires émergent dès lors, étant encore très largement repris de nos jours. D’un côté, celui de la reproduction » développé par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron met en avant le fait que l’École tend à légitimer et reproduire les hiérarchies sociales en les transposant en hiérarchies scolaires, puisque la culture scolaire est en réalité conforme à celle des classes dominantes, les élèves des différentes classes sociales se tenant ainsi à une inégale distance de cette culture (Bourdieu & Passeron, 1970). Parallèlement à cette théorie apparaît une autre notion : celle de handicap socio-culturel », revenant à considérer que les élèves des milieux défavorisés souffrent d’un « déficit » d’aptitudes ou de « manques » d’ordre culturel et linguistique.
Ce type d’interprétations s’appuient notamment sur les découvertes de Bernstein quant aux codes socio-linguistiques « restreint » et « élaboré » respectivement employés au sein de la classe ouvrière et de la classe moyenne (Bernstein, 1973, cité par Sadovnik, 2001, p. 609). L’idée d’une forme d’éducation nouvelle » se diffuse donc peu à peu à compter des années 60, accompagnant la mise en place de l’école unique9 (Terrail, 2002). Celle-ci cherche alors à se dépêtrer de la forme traditionnelle de l’enseignement régnant depuis des millénaires – à savoir centrée sur l’activité d’un maître doté de savoir qui a pour fonction essentielle de le transmettre –, en choisissant de se recentrer sur l’activité de l’élève et de « plac[er] ainsi l’exigence d’adaptation au principe même de l’interaction pédagogique » (ibid., p. 221). Sous l’influence partielle de la thèse du « handicap socio-culturel », de nouvelles formes de « pédagogie adaptée » (ou « pédagogies du concret ») ont donc commencé à voir le jour (Bonnéry, 2007 ; Terrail, 2002, 2019).
Ces méthodes d’enseignement se sont depuis largement développées, jusqu’à entrer dans la norme actuelle. Les inégalités scolaires, en grande partie reproduites par le système de filières qui a été instauré au sein de l’école unique en lien avec ces conceptions différenciatrices, ne sont ainsi pas moins importantes aujourd’hui qu’à l’époque où l’accès des enseignements n’était réservé qu’à une certaine frange de la population. Elles se réalisent simplement de façon plus insidieuse, dorénavant au sein même du système scolaire (Bonnéry, 2007 ; Terrail, 2002).
Un ensemble de chercheur·ses en sciences sociales, sciences de l’éducation et didacticien·nes se sont ainsi attaché·es à décrire la façon dont les pratiques et dispositifs d’enseignement dominants peuvent contribuer à la construction de certaines inégalités entre les élèves, y compris en mathématiques. C’est le principal objectif du réseau RESEIDA10, fondé en 2001 à l’initiative de certain·es membres de l’équipe ESCOL (Éducation et scolarisation) tel·les qu’Élisabeth Bautier ou Jean-Yves Rochex (voir Rochex & Crinon, 2011, pour une analyse tirée d’un ouvrage collectif regroupant certaines conclusions importantes de ces travaux). Deux processus sont principalement identifiés : une différenciation « active » et une différenciation « passive » (Rochex, 2011).
La première peut se résumer dans la tendance à adopter des modes de faire et d’enseigner différenciés selon les élèves et leurs diverses caractéristiques sociales, qu’elles soient réelles ou supposées, ce processus pouvant même intervenir au sein d’une même classe à travers l’existence de « contrats didactiques » différentiels qui se forment à l’insu des divers protagonistes (ibid., pp. 91-93).
Il peut également s’agir de la séparation de la classe en groupe de niveaux placés dans des situations d’apprentissage différentes (segmentation plus importante des tâches pour les plus faibles, ou situations qui leurs sont proposées parfois paradoxalement plus complexes), alors même que les différences entre les « forts » et les « faibles » paraissent bien moins importantes lorsque celleux-ci font face aux mêmes situations effectives (Laparra & Margolinas, 2011, p. 117). Le second type de différenciation dîte « passive » tient en ce qu’à défaut de désigner ou expliciter clairement les enjeux d’apprentissage, les professeur·es développent sans en avoir nécessairement conscience un caractère « incident » des savoirs à transmettre, en les invisibilisant derrière d’autres attendus en lien avec la ou les tâches à accomplir de la part des élèves (Rochex, 2011, p. 91).
L’existence de certaines dispositions sont ainsi présupposées chez ces dernier·es dans la capacité à mettre en relation les tâches et situations d’apprentissage entre elles ou avec les enjeux et contenus de savoir, alors que seul·es les élèves qui ont pu acquérir ces prédispositions dans un autre contexte (univers familial notamment) y parviennent (ibid.). Se contentant trop souvent de l’identification des signes extérieurs de l’étude »11 (Bonnéry, 2007), il semblerait en réalité que les enseignant·es soient poussé·es à mettre la priorité sur la « mise en activité » des élèves et le développement de leur autonomie dans la réalisation des tâches, reléguant ainsi au second plan le cadrage des situations d’apprentissage et l’acquisition effective des savoirs (Bonnéry, 2007 ; Rochex, 2011).
Les mathématiques n’échappent alors pas à la règle. À travers la volonté de maintenir les élèves dans du faire », ou de les confronter à des situations concrètes ou transversales (en lien notamment avec l’actualité), il arrive même qu’on leur enseigne des éléments hors programmes nécessitant des connaissances et savoirs préalables auxquels elles et ils n’ont pas encore eu l’occasion d’être initié·es (en tout cas à l’école), quitte à devoir se détacher de l’enjeu épistémologique (Coulange, 2011, p. 44).12 Il convient de préciser que ces différent·es auteur·es ne cherchent pas pour autant à rejeter la faute sur les enseignant·es, mais amènent plutôt à considérer que la récurrence de ce type d’observations indique que ces pratiques différenciatrices « découlent en réalité de conditions d’exercice, d’injonctions officielles, d’évidences [et] de conceptions dominantes », selon la formulation employée par Stéphane Bonnéry (2007, p. 63).
On l’aura compris : la place accordée à l’enseignement des mathématiques dans le cursus scolaire, la manière de concevoir leur enseignement et de développer les programmes ainsi que la façon dont le savoir est généralement transmis aux élèves ne sont pas étrangères au maintien ou à la production d’inégalités scolaires entre les élèves des différentes classes sociales. Cela n’est alors pas sans conséquence sur la façon dont se forge chez les apprenant·es la relation avec la discipline et les savoirs qui y sont enseignés.
Si nous pensons au gré des différentes raisons évoquées qu’il puisse y avoir un intérêt particulier à étudier le rapport spécifique des élèves aux mathématiques, il ne faut pour autant pas oublier qu’elles représentent non seulement un champ de savoirs, mais aussi et surtout une discipline identifiée comme « scientifique ».13 Comprendre ainsi ce qui se joue au niveau des sciences ou parcours scientifiques peut nous permettre de mieux appréhender la nature de la relation que les élèves construisent en rapport aux maths, et de peut-être pouvoir en ressortir ensuite les éventuelles spécificités. Nous allons donc à présent tenter de dresser un aperçu de l’état des connaissances sur le rapport des élèves au savoir, et ainsi plus spécifiquement aux mathématiques et aux sciences, vis-à-vis desquels il nous faut également pouvoir percer à jour certains des principaux mécanismes contribuant fortement à leur construction socialement différenciée.
Rapport au(x) savoir(s), culture scientifique et inégalités
Un rapport au savoir et à l’apprendre qui varie selon le milieu scolaire et social
Qu’est-ce « qu’apprendre », quel est le but de l’école ou l’intérêt des savoirs qu’on y enseigne du point de vue des élèves ? Voilà notamment des questions auxquelles ont pu s’intéresser Bernard Charlot et ses collègues membres de l’équipe ESCOL à travers leurs premières analyses sur les celle de proportionnalité, dont l’apprentissage n’est programmé que plus tardivement dans le cursus (généralement enseignée au collège), que l’enseignante n’explicite pas au cours de la séance. Cela crée alors une forte confusion chez l’ensemble des élèves tout au long du cours, et la chercheuse en mesure à l’analyse de la séance suivante les effets différenciateurs produits sur leurs apprentissage (op. cit.).
Concernant ce lien indéfectible unissant mathématiques et sciences, il est d’ailleurs particulièrement intéressant de noter que pour sa récente recherche centrée sur les inégalités face aux sciences ainsi que sur le rapport des élèves à celles-ci, Clémence Perronnet a finalement fait le choix d’intituler son livre « La bosse des maths n’existe pas » (Perronnet, 2021) bilans de savoir » des élèves (Charlot & Bautier, 1993 ; Charlot et al., 1992). L’étude portait ainsi à la fois sur des élèves de classes d’un collège de ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire) de Saint-Denis, et sur d’autres classes provenant d’un collège de Massy-Palaiseau, situé « hors-ZEP » et accueillant des populations d’élèves plus socialement favorisées. À la lecture de ces bilans, les auteur·es en arrivent donc à objectiver le caractère socialement situé de ce rapport.
Pour les élèves de Saint-Denis et des « faibles classes » de Massy, le but serait alors avant tout d’aller le plus loin possible, de satisfaire les exigences de l’école afin d’accéder à la classe supérieure, au diplôme ou au métier, les matières n’étant finalement pas réellement considérées en tant « qu’ensembles cohérents de savoirs » mais plutôt comme des « formes institutionnelles de découpage du temps scolaire » (Charlot et al., 1992, p. 100). À l’opposé, dans les « bonnes classes » de Massy, les élèves semblent alors s’affranchir plus facilement du découpage en termes de disciplines scolaires, décrivant davantage le savoir comme « Théorie, antérieure à ses applications », celui-ci pouvant également être perçu par d’autres comme un « acte qui permet de s’approprier le sens de la vie, dans un échange verbal constant avec les autres » (ibid., p. 101).
Comme le soulignent les chercheur·ses, ces élèves considéreraient ainsi davantage le savoir en tant que tel, à travers l’expression d’une forme de rapport au Savoir ». Donnant un avantage scolaire certain à celleux qui le détiennent et se trouvant exigé jusqu’aux plus hautes sphères de l’enseignement supérieur en tant que posture à adopter, le rapport au savoir pour le savoir » permettrait même de faire la différence aux concours les plus élitistes (Blanchard, Orange & Pierrel, 2017, p. 75).
Cette distinction entre un savoir particulièrement important pour « passer » mais inutile car ne présentant pas de sens en lui-même paraissait donc dès lors encore plus renforcée vis-à-vis des mathématiques, principalement prises en exemple par les élèves emprunts par cette logique et ce type de rapport (Charlot & Bautier, 1993). Pointant également l’enjeu de s’intéresser au point de vue des élèves et traitant spécifiquement de leur rapport aux sciences à partir des données d’une enquête internationale14 (Jenkins & Nelson, 2005), des chercheur·ses britanniques ont également pu relever chez les élèves anglais·es une propension à penser que si les sciences sont importantes, c’est avant tout pour leur apport dans le cursus ainsi que les avantages qu’elles peuvent procurer vis-à-vis de leur carrière future ; et non pas par « intérêt intrinsèque » (« intrinsic interest »), comme le soulignaient déjà les auteur·es d’une autre étude menée sur des focus group (Osborne & Collins, 2000, cité·es par Jenkins & Nelson, 2005, p. 52).
La transition entre l’école primaire et le collège semble par ailleurs tout particulièrement difficile, avec un rapport aux apprentissages qui se dégrade et une baisse de la motivation observée, notamment face au saut d’exigences (à la fois intellectuelles et en termes d’autonomie) ainsi que par l’évolution de la relation avec les enseignant·es (Bonnéry, 2007 ; Grisay, 1994, 1997). Il semblerait de plus que le désamour pour les maths explose de façon encore plus nette que celui pour le français au cours des années collège (Merle, 2003), à l’instar de ce qui a encore pu être récemment observé plus généralement vis-à-vis des sciences (Perronnet, 2021).
Cependant, il est à noter que ce désintéressement progressif ne serait pas propre au contexte français, puisqu’il a par exemple a priori pu être démontré dans plusieurs études menées « in the UK and beyond » (« au Royaume-Uni et au-delà ») que le niveau de plaisir pour les sciences tend à décroître à compter des dernières années d’école primaire (Murphy & Beggs, 2005, p. 7). Face à ces constats, la place accordée aux mathématiques et aux sciences dans l’univers familial des élèves ainsi que la présence plus ou moins importante de contenus culturels et loisirs scientifiques dans leur quotidien est bien sûr également à considérer.
Une culture scientifique qui se diffuse de façon inégale au sein des familles
Les différences de rapport aux divers types de savoirs entre les élèves sont également à mettre en relation avec des différences de ressources économiques, matérielles et culturelles dont leurs familles disposent, et plus généralement avec ce qui découle de leur socialisation familiale. Plus précisément, pour comprendre comment un goût pour les mathématiques ou les sciences est plus ou moins susceptible de se développer, il peut être intéressant de rendre compte des conditions dans lesquelles la culture scientifique se développe au sein des familles selon les milieux socio-économiques et culturels.
Tout d’abord, les travaux d’Annette Lareau ont par exemple pu mettre en exergue la manière dont les loisirs des enfants sont plus ou moins encadrés dans les différentes familles, qui n’ont pas tendance à adopter les mêmes styles éducatifs en fonction de leur position sociale (Lareau, 2011). Les familles de classes moyennes sont ainsi plus enclines à développer une forme d’« acculturation concertée » (« concerted cultivation »), à travers laquelle les parents tendent à s’investir dans l’organisation des loisirs pratiqués par leurs enfants. Les enfants de classes populaires ont en revanche plus souvent tendance à avoir une gestion plus autonome et « un contrôle plus important sur leur temps de loisirs » [traduction libre] (ibid., p. 3), leurs familles favorisant ainsi l’« accomplissement de leur développement naturel » (« accomplishment of natural growth »).
À l’appui de ces éléments, Clémence Perronnet (2021) en déduit que même si ces deux types d’éducation permettent aux enfants de développer des connaissances, compétences et savoir-faire, et qu’aucun des deux n’est a priori supérieur à l’autre, cela peut mener à des conséquences dans le développement de loisirs scientifiques. En effet, les sciences bénéficient d’une certaine valeur scolaire, et l’école semble promouvoir davantage le modèle selon lequel « les parents choisissent les loisirs et gèrent le temps de leurs enfants dans une perspective éducative, voire franchement scolaire » (ibid., p. 74).
On sait également de façon plus générale que dans les sociétés occidentales contemporaines, l’école valorise et sanctionne avant tout la culture écrite essentiellement diffusée parmi les classes moyennes et supérieures (Terrail, 2002). Selon Terrail, elle offre donc moins la possibilité aux enfants des classes populaires de convertir en réel capital scolaire leurs ressources culturelles habituellement tirées de formes plus orales de transmissions familiales.
En ce qui concerne les sciences, la façon plus « informelle » à travers laquelle ces derniers les expérimentent le plus souvent se trouve également en décalage avec les pratiques plus formelles dont usent généralement les enfants de classes moyennes, qui coïncident avec le caractère tout aussi formel de leur apprentissage à l’école (Archer et al., 2010). Mais surtout, il semblerait qu’en règle générale la culture scientifique ne fasse pas partie du quotidien d’une grande majorité des enfants des classes populaires (Perronnet, 2021). Si celleux-ci regardent malgré tout des émissions ou vidéos de vulgarisation scientifique et partagent donc une forme de « culture scientifique enfantine commune » avec les autres enfants, iels possèdent finalement peu (voire pas) de magazines ou livres scientifiques, et ne pratiquent que très peu de loisirs en lien avec les sciences (ibid., pp. 66-67).
Ainsi, si les ressources culturelles scientifiques sont inégalement réparties ou transmises au sein des différentes familles et « qu’avoir des loisirs scientifiques est une chance que tout le monde n’a pas » (op. cit., p. 254), cela ne représente qu’une partie de l’équation vis-à-vis des inégalités qui se forment dans le rapport aux sciences et aux mathématiques. Dans le fondement de ces diverses relations, on ne saurait en effet sous-estimer le poids qu’exercent les représentations socialement ancrées en lien avec ces disciplines et savoirs, certaines catégories de personnes venant ainsi à se trouver littéralement « exclues » des filières, études ou carrières qui y sont associées.
Représentations sociales et exclusion : des mathématiques et des sciences « faites » pour les uns… mais pas pour les autres
Rapport aux disciplines scientifiques et choix de parcours : une nette différenciation genrée Lorsque l’on en vient à s’intéresser à un sujet comme celui des mathématiques, la question du genre apparaît rapidement centrale. Si les filles ont depuis longtemps rattrapé les garçons aux quatre étages de l’édifice scolaire (Baudelot & Establet, 1992), et qu’elles et ils obtiennent des résultats à peu près équivalents dans les différentes disciplines scientifiques, y compris en maths15, leur rapport à la discipline ne se révèle pas pour autant identique, loin s’en faut travers une enquête récente réalisée sur un échantillon de 8 548 lycéen·nes francilien·nes raisonnablement représentatif » de la population des élèves scolarisé·es en classe de seconde générale et technologique ou de terminale scientifique en région Île-de-France16, Thomas Breda et ses collègues permettent une nouvelle fois d’objectiver les écarts dans la relation à la discipline (Breda et al., 2018).
En classe de seconde, sur une échelle allant de 0 à 10, les garçons attribuent alors un score de 6,6 à leur goût pour les mathématiques, contre une moyenne de 5,6 chez les filles. Par ailleurs, les garçons de seconde sont prêts de 80 % à déclarer aimer les sciences, contre environ 67 % des filles. Vis-à-vis de la perception de leur propre niveau en mathématiques, les filles affichent également une confiance en elles moins élevée que leurs homologues masculins, 37 % d’entre elles se considérant de « bon niveau », contre 48 % du côté des garçons. Pourtant, les auteur·es montrent que les résultats obtenus par les participant·es à l’enquête au diplôme national du brevet de mathématiques sont en réalité équivalents entre les deux sexes.
Par ailleurs, une différence de confiance entre filles et garçons face à leurs capacités en mathématiques à niveaux de compétence comparables a déjà pu être relevée, notamment par Marie Duru-Bellat (2016). D’autres études relativement récentes ont encore pu montrer les différences de concept de soi et d’aspirations en lien avec les sciences (DeWitt et al. 2011), avec ainsi une tendance à sous-estimer ses propres capacités dans le domaine ou à moins vouloir exercer une profession scientifique chez les filles vis-à-vis des garçons, même à niveau égal (Breda et al., 2018 ; OCDE, 2016). On le retrouve alors effectivement dans la propension inégalée qu’ont les filles et les garçons à s’orienter vers les voies et métiers scientifiques, phénomène objectivé et débattu de longue date.
De fait, les mathématiques ont tout d’abord très rapidement été présentées comme un « filtre critique » (Sells, 1973, 1980 ; également citée par Zaslavsky, 1994, p. 2). Dès la fin des années 1970, Lucy Sells relevait que la peur des mathématiques pouvait amener les élèves à éviter des matières comme l’algèbre et la géométrie, et donc en quelque sorte à « s’auto-exclure » d’études ou filières menant vers les emplois les plus valorisés ou les mieux payés (Sells, 1980). Cette approche a ainsi d’abord été employée pour relater des inégalités de genre dans le milieu professionnel et carrières scientifiques, et a ensuite progressivement laissé place à l’identification d’un effet dit du carrière, à modifier leur orientation et sélectionner d’autres domaines d’études ou d’emploi. Ce phénomène concernerait alors bien plus souvent les filles que les garçons, qui seraient ainsi de moins en moins représentées à chaque étape et peu nombreuses à arriver « at the end of the pipeline » (« au bout du tuyau » ; Blickenstaff, 2005, p. 369).
◦ l’origine des débats en sociologie française de l’éducation quant à la manière d’interpréter la sous-représentation des filles dans les disciplines ou filières scientifiques de l’enseignement, s’opposaient alors différentes visions. Celle de Christian Baudelot et Roger Establet (1992) s’appuyait par exemple sur le rôle de la socialisation enfantine.
On pourrait ramener leur interprétation à une forme de variation genrée du concept d’intériorisation de la causalité du probable développé par Pierre Bourdieu, par lequel les « stratégies objectives » d’orientation adoptées par les filles ne seraient alors pas « déterminées par une anticipation de l’avenir [et] de ses propres conséquences » mais plutôt par « des pratiques qu’engendre l’habitus et qui sont commandées par les conditions passées de la production de leur principe générateur » (Bourdieu, 1974, p. 4).
À l’opposé, Marie Duru-Bellat tenait à défendre le fait que les filles adaptent de façon rationnelle leurs stratégies scolaires en anticipant les fonctionnements sexistes du marché du travail, leurs choix devant alors être considérés comme la résultante d’une « adaptation raisonnable à leur situation objective » (Duru-Bellat, 1990, p. 230). Quelques années plus tard, dans un texte co-écrit avec Annick Kieffer et Catherine Marry (2001), elle semblait cependant réviser légèrement sa position, en soulignant la part non négligeable que prendrait la socialisation familiale dans la production des inégalités de scolarités entre garçons et filles.17 Malgré tout, cette socialisation précoce (familiale ou scolaire) devrait (ou devait) selon elle également être perçue comme une forme d’anticipation de ce qui attend objectivement ces filles (Duru-Bellat, 1990).
Dans une étude récente, Estelle Herbaut et Carlo Barone ont tenté de recenser l’ensemble des facteurs ayant été présentés dans la littérature comme étant susceptibles d’expliquer la ségrégation de genre dans les filières scientifiques de l’enseignement supérieur (Herbaut & Barone, 2021). En confrontant un vaste ensemble de variables à travers une analyse en régression très développée et rondement menée, les auteur·es en arrivent à la conclusion que les « choix de curriculum » représenteraient l’élément clé de l’explication.