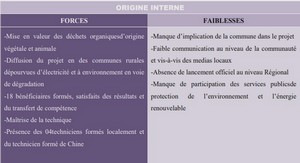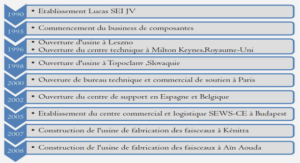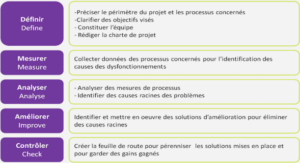LE ROMAN FRANÇAIS POSTMODERNE
POSTMODERNITE ET POSTMODERNISMES
L’HYPOTHESE POSTMODERNE
Pour Michael Köler qui, le premier, retrace l’histoire du mot dans le contexte américain, le néologisme postmoderne aurait été forgé par Arnold Toynbee, en 1947, dans une acception socio-historique, pour désigner, aux lendemains de la seconde guerre mondiale, une mutation dans les cultures occidentales. Le mot apparaît ensuite à plusieurs reprises pour caractériser la littérature américaine de l’après-guerre mais il ne s’impose véritablement en critique littéraire que dans les années 60. Il s’applique alors à un courant qui s’écarte à la fois du roman sociologique et des expérimentations formalistes. Harry Blake fait de la publication du Festin nu, de William Burroughs, en 1959, l’événement inaugural du « post-modernisme américain » dont les principaux représentants sont pour lui, John Barth, Donald Bertheleme, Richard Brautigan, Robert Coover, William Gass et Jerzy Kosinski.S’y sont ajoutés d’autres romanciers comme Thomas Pynchon, Kurt Vonnegut, John Hawkes, Stanley Elkin puis Saul Bellow et Norman Mailer et quelques figures internationales comme Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borgès ou Italo Calvino. Mais déjà la confusion s’installe quand les théoriciens d’outre-Atlantique cherchent à inclure, sous la même étiquette, le Nouveau Roman français, le groupe Tel Quel ou l’Oulipo…, c’est-à-dire des écritures expérimentales qui, nous le verrons relèvent de la modernité. En dépit d’un usage encore flottant, toutefois, le terme va s’installer durablement dans le discours critique américain avec les études d’Ihab Hassan et de Linda Hutcheon[4].
Parallèlement, le mot s’impose en architecture où il incarne une rupture avec le fonctionnalisme de Gropius, Van der Rohe ou Le Corbusier dont l’excès de rationalisation a conduit aux formes froides et géométriques de l’habitat standardisé. Le refus des slogans modernistes de la Charte d’Athènes : « la forme suit la fonction », « seul ce qui est pratique est beau », amène des architectes comme Robert Venturi, Charles Moore ou Paolo Porthoghési à se reconnaître dans ce que Charles Jencks dénomme en 1977 : The language of Post-Moderne Architecture[5].
En France, c’est Jean-François Lyotard qui, en 1979, acclimate le mot avec un livre clé : La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir dans les sociétés les plus développées[6]. Comme l’indique le sous-tire, cet ouvrage, conçu pour répondre à une commande des universités du Québec, va à son tour créer de nombreux débats et introduire la notion de ce côté de l’Atlantique.
Polémique autour d’une notion :
Le premier sujet de controverse concerne la nature même du mot, écrit, tantôt avec tiret (Harry Blake, Henri Meschonnic), tantôt sans tiret (Ihab Hassan, Jean-François Lyotard). Avec tiret, c’est un mot composé dont la binarité clivée désigne, sous une forme disjonctive, une rupture temporelle avec la modernité. Or, comme le rappelle Henri Meschonnic, moderne vient du latin modernus (Vème siècle), « terme chrétien qui semble seulement référé au nouveau, à l’actuel – de modo, « à l’instant ».[7] » Plus actuel que l’actuel, le paradoxe du post-moderne explique cette réticence en forme de leit-motiv qui d’Harry Blake (1977) à Pierre Lepape (1998) nous vaut ce « faute de mieux » où passe la résignation d’une impuissance à conceptualiser. Car c’est autour du tiret que se radicalise l’opposition entre ceux qui font du post-modernisme une rupture radicale, une litanie de la fin et de l’épuisement (fin de l’histoire, fin de la métaphysique, fin des avant-gardes), c’est-à-dire un anti-modernisme et ceux qui préfèrent y voir une sorte de constat critique des dévoiements du projet moderne : « Le post-moderne est-il plus moderne que le moderne, ou anti-moderne (…) ? »[8] Cette alternative que Meschonnic pose d’une manière polémique peut-être conçue différemment si l’effacement du tiret fait du mot composé autre chose que la simple désignation d’une « période qui ne sait plus inventer l’avenir », comme l’écrit encore Marc Chénetier dans un dossier de la revue québécoise Etudes Littéraires[9]. Postmoderne devient alors un pur néologisme, c’est-à-dire une notion autonome où la négativité supposée du préfixe « post -» fait place à une volonté de penser l’ « après », dans la difficulté où nous sommes à formuler cet innommable, ce seuil sur lequel nous nous trouvons. La forme du paradoxe qui neutralise la contradiction dialectique et écarte la possibilité même du concept donne ainsi au néologisme une acceptabilité suffisante pour qu’il puisse servir l’hypothèse sur laquelle repose cette étude. C’est donc à cette orthographe que je me rallierai.
L’autre problème que pose l’instabilité de la notion et son impossible conceptualisation concerne la distinction postmodernité/Postmodernisme. Par le premier terme ce que l’on cherche à penser c’est d’abord une période, un contexte socio-culturel, tandis que par le second c’est une esthétique. Or l’idée répandue outre-Atlantique est que la posmodernité aurait été théorisée par les Européens à partir d’un postmodernisme mis en œuvre par les Américains. D’où le double intitulé du numéro spécial des Etudes Littéraires, avec son pluriel, Postmodernismes : poïesis des Amériques, éthos des Europes[10]. Je tenterai ici de réagir à cette partition du champ en montrant que dans le contexte littéraire français, les deux notions sont interdépendantes.
Quoiqu’il en soit l’adjectif nominalisé postmoderne sous sa forme néologique et paradoxale a donc une double généalogie, aux USA : depuis les années 60 et en France : depuis les années 80, avec des acceptions qui ne se recoupent pas totalement par suite des différences entre l’histoire de l’Amérique et celle de l’Europe.
De la modernité
Pour bien comprendre l’importance et la diversité des enjeux liés à l’hypothèse postmoderne, il nous faut définir au préalable la modernité car il y a aussi dans ce terme du paradoxal et comme l’a bien montré Meschonnic, le moderne en tant que synonyme de « nouveau » ne se confond pas pour autant avec le contemporain. La distinction opérée à ce sujet par l’Histoire de l’art le démontre. Si la querelle des Anciens et des Modernes, à la fin du 17ème siècle réactive l’opposition médiévale modernitas/antiquitas au plan chronologique comme au plan du savoir, c’est surtout avec la philosophie des Lumières, l’Aufklärung, que la modernité se constitue comme pensée issue de l’historicisation du procès de rationalisation. L’éveil progressif de la conscience et le cumul du savoir libèrent l’homme de la croyance et de la théologie tout en préparant les voies futures de son émancipation. Tel est le projet de l’Encyclopédie : fiction d’un savoir absolu encadré par le positivisme de d’Alembert et le déterminisme laplacien.
Pour Hans Robert Jauss[11] en effet, c’est à l’époque des Lumières qu’apparaît cette idée essentielle selon laquelle le progrès ininterrompu des connaissances conduit à l’émancipation de l’homme dans une société de plus en plus libérée. Liée à l’essort du rationalisme cartésien la modernité se caractérise donc par une sorte de darwinisme social qui associe, selon la vision hégélienne de l’Histoire, le progrès infini des connaissances et l’émancipation des peuples. D’où l’importance de l’idéal révolutionnaire dans le projet de la modernité qu’Alain Touraine définit « comme triomphe de la raison, comme libération et comme révolution. »[12] Car l’idéal révolutionnaire qui s’enracine dans une image rationaliste du monde met en relation, au sein même de l’idée de progrès, le triomphe de la raison et celui de la liberté. C’est cette conception classique de la modernité qui sert de point de départ à l’analyse de Jean-François Lyotard :
Cette idée s’élabore à la fin du 18ème siècle dans la philosophie des Lumières et la Révolution française. Le progrès des sciences, des techniques, des arts et des libertés politiques affranchira l’humanité tout entière.
La logique qui sous-tend cette vision d’un devenir humain en flèche relève de la dialectique spéculative dont la puissance de conceptualisation absorbe la dynamique des contraires dans une synthèse totalisante[14]. A partir des principes d’identité et de contradiction le raisonnement dialectique permet en effet de dégager d’une suite d’oppositions une synthèse unitaire, c’est-à-dire un ordre supérieur qu’on peut appeler Sens de l’Histoire dans le système hégélien mais qui travaille indistinctement le domaine des sciences, celui des arts et celui des cultures. L’un des avatars récents de la modernité dans le champ critique, par exemple, a été le structuralisme, fondé sur le principe des oppositions binaires. Je rappelle pour mémoire les célèbres oppositions en linguistique : signifiant/signifié, langue/parole, syntagme/paradigme, synchronie/diachronie, dénotation/connotation, structures de surfaces/structures profondes…Or ce modèle, issu de la phonologie, a été transposé avec le succès que l’on sait à l’ensemble des disciplines relevant des sciences humaines et sociales : de l’anthropologie à la poétique en passant par la sémiologie sous toutes ses formes. Le structuralisme, depuis les formalistes russes de 1925, est ainsi devenu un puissant outil de rationalisation du texte littéraire. L’exemple le plus achevé de cette modernité dialectique me paraît être la grammaire sémiotique de Greimas qui rend compte de l’universalité de la forme narrative à partir d’un système binaire d’oppositions sémantiques, développé en programme narratif sous la forme du carré logique à quatre positions. En poésie, le travail de Jacques Roubaud et Pierre Lusson va dans le même sens et leur métrique générative postule un modèle général du rythme dont la description utilise le système binaire des ordinateurs, c’est-à-dire l’opposition 0 vs 1. Les taxinomies des néo-rhétoriciens et les théories stylisiques de l’écart se fondent elles-mêmes sur le même principe ainsi que les « poétiques » élaborées par Gérard Genette, Philippe Hamon ou Jean Molino/Joëlle Tamine, dont la démarche consiste à identifier et à classer les invariants du texte pour les constituer en systèmes. Et nous devons beaucoup, bien entendu, à ce mode d’analyse qui a fécondé, en France, depuis les années 60, ce qu’on a appelé la nouvelle critique.
Ajoutons à ceci l’essort de la cybernétique, née de la deuxième guerre mondiale, qui découvre dans les systèmes auto-régulés un modèle universel transposable du champ des sciences expérimentales à celui des sciences humaines ou sociales (économie, politique, sociologie, sémiotique). Dans la mesure où le système, selon la définition de Joël de Rosnay, est « une totalité en fonctionnement », tout élément, toute unité discrète, ne peuvent se comprendre et s’étudier que par rapport à l’ensemble dont ils font partie, les systèmes eux-mêmes s’emboîtant, de micro-systèmes en macro-systèmes ou de sous-sytèmes en systèmes-environnement, dans une inter-activité inépuisable…C’est à partir de la systémique que le structuralisme commence à évoluer vers les modèles de la productivité où, sous l’influence de Kristeva le concept de signifiance se substitue, en poétique, à celui de signification (Jean Ricardou et Henri Meschonnic).